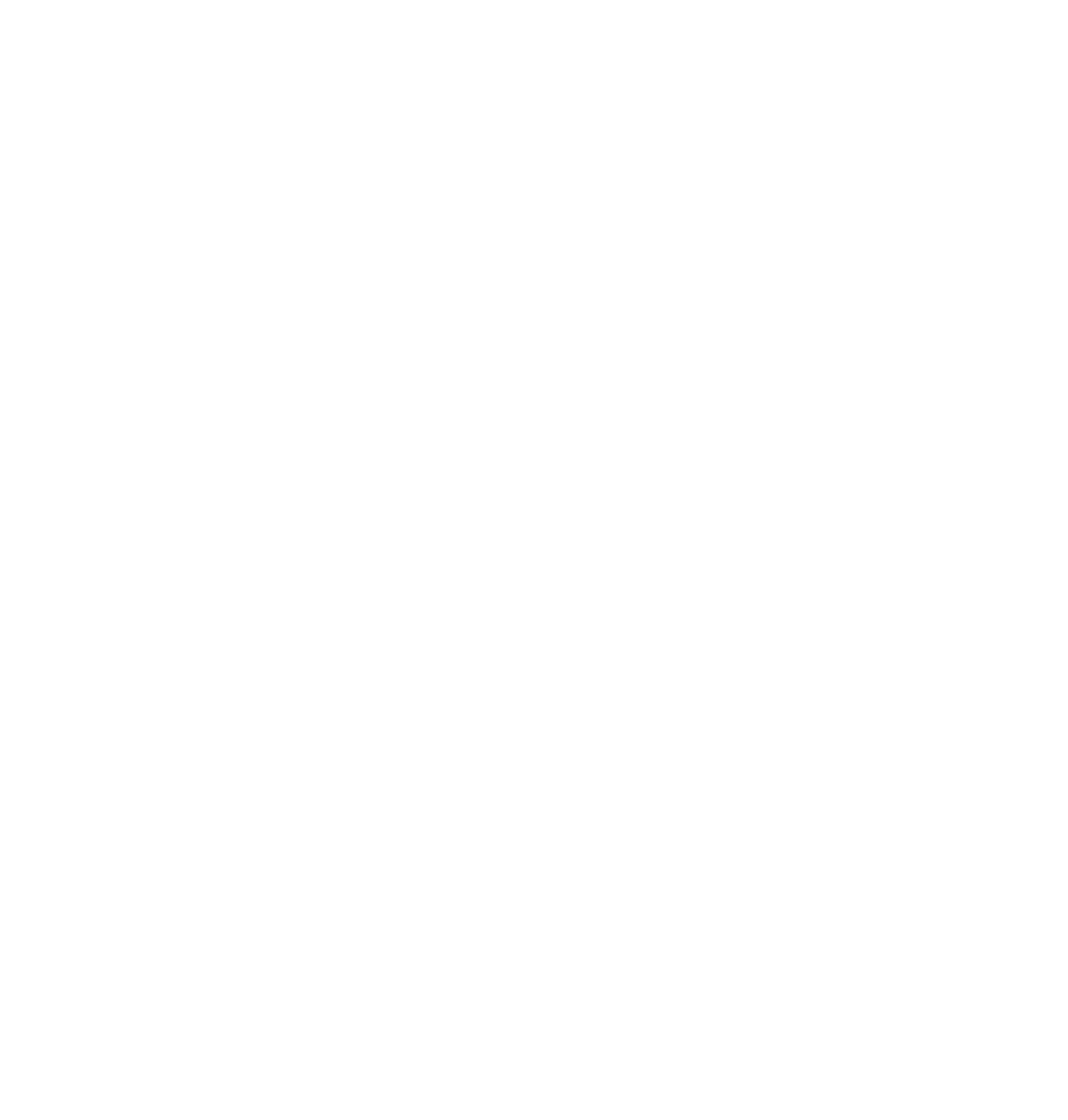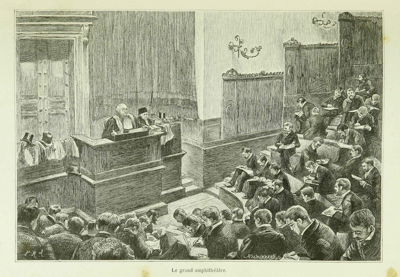Paris et Toulouse sont les deux plus grandes facultés de droit françaises. Tout au long du xixe siècle, elles dominent le paysage académique de l’Hexagone, notamment par leur attractivité, le nombre de leurs étudiants inscrits et des diplômes délivrés. Elles partagent avec les autres facultés juridiques (une dizaine sur le territoire national) crées par Napoléon, à partir de 1804, une même vocation professionnalisante : elles organisent des examens et délivrent prioritairement les titres nécessaires à l’accès aux professions juridiques et judiciaires (magistrats, avocats, professeurs, etc.) pour les enfants des classes les plus favorisées. Partout, l’enseignement est centré sur le droit civil, le droit romain et la procédure. Il ne fait guère de place – ou très exceptionnellement – aux autres branches du droit (le droit administratif, le droit commercial ou encore l’histoire du droit). Les contemporains, à commencer par quelques écrivains célèbres (Balzac, Zola et d’autres), ont jugé sévèrement les méthodes pédagogiques et le contenu des cours. C’est bien souvent l’ennui, la routine et le conformisme qui dominent sur les bancs de la faculté. Il y a quelque injustice à colporter, sans nuances, cette légende noire. Chacun s’accorde à reconnaître le sérieux de l’enseignement juridique, la rigueur du corps enseignant (qui n’exclut pas chez certains professeurs l’originalité et le goût de l’innovation) et l’utilité d’un savoir qui, aussi superficiel fut-il dans sa transmission, constitue un fond culturel commun des élites dirigeantes.
Il faut attendre les années 1860 pour que s’affirme une certaine ambition intellectuelle et scientifique au sein des facultés de droit. Ces dernières connaissent, sous la Troisième République, des mutations sensibles. Pour faire face à la concurrence des institutions privées, pour former adéquatement les clientèles attirées par le service public, pour répondre aux transformations économiques et sociales de la société française, des réformes sont entreprises pour mieux ajuster l’offre de formation aux enjeux de l’époque. Gage de modernisation, de nouvelles disciplines apparaissent dans les programmes (économie politique, droit constitutionnel, finances publiques, droit colonial, etc.) ; les apprentis juristes les plus motivés peuvent s’orienter vers un doctorat ès sciences juridiques ou bien ès sciences politiques et économiques. Les facultés s’ouvrent progressivement à des classes sociales un peu moins fortunées. Mais le coût élevé des études exclut toujours (et pour longtemps encore) les classes populaires. La Belle Époque est souvent considérée comme « l’âge d’or » des facultés de droit. Ces dernières maintiennent, vaille que vaille, leur position hégémonique dans la formation supérieure des élites françaises (n’a-t-on alors pas parlé d’une « République des juristes » ?). Elles participent pleinement aux débats autour de la naissance des sciences économiques et sociales (Léon Duguit et quelques autres souhaitaient même leur reconnaître le titre de « facultés de sciences sociales ») ainsi qu’à la diffusion du catéchisme républicain ; l’expertise politique et sociale des professeurs de droit est reconnue et valorisée. Faut-il s’étonner de constater que les figures tutélaires de la science juridique française (de Hauriou à Duguit, en passant par les Esmein, Gény, Saleilles, Thaller, Planiol, etc.), ces « grands juristes » français, appartiennent essentiellement à cette époque de glorieuse mémoire ? Grandes actrices de l’histoire universitaire nationale, les facultés de Paris et de Toulouse connaîtront pendant cette période des développements contrastés. Alors que la première domine outrageusement l’espace académique, la seconde a su jouer de ses atouts pour se bâtir une réputation enviable et une position respectée dans les sphères juridiques.
Hiérarchies
La réforme universitaire portée par le pouvoir républicain tente de rééquilibrer l’organisation hypercentralisée du système français et de développer l’esprit scientifique des institutions académiques. Les défauts du modèle académique napoléonien sont devenus criants et on va jusqu’à lui imputer les raisons de la défaite de 1870. La Troisième République s’efforce d’enclencher un mouvement de réformes, en augmentant de nombre d’enseignants, en continuant la création de nouvelles facultés (Bordeaux, Montpellier ou Lyon), en agrandissant les plus anciennes, en renforçant leurs moyens financiers ou encore en modernisant leur gouvernance (cf. loi sur les universités de 1896). La politique de décentralisation a donné des résultats certains, en redynamisant notamment certains pôles provinciaux, mais elle n’entame pas la prééminence parisienne. Cette dernière est, en somme, consubstantielle au système hexagonal. Pour ne donner qu’un seul exemple, 43 % des étudiants (toutes facultés confondues) se concentrent, en 1914, à Paris. Si Toulouse conserve son statut de deuxième faculté de droit de France, elle se place encore loin derrière sa devancière. À la veille de la Grande Guerre, la faculté parisienne dispose d’une quarantaine d’enseignants quand Toulouse en compte une vingtaine. La première revendique, au même moment, plus de 7500 étudiants (un peu moins de la moitié des étudiants nationaux en droit) alors que la seconde dépasse le millier d’étudiants.
La domination économique et politique de la capitale trouve une manifestation directe dans la vie académique. Les études supérieures sont un luxe, une marque de distinction sociale (dans l’entre-deux-guerres, toujours moins de 3 % du groupe d’âge 19-22 ans font de telles études). Elles coûtent très chères pour les familles, plus encore si elles impliquent un éloignement géographique de l’adolescent et son installation dans une autre ville. Dans tous les cas, la filière juridique offre l’avantage d’être assez peu sélective scolairement mais, en même temps, elle ouvre de très nombreuses portes aux enfants des classes supérieures (la plupart des professions prisées par ces dernières empruntent le chemin des facultés de droit). Si cette sélectivité sociale est une caractéristique majeure et générale des études, elle ne se décline pas pour autant de la même manière d’une faculté à l’autre. À Toulouse, au xixe siècle, ce sont essentiellement les fils des propriétaires fonciers (longtemps dominants), ceux issus de la bourgeoisie libérale et commerciale qui prennent une inscription. À la veille de la Grande Guerre, c’est une évolution très sensible, les fils des professions libérales finissent par s’imposer majoritairement sur les bancs de la faculté. Ces étudiants représentent donc une certaine élite locale mais pas nécessairement les grandes familles, les plus riches qui jouent un rôle politique et social de premier plan. Pour autant que les données disponibles nous permettent de l’affirmer, les fils de ce patriciat toulousain semblent bouder quelque peu la formation juridique. À l’inverse, la population étudiante parisienne, plus nombreuse, plus contrastée et chatoyante (sans être le moins du monde issue des milieux populaires), concentre toutefois les catégories très fortunées et influentes ; les fils des « élites de la République », dotés de réseaux sociaux étendus, d’appuis politiques, d’un capital économique considérable, se préparent à entrer dans la haute fonction publique, à se lancer dans une grande carrière d’avocat d’affaires ou encore rêvent à un destin politique national. Les enquêtes sur les trajectoires étudiantes et les débouchés juridiques sous la Troisième République sont lacunaires. Toutefois, on voit se dessiner quelques tendances : la faculté toulousaine alimente principalement le monde judiciaire et les administrations locales quand la faculté parisienne nourrit aussi les rouages de la haute administration d’État, entretient les milieux politiques et forme l’élite des affaires.
Cette prééminence parisienne s’observe également dans le corps enseignant lui-même. L’historien Christophe Charle a bien montré que, sur l’ensemble du territoire, le métier de professeur de droit est bien souvent une filière de promotion pour les couches moyennes de la bourgeoisie, accessible à celles à qui les filières plus prestigieuses restent fermées. À bien des égards, l’agrégation en droit offre des perspectives méritocratiques (et plus égalitaires que d’autres concours) à des individus doués intellectuellement. Les futurs enseignants sont, en effet, souvent récompensés par des résultats brillants et des prix au cours de leur formation. L’instauration d’un concours national d’agrégation, en 1896, censé garantir une meilleure qualité et homogénéité du corps enseignant, creuse in fine un peu plus l’écart entre Paris et la province. Les jeunes docteurs en droit (venant de toute la France) qui préparent ce concours dans la capitale, auprès des professeurs parisiens, maximisent leur chance de réussite. Dans les premières décennies du siècle, 60 % des reçus en histoire du droit sont issus de l’académie de Paris et plus de 55 % des reçus en droit privé. De nombreux provinciaux viennent donc chercher à Paris une préparation rigoureuse au concours et côtoyer les futurs professeurs du jury (ce dernier est dominé, ici encore, par les parisiens). Si les nouveaux enseignants débutent par plusieurs années dans les facultés provinciales, les candidats à un retour parisien sont nombreux. Ce retour est, dans l’espace académique, un marqueur d’excellence et de réussite. La concurrence pour l’accès aux chaires parisiennes est sévère (elle l’est plus encore pour les médecins ou les littéraires) et, dans la carrière, cette arrivée de plus en plus tardive (entre 40 et 45 ans). Soulignons d’ailleurs que Toulouse a mieux résisté que d’autres facultés à cette attractivité parisienne des enseignants. Nous y reviendrons. Dans tous les cas, les professeurs parisiens bénéficient d’un accès privilégié aux institutions prestigieuses du savoir (nombreux sont, par exemple, les professeurs parisiens membres de l’Académie des sciences morales et politiques), côtoient l’élite hiérarchique du droit (à commencer par les membres de la Cour de cassation), complètent leurs enseignements par des activités lucratives (symboliquement et financièrement) : consultations privées, conseil ou encore détention de postes politico-administratifs. Bien plus que leurs collègues provinciaux, ils prennent part, en s’appuyant sur le puissant secteur de l’édition juridique, à des entreprises éditoriales qui accroissent leur visibilité scientifique et leur poids dans les débats doctrinaux. La majorité des revues disciplinaires ou sous-disciplinaires sont fondées, en effet, par des parisiens (certains toulousains intègrent d’ailleurs leurs comités de rédaction) ; les revues « doctrinales » à dominante provinciale sont une poignée (à Toulouse, on relève l’existence du Recueil de Législation de Toulouse ou encore, plus tardivement, la Revue de droit rural et d’économie agricole). Faut-il également rappeler que l’accession à un poste parisien offre des opportunités de carrière politique nationale d’envergure ou de participation à des fonctions d’expertise (comité du contentieux, Conseils supérieurs, conseils consultatifs, etc.) ? Sous la Troisième République, la faculté parisienne compte ainsi, dans ses propres rangs, sept députés et deux ministres. Paris ou le désert français ?
Concurrences
À la différence des facultés de sciences et des lettres satellisées par la capitale, les facultés de droit de province connaissent toutefois une attractivité certaine et une vie académique effective. Pour les professeurs, choisir d’y faire carrière n’est pas, le plus souvent, un choix par défaut mais une stratégie de carrière pour qui préfère l’enracinement provincial à la gloire parisienne. Toulouse illustre parfaitement une telle configuration. L’attraction de Paris ne joue que modérément pour sa clientèle étudiante. Longtemps sans rivale dans sa région, la faculté toulousaine attire principalement les étudiants des départements du Sud-Ouest (la part de ces derniers fréquentant la faculté parisienne ira d’ailleurs en diminuant avec la création de nouvelles facultés comme celle de Bordeaux). Elle se montre accueillante pour les étudiants étrangers (Russes, Égyptiens, Espagnols, etc.) et en compte plus d’une trentaine à la veille de la Grande Guerre (à Paris, ce nombre d’étudiants étrangers approche les 900 autour de 1910). En définitive, son bassin de recrutement se resserre sensiblement, avant 1914, autour de la Haute-Garonne et de ses départements limitrophes. Du côté du corps enseignant, une tendance similaire se manifeste : nombreux sont les professeurs toulousains qui ont fait leurs études sur place et désirent y terminer leur carrière. Certes, quelques-uns ne font qu’un passage dans la ville rose pour terminer à Paris (par exemple, Charles Beudant, Achille Mestre ou André Fliniaux) et l’échec de Maurice Hauriou à l’accession d’une chaire parisienne est resté dans les mémoires. Mais, d’une manière générale, ces enseignants (qui débutent fréquemment leur carrière dans d’autres villes du Midi ou à Alger) optent pour un retour définitif dans la capitale Occitane. Loin des lumières parisiennes.
Là où Paris met en scène son pouvoir d’influence et sa puissance universitaire, Toulouse revendique, quant à elle, une prestigieuse tradition juridique remontant au xiiie siècle (on fait remonter la naissance de l’Université en 1229) et une sensibilité historique et historienne jamais démentie qui tranche avec les méthodes d’interprétation du droit traditionnellement en vigueur. Une telle sensibilité est notamment illustrée par les juristes humanistes qui fréquentèrent ou enseignèrent à Toulouse (de Jean de Coras à Pierre Grégoire, en passant par Jacques Cujas ou encore Jean Bodin) mais aussi, à partir des années 1850, par l’émergence de son « École historique du droit » qui emprunte ses méthodes aux juristes allemands. De fait, sous le Second Empire et pour quelques années, Toulouse sera, après Strasbourg, un lieu décisif des échanges intellectuels franco-allemands. Plusieurs professeurs toulousains participent ainsi, en 1851, à la création d’une institution unique consacrée à la science juridique, l’académie de législation de Toulouse, qui obtient la collaboration des plus grands juristes allemands (Savigny, Mittermaier, Bluntschli, etc.). L’Académie continue, aujourd’hui encore, ses travaux, après plus d’un siècle et demi d’existence. Toulouse a donc fait de la rénovation des méthodes juridiques (aussi bien dans les domaines du droit administratif, du droit pénal ou encore du droit international privé) un cheval de bataille et un marqueur identitaire. Les générations successives de professeurs ne cesseront de s’y référer. Si, dans l’Hexagone, plusieurs facultés ont eu des ambitions scientifiques et critiques similaires (par exemple, Strasbourg et Lyon), la faculté parisienne n’a, quant à elle, jamais vraiment porté une telle ambition réformatrice comme un étendard (même si, naturellement, certains de ses enseignants furent à la pointe des débats intellectuels et ont su faire évoluer leur discipline).
La politique universitaire de la République a contribué à accentuer la concurrence entre les facultés de droit. La création de nouvelles facultés d’État et, suite à la loi sur la liberté de l’enseignement supérieur de 1875, de nouvelles institutions libres (facultés catholiques, écoles municipales, institutions privées) augmentent l’offre pédagogique. Pour satisfaire leurs stratégies de carrières et/ou de réussites, les étudiants et les professeurs voient s’accroître sensiblement leurs choix d’institutions, de cours, de formations, de postes. Les conditions matérielles s’en trouvent améliorées : de nombreux bâtiments sont rénovés et des bibliothèques sont ouvertes ou agrandies. Face aux évolutions sociales et économiques, aux transformations de l’État, aux demandes de certification professionnelle des familles, le gouvernement multiplie et généralise alors les matières enseignées. Jusqu’alors tournée vers le droit civil, la formation s’enrichit de cours dans les domaines de l’histoire du droit, de l’économie politique, du droit constitutionnel, du droit administratif, de la législation coloniale, etc. Les facultés de droit n’entendent pas être de simples écoles professionnelles mais des institutions de haute culture où se transmettent « l’esprit juriste » et des principes fondamentaux. Des moyens de financement (par exemple, grâce à des fondations universitaires ou des municipalités), nouvellement proposés, permettent de compléter l’offre en fonction des besoins locaux et proposent une série de cours complémentaires, de cours libres ou de conférences facultatives (en petits groupes). Naturellement, les ressources parisiennes sont beaucoup plus importantes que celles des autres facultés mais ces dernières tentent d’en user astucieusement au service d’une politique plus ou moins ambitieuse et cohérente. À Toulouse, l’aide étatique permet de créer des cours complémentaires (Pandectes, droit international, histoire du droit, etc.) ; de la même manière, la ville a pris, pendant quelques années, en charge des cours de droit maritime, de législation et d’économie rurales ou de droit civil comparé. L’Université méridionale elle-même institue des cours de science pénitentiaire et de science sociale. En matière pédagogique et scientifique, la faculté parisienne, quant à elle, restée très attachée à une culture classique, s’est souvent montrée frileuse, suivant (subissant fréquemment) les évolutions plutôt que les devançant. En dépit de sa position privilégiée, elle n’a pas vraiment défini de politique internationale, ne cherche pas à renforcer les enseignements pratiques et ne manifeste que marginalement un souci d’ouverture vers l’extérieur. Sans même évoquer l’installation d’une faculté catholique de droit, les professeurs parisiens devront néanmoins faire face à la concurrence de l’École libre des sciences politiques (1872) et l’École des hautes études commerciales (1881). Cette concurrence n’exclut pas, pour les professeurs comme les étudiants, des passerelles entre ces institutions. Reste que Paris, plus que toute autre faculté, est mise en demeure de se (re-)positionner sur le marché des concours administratifs et de la préparation des cadres de la nation. Toulouse et les autres facultés hexagonales prennent naturellement leur part au développement de ces « sciences de gouvernement » (incarné par l’enseignement de l’économie politique). La faculté toulousaine offre symboliquement une bourse destinée à envoyer un étudiant brillant à l’École libre des sciences politiques. Le droit public connaît alors un véritable essor facilité, en 1896, par le sectionnement de l’agrégation (constitution d’une communauté de spécialistes de droit public, avec ses outils savants et éducatifs spécifiques, attentive au travail du Conseil d’État). Certains professeurs parisiens endossent même, sans états d’âme, les habits de légistes de l’État républicain, gardiens de ses principes et de ses valeurs. Malgré l’ouverture de quelques cours libres (à Paris, Toulouse, Bordeaux ou Nancy) et les efforts de certains juristes, la « science sociale » (c’est-à-dire la sociologie naissante) reste le plus souvent aux portes de facultés juridiques réticentes. Il n’en faudra pas moins pour que les facultés de lettres et quelques institutions parisiennes (Collège libre des sciences sociales, École des hautes études sociales) revendiquent, autour de 1900, ce territoire, sa démarche et ses résultats.
Bien plus que la concurrence parisienne (trop distante), la faculté de Toulouse subit surtout celle de rivales provinciales. Elle doit, en effet, faire face à la création des facultés de Bordeaux (1870) et de Montpellier (1878). Ces institutions réduisent à la fois son bassin de recrutement dans le Midi mais également les revenus qu’elle peut espérer tirer de l’afflux des étudiants. Une faculté catholique de droit voit même brièvement le jour. Après 1900, le doyen toulousain et ses collègues s’inquiètent également de l’apparition des écoles supérieures de droit à Limoges (1909) et à Clermont-Ferrand (1913). Leur corps enseignant est composé principalement d’avocats. Elles sont financées par des municipalités soucieuses de satisfaire les familles qui souhaitaient garantir l’avenir de leur progéniture sans exil ni coûts inutiles. À cette concurrence jugée parfois déloyale s’ajoute, vis-à-vis de Paris, la crainte d’un déclassement, celle d’être distanciée, voire « provincialisée » dans un espace académique qui se nationalise toujours fortement (on connaît à la même époque la tension entre « petites patries » et État national). Car l’ambition toulousaine est bel et bien de combiner son ancienne tradition juridique (nourrie de son histoire occitane) dont elle revendique la singularité et sa capacité à demeurer l’autre grande faculté de droit française, capable d’apporter la contradiction à la première d’entre elles. En somme, être non pas seulement une faculté provinciale mais une faculté ayant une ambition nationale en province. Équation délicate. Durant son long décanat, Maurice Hauriou ne cesse de courir après cette ambition qui permettrait à sa faculté de concilier tradition et modernité, de tenir d’une manière crédible son rang. Le modèle allemand n’est pas très loin. Non pas de jouer à parts égales avec Paris (comment la faculté le pourrait-elle ?) mais d’être une faculté de droit à part entière, soucieuse de la qualité des études, de la valeur des enseignants, de la réputation scientifique et pédagogique de l’institution, de ses relations avec les mondes professionnels (par exemple, la faculté fonde en 1905 un institut technique du droit, comprenant une école du notariat et une école pratique du droit).
Conflits
Faut-il se résigner à cette domination parisienne ? Les facultés de province sont de moins en moins enclines à être traitées par le ministère comme des institutions de « seconde zone ». Le sentiment persistant d’être mal traité par les gouvernements successifs et d’être quelque peu méprisé par des collègues parisiens, richement dotés et bénéficiant d’avantages substantiels, les conduisent à envisager d’agir collectivement pour défendre leurs intérêts. De fait, l’initiative en faveur d’une action collective provinciale part de Toulouse. Professeur aux travaux de droit administratif réputés, Maurice Hauriou projette, en 1904, la création d’une association des membres des facultés de droit destinée à rapprocher les facultés de province des centres du pouvoir (à commencer par le ministère) pour être en mesure de peser sur leur propre destinée. Le but est à la fois d’aboutir à une amélioration globale du statut des professeurs de province (n’oublions pas que le traitement des provinciaux est nettement inférieur à celui des parisiens) mais également à leur meilleure représentation dans les différents comités, jurys, etc., systématiquement dominés par la faculté parisienne. Ce projet obtient alors le soutien de treize collègues issus de disciplines plus périphériques et qui ambitionnent de contester le modèle d’excellence civiliste et judiciaire. Ce projet finit par échouer face à la résistance des parisiens et de la frange plus traditionnelle (attachée à cette orthodoxie civiliste et judiciaire) des provinciaux. L’initiative toulousaine ne sera pourtant pas inutile. Cette création d’une Association des membres des facultés de droit voit le jour en 1909 sur de nouvelles bases, plus consensuelles et inclusives (les parisiens et le modèle civiliste y sont moins stigmatisés). Pourtant, la faculté parisienne observe avec méfiance cette association destinée à la défense des intérêts communs mais qui offre aux porte-paroles des provinciaux une tribune pour contester le centralisme et la captation des ressources (humaines, financières, symboliques, etc.) par la capitale. Le patronage (pour ne pas dire la récupération) par les enseignants parisiens de grandes opérations collectives se révèlent, en réalité, une condition de leur viabilité ou de leur réussite. Déjà, en 1901, le civiliste nancéen François Gény regrettait que la jeune Société d’études législatives, imaginée à l’origine par lui et quelques autres comme un instrument pour animer la réflexion méthodologique et scientifique en province, se soit transformée en think tank au service du pouvoir et des ambitions parisiennes.
Les facultés de province avaient, sans aucun doute, quelques raisons légitimes de dénoncer l’attitude de leur tutelle et de la faculté parisienne. Hauriou sut capter le mécontentement croissant d’une partie de ses collègues. Il enclenche, le premier, un mouvement collectif de protestations qui ira se fortifiant ; après la Grande Guerre, les dissensions entre Paris et province se feront de moins en moins discrètes, notamment sur la question des traitements des professeurs de droit. Les conflits n’iront pas pour autant jusqu’à la rupture et l’unité du corps (même larvée) prévaudra. Au-delà des déclarations martiales, Hauriou, devenu président du jury d’agrégation en 1920, recrute avec ses collègues, deux provinciaux… et trois parisiens. Plutôt qu’un affrontement direct avec Paris, les facultés de province préféreront (la liste n’est pas exhaustive) le plus souvent des stratégies de territorialisation (par exemple, en faisant exister localement des « écoles doctrinales ») ou d’internationalisation (en investissant les congrès internationaux ou en enseignant à l’étranger). À la veille de la Grande Guerre, Toulouse, via Maurice Hauriou, incarne cette époque des « cathédrales doctrinales » quand Paris, de son côté, continue à se rêver en rectrice de la vie juridique nationale.
Frédéric Audren, directeur de recherche au CNRS, chercheur du Centre d’études européennes (CEE – CNRS), research professor à l’École de droit de Sciences Po
Indications bibliographiques
Burney John M., Toulouse et son université : facultés et étudiants dans la France provinciale du 19e siècle, « Midi-Pyrénées », France, Paris : CNRS, Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 1988.
Charle Christophe, « La toge ou la robe ? Les professeurs de la faculté de droit de Paris à la Belle Époque », dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 7, 1988, p. 167‑175.
—, « Élite universitaire ou élite sociale ? Les professeurs de la faculté de droit de Paris (1901-1932) », dans Jürgen Schriewer, Edwin Keiner, Christophe Charle (dir.), Sozialer Raum und akademische Kulturen : studien zur europäischen Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. À la recherche de l’espace universitaire européen : études sur l’enseignement supérieur aux xixe et xxe siècles, Frankfurt am Main, Berlin, Allemagne, Paris, France [etc.], Peter Lang, 1993, p. 45‑59.
Devaux Olivier, Garnier Florent, Ceux de la faculté : des juristes toulousains dans la Grande Guerre, « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », no 24, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2017.
Halpérin Jean-Louis (dir.), Paris, capitale juridique. 1804-1950 : étude de socio-histoire sur la faculté de droit de Paris, Paris, France, Rue d’Ulm, 2011.
MiletMarc, Les professeurs de droit citoyens : entre ordre juridique et espace public, contribution à l’étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français (1914-1995), [Chapitre 1 : 1914-1918], Thèse de doctorat, soutenue à l’Université Panthéon-Assas, 2000, 791 p. (dactyl.).
Sacriste Guillaume, La République des constitutionnalistes : professeurs de droit et légitimation de l’État en France (1870-1914), Paris, France, Presses de Sciences Po, 2011.
Université Toulouse-1-Capitole, « Le rôle de la faculté de droit de Toulouse dans la rénovation des études juridiques et historiques aux xixe et xxe siècles », dans Annales de l’université des sciences sociales de Toulouse, vol. 24, no fasc. 1 et 2, 1976, p. 343‑384.
Verger Jacques (dir.), Histoire des universités en France, « Bibliothèque historique Privat », Toulouse, France, Privat, 1986.