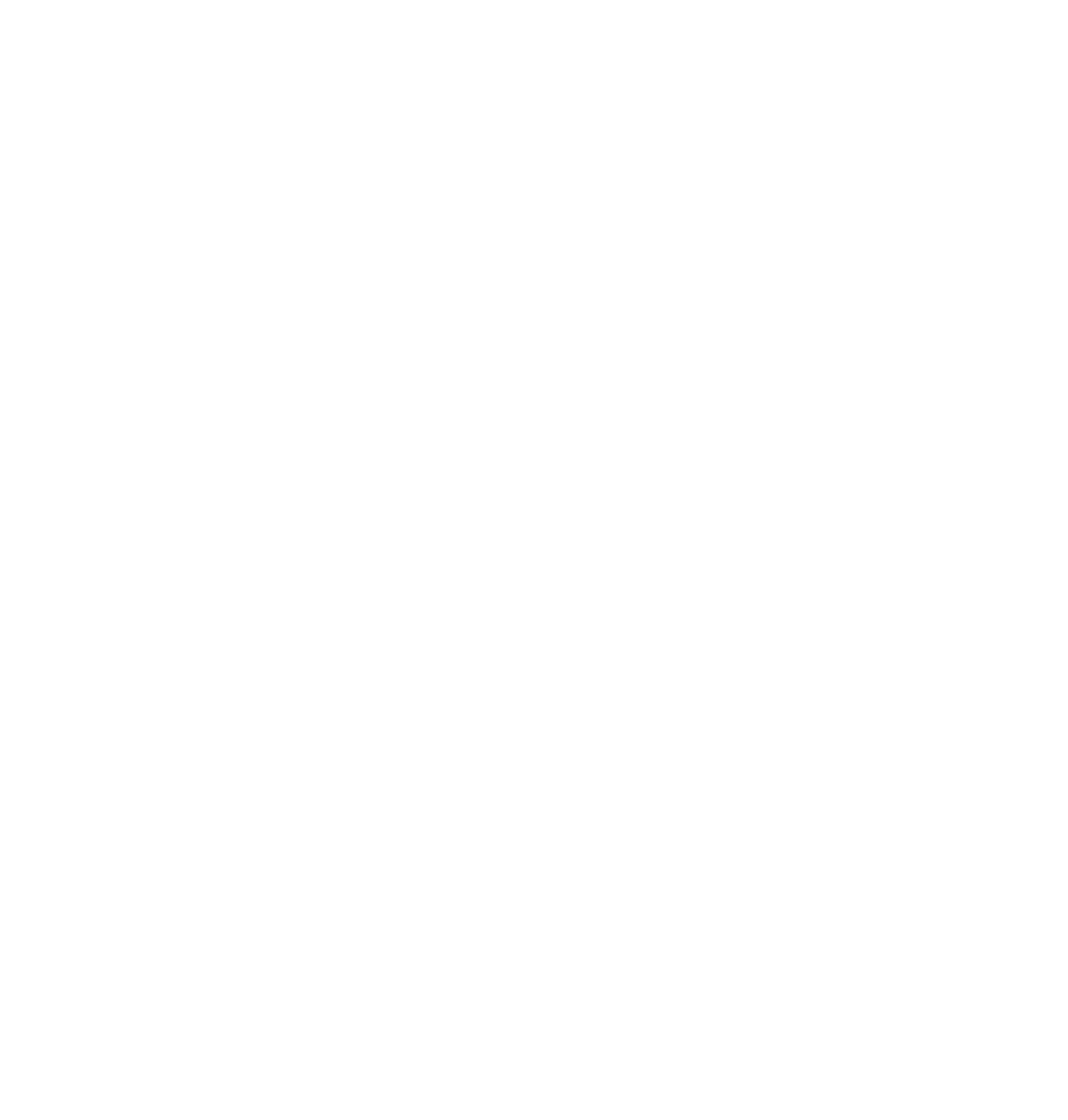La plaque commémorative, aujourd’hui installée, face à l’entrée, dans le plus grand hall de la faculté de droit de Lille n’attire pas les regards. Elle s’offre pourtant à la vue dans un lieu de passage, à la fois depuis le sol et depuis les coursives, en particulier de celle sur laquelle s’ouvre la salle des actes où l’on se presse lors des soutenances de thèses. Certes la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale a provoqué un regain d’intérêt pour ce monument, mais il n’a absolument rien à voir avec l’émotion qui étreignait tous ceux qui, au lendemain du conflit, levaient les yeux vers l’impressionnante liste de noms gravés dans le marbre.
La mort de masse
Lors de la rentrée 1913-1914, ils étaient 351 étudiants. À la première rentrée après l’armistice, le 5 janvier 1919, on n’en compte que 105 : certains n’ont pas encore rejoint une région fortement sinistrée, les mobilisés ne sont pas encore de retour et il y a ceux qui ne reviendront pas. Au plan des effectifs, la situation est confuse. Pour faire le point, en mars 1919, le doyen Eustache Pilon lance une enquête auprès des familles. Elle révèle le décès certain de 54 étudiants (44 au front, 9 des suites de leurs blessures, 1 de maladie) et 11 sont portés disparus. Sont-ils morts ? Ont-ils été faits prisonniers ? Tant que les derniers captifs ne sont pas rentrés, l’espoir demeure même s’il est raisonnable, à ce moment-là, d’estimer la mortalité totale à 65 étudiants. En outre, la guerre abrège prématurément des vies, et sur les 30 blessés que recense l’enquête, combien survivront à leurs blessures ? Les historiens l’ont montré, le nombre exact des morts de la Grande Guerre est impossible à déterminer. Le décompte de ce que l’on appelle les « Morts pour la France » qui, pour être cernable, correspond à ceux qui ont perdu la vie entre deux dates butoirs fixées par la loi, est distinct de celui des « morts de la Grande Guerre ». Il lui est sensiblement inférieur, car on meurt de la guerre bien longtemps après, même si les proches ont de plus en plus de difficulté à l’établir, car le budget de la France peine à assumer les conséquences du conflit. Le nombre de noms gravés dans le marbre à la faculté de Lille s’élève à 82, il est de 17 étudiants supérieur au décompte du doyen. Les règles ayant présidé à l’élaboration de la liste définitive nous sont inconnues. Il apparaît cependant clairement qu’aux étudiants en cours d’études ont été ajoutés un certain nombre d’anciens étudiants, en l’occurrence des avocats. On peut s’interroger sur la tendance des diverses institutions à majorer un décompte macabre pourtant déjà impressionnant. Ainsi, certains étudiants figurent aussi sur la plaque de leur lycée, de leur paroisse. Chaque institution, après la guerre, s’applique à montrer, à travers les deuils recensés, combien elle s’est impliquée dans le conflit. En l’occurrence, ils prouvent que les étudiants en droit, issus à cette époque des milieux favorisés, n’étaient pas des embusqués, ils ont largement donné leur part au sacrifice national. Ils se sont en outre montrés particulièrement courageux comme l’attestent les médailles et citations obtenues dont font état les discours de commémoration en n’omettant jamais d’énoncer, en un véritable palmarès, leur nombre cumulé : la moisson de gloire rejaillit sur l’institution.
Hormis l’ampleur du sacrifice consenti par la faculté, la plaque ne nous dit rien. Elle est silence. Pourtant, au-delà de la froideur du marbre, froideur de la mort, de l’aspect hiératique et imposant des noms alignés qui laissent sans voix, le vivant réside dans le bruit et la fournaise de la guerre. Le retrouver implique de changer d‘échelle, de passer de la mort de masse aux destins individuels – autant l’esprit qui a animé ces étudiants que l’expérience concrète qu’ils ont vécue.
L’horizon psychologique des étudiants en août 1914
On ne peut comprendre comment ces étudiants sont entrés en guerre si on ne considère pas l’importance de la culture de guerre qui les a construits et a nourri leur imaginaire. Elle se met en place après la défaite humiliante de 1870 et s’avère particulièrement efficace à les rendre patriotes et militaristes, prêts à perdre la vie pour la France. L’éducation joue un rôle majeur dans la construction des citoyens-soldats à travers l’enseignement de l’histoire, celle d’une France finalement parfaite, au-delà de quelques « détails ». Les étudiants qui vont combattre vivent dans une « nation armée » qui se déclare pacifiste tout en se préparant à répondre aux agressions. Concrètement, les bataillons scolaires commencent à entrainer les enfants, avant que le service militaire n’en fasse de vrais soldats. En 1905, la conscription a été généralisée et, en 1914, chaque Français est redevable du service militaire pendant 28 ans. Après le service d’active (la loi Barthou vient de le porter de 2 à 3 ans), le citoyen-soldat est versé dans la réserve de l’armée active, puis dans l’armée territoriale, et enfin dans la réserve de l’armée territoriale. Pour que le dispositif fonctionne correctement en cas de guerre, le Français doit accomplir régulièrement des périodes d’exercices. L’armée tient alors une grande place dans la vie sociale. Sa réorganisation a dessiné un maillage du territoire en 18 régions militaires, ce qui la rend proche de la population : 221 villes abritent une garnison. Lille est siège de la 1ère région et, pour le Nord, le 43ème RI tient ses quartiers à Lille dans la caserne Vandamme, le 127ème à Valenciennes et Condé-sur-Escaut, le 1er à Cambrai, le 84ème à Avesnes, enfin le 110ème à Dunkerque. Un régiment compte environ 3 000 hommes. Les militaires font par conséquent partie du paysage, comme dans les défilés, musique en tête. Chaque année, la presse rend compte abondamment des grandes manœuvres à travers articles, photos et numéros spéciaux. Les chefs militaires, que les conquêtes coloniales valorisent, sont vénérés et contribuent au prestige de l’armée. Les couleurs et l’élégance de l’uniforme de l’infanterie, pantalon rouge et veste bleue, ajoutent au prestige de l’état militaire. Enfin, l’imaginaire de la guerre la rend exaltante. Si guerre il y a, selon le discours officiel elle sera offensive et les officiers y tiendront un rôle majeur en menant leurs hommes à l’assaut. Il n’est guère étonnant que les étudiants en droit soient nombreux à suivre les préparations qui permettent de devenir officier. Ainsi donc, à la veille du conflit, indépendamment des clivages politiques, le concept de nation armée est admis et annonce le consentement, voire l’adhésion, à la guerre. Chaque homme détient un livret militaire contenant une feuille de route qui lui dicte la marche à suivre en cas de mobilisation. La France se donne l’impression d’être prête à vaincre tout ennemi. S’il le faut, le canon de 75, doté des derniers perfectionnements qui le rendent rapide et mobile, appuiera la victoire des combattants. En objet de la fierté nationale, il jouit d’un véritable culte. La perspective d’une guerre qui s’annonce très rapidement victorieuse, les militaires l’assurent, conforte la confiance.
Les conditions dans lesquelles la guerre se déroule au cours des premières semaines renforcent la détermination des étudiants en droit à combattre. Dans l’absolu, l’Allemagne peut estimer, tout autant que la France, qu’elle mène une guerre juste. Dans les faits, elle viole immédiatement le droit en envahissant la Belgique et ses armées exercent sur leur passage des violences graves à l’égard des civils. L’État-Major allemand n’a, en réalité, jamais adhéré aux arguties des juristes, couchées dans les conventions, y compris de leurs compatriotes. Ce n’était un mystère pour personne : il estime que la guerre met le droit entre parenthèses pour faire place aux « nécessités militaires » qui permettent de la gagner. Les étudiants en droit, comme plus généralement les juristes, se sentent particulièrement concernés par ce mépris du Droit. Dans l’imaginaire d’une croisade menée contre des barbares pour la civilisation dont le Droit est l’emblème, ils partent indignés par la violation des traités et fortement motivés par l’urgence de la défense du territoire. Individuellement, ils veulent croire qu’ils échapperont à la mort, car elle reste théorique jusqu’à ce qu’elle soit effective.
Retrouver la mort vécue
La plaque fixe la mort, mais ne la raconte pas. Il faut déployer de sérieux efforts de recherche pour s’approcher, sinon retrouver, des éléments concrets du vécu de chacun. Le travail effectué, l’analyse des destinées individuelles permet de constater que rien ne rend spécifique la mort des étudiants en droit par rapport à celles des autres combattants. Elle vient vérifier que dans cette guerre, démocratique – au sens où peu d’affectations spéciales ont mis leurs bénéficiaires à l’abri -, la mort frappe en priorité les plus jeunes (armée d’active et réserve de l’armée d’active), l’infanterie, les sous-officiers et officiers subalternes. Les étudiants en droit, comme leurs congénères des autres disciplines, cumulent les trois critères.
L’étude des parcours individuels révèle que les étudiants figurant sur la plaque appartiennent pour la quasi-totalité à l’infanterie (94 %). À 70 %, ils sont gradés : 60 % sont officiers ou sous-officiers (lieutenants, sous-lieutenants, sergents) et par conséquent, placés à la tête d’unités de combat qui, selon le grade, varie de 15 (escouade du caporal) à 60 hommes (section du lieutenant). Enfin, parce qu’ils sont jeunes, ils relèvent à 84 % de l’armée active et de sa réserve. Ils partent donc dès le décret de mobilisation et connaissent l’hécatombe des premiers mois de guerre. En fait partie le caporal Raymond Delpierre, disparu aux violents combats d’Hastière en Belgique le 23 août 1914, alors que son unité était venue en renfort de l’armée belge pour empêcher les Allemands de franchir la Meuse. Ils sont trois à tomber au cours de la bataille de Guise : Raymond Lixon, Albert Merchier et Albert Lembrez, ces deux derniers le même jour (30 août) à Sains-Richaumont. La bataille de la Marne (6-13 septembre) ayant stoppé la progression allemande, une involontaire course à la mer s’engage, produit des tentatives de contournement de l’armée adverse. La région d’Ypres en Belgique en constitue un moment fort. Frédéric Bouclet tombe à Zillebeke, le 6 novembre 1914. Beaucoup parmi ceux qui survivent sont tués au cours des offensives de l’année 1915, presque tous sur le front de Champagne-Argonne-Woëvre. Les noms de Minaucourt, de Mesnil et Perthe-les-Hurlus, des fermes de Beauséjour et de Navarin n’évoquent plus rien pour nous, ils résonnent alors dramatiquement pour les familles car ils ensevelissent un quart des étudiants. Au total, fin 1915, 66 % des étudiants figurant sur la plaque sont morts, dont 10 % au cours du premier mois de la guerre, illustration parfaite de la mortalité des élites en général, car en raison de leur grade, ces étudiants sont à la tête des assauts meurtriers.
Ceux que le conflit va engloutir par la suite ont traversé toutes ces épreuves avant de connaître Verdun ou la Somme. Verdun et la Somme ; ces deux batailles s’étalent sur tout le deuxième semestre 1916. « L’enfer » de Verdun se décline à travers des lieux emblématiques comme Douaumont, Fleury, le Mort-Homme, la côte du Poivre et bien d’autres. L’aspirant Georges Blavier n’a pas la gloire qui s’attache aux chasseurs du colonel Driant. Pourtant, il fait partie de la compagnie du 165ème RI mise à la disposition de ces derniers lorsqu’ils essuient, le 21 février 1916, au nord de Verdun, dans le bois des Caures, les premiers assauts de la gigantesque offensive de l’armée allemande. On ignore quand il tombe entre le 21 et le 24 février, au cours de cette attaque dont peu réchappent, un jugement fixera le décès au 23. Quelques jours plus tard, Gustave Poullet est tué à Fleury, un village dont il ne restera rien. Albert Cambier et Marius Dournel tombent le même jour, 20 mai 1916, au Mort-Homme. Désiré Nison le 21 juin à Douaumont. Le sous-lieutenant Jacques de Riols de Fonclare, qui avait choisi le droit de préférence à l’armée, fils du général qui commande à Verdun la 1ère division, à laquelle appartient son régiment (127èmeRI), ne survit pas aux blessures reçues lors des combats d’avril à la côte du Poivre attestant que le deuil de guerre n’épargne pas la haute hiérarchie militaire. Sur ses six fils combattants, le général de Castelnau n’en avait-il pas déjà perdu trois ? La bataille de la Somme, déclenchée le 1er juillet 1916, fauche entre autres, dès le 20, Georges Saintoyant, le 6 septembre Edgard Godard et André Goubet, le 16 Marcel Cappon, le 25 Paul Faille, le 26 Jean Poussart. Au total, les deux grandes batailles de l’année 1916 ont tué plus du quart des étudiants qui figurent sur la plaque. Les années 1917 et 1918 sont comparativement moins meurtrières (18 % des morts pour les deux années), marquées par les combats du Chemin des Dames, l’offensive de l’été 1918 dont l’issue favorable provoque le reflux progressif des armées allemandes, et par la grippe espagnole qui provoque à travers le monde bien plus de morts que la guerre, et dont meurent, parmi les 400 000 Français, Eugène Torrez et Antoine Bianconi.
Le deuil inversé
La France est victorieuse, mais ainsi que l’exprime le doyen Pilon : « La joie n’apparut pas cependant radieuse au fond des cœurs. » La charge émotionnelle de la rentrée 1919 est lourde. On pleure les morts indubitables et on veut encore espérer le retour des disparus, presque aussi nombreux, parmi les derniers prisonniers libérés, comme celui d’Albert Cambier, présumé capturé en mai 1916 à Verdun. Vaine attente, il ne reviendra pas.
Les morts dont les corps ont été retrouvés ont parfois été récupérés par les familles, dans leur immense majorité, ils gisent dans les grandes nécropoles nationales que les proches peuvent visiter pour s’y recueillir. Mais tel n’est pas le cas de toutes les familles. Un tiers des morts de la faculté sont des disparus. En ce qui les concerne, aucun corps n’a été retrouvé et aucun acte de décès ne peut être établi. En 1920 et 1921, des jugements en tiendront lieu et seront transcrits sur les registres d’état civil. On les considèrera alors pour véritablement, c’est-à-dire juridiquement, morts. Pour les proches, cette reconnaissance sociale de la mort conditionne les droits à pension et facilite le deuil. On peut classer les disparus en deux catégories. Certains ont été tués pendant la guerre de mouvement au cours des premières semaines du conflit. Le souci des armées est de progresser, pas de gérer les morts. Les corps sont donc laissés sur le terrain et enterrés ultérieurement lorsque les combats s’éloignent, plus ou moins longtemps après et généralement à proximité du lieu où ils sont trouvés. C’est ainsi que le corps d’Albert Marchier, porté disparu en 1914, est retrouvé en 1917 après le repli stratégique allemand du printemps. Après l’armistice, on retrouve les corps de Raymond Manier, disparu en octobre 1915, et celui de Maurice Vallas, fils du professeur Louis Vallas, disparu en septembre 1918. Leur corps est alors inhumé dans une nécropole donnant la possibilité aux familles de se rendre sur la tombe. Depuis la guerre, chaque année, on exhume de nouveaux corps et on estime à plusieurs dizaines de milliers ceux qui restent encore enfouis sur la ligne de front. Il est des corps que l’on ne retrouvera jamais. Ceux qui ont été brûlés, pratique attestée par des témoignages, et qui, si elle n’a pas été généralisée, n’en a pas moins existé. Ceux surtout qui ont été déchiquetés par les obus de l’artillerie lourde et dont il n’est resté, au mieux, que des débris recueillis et regroupés dans les multiples ossuaires des grands cimetières militaires. Outre le nettoyage des zones de combat, impératif d’après-guerre pour pouvoir rendre les sols à l’agriculture, il s’est agi de donner aux familles la possibilité d’imaginer que dans la tombe collective, l’ossuaire, se trouvent les restes de leur défunt. On peut s’étonner du nombre précis de corps inscrit sur les ossuaires. Ainsi dans l’ossuaire n°6 de la nécropole de Minaucourt, peut-on croire ou espérer que se trouvent, sur la base de « deux tibias comptent pour un homme » et parmi les 4 446 corps « français » regroupés, les restes des étudiants qui sont tombés dans ce secteur, comme Maurice Gouvion ou Paul Salandre. Le grand nombre de disparus explique pourquoi les plaques commémoratives et les monuments se multiplient partout. À défaut de corps, ils apportent de la matière et rassemblent dans un deuil collectif qui peut être partagé.
Avec la guerre, l’insoutenable s’est produit : les fils sont morts avant les pères et le deuil normal, inversé, est d’autant plus difficile à accomplir. Prolongement de cette inversion, les paroles du doyen Pilon prononcées à l’occasion de la rentrée 1919 sont explicites : les étudiants, par l’effet de la guerre et surtout de leur mort, sont promus professeurs : « Honneur à ces héros ! Ils étaient venus chez nous en élèves pour apprendre le Droit. Et tout d’un coup, ils sont devenus des maîtres, ils ont donné au monde la grande leçon de droit en offrant leur vie pour la cause du Droit. »
Les paroles ont été oubliées. Sorties de l’oubli, sans être replacées dans leur contexte, elles semblent même étranges. L’émotion n’étreint plus les très rares personnes qui s’arrêtent pour regarder la plaque. Néanmoins la faculté y tient et ce marbre austère est de toutes ses pérégrinations. De la rue Angellier à la rue Paul Duez, de celle-ci au campus de Villeneuve d’Ascq, elle est aujourd’hui revenue à Lille dans les locaux actuels de la place Déliot.
Annie Deperchin, Chercheur associé Centre d’Histoire judiciaire (UMR 8025), Université de Lille, Centre international de recherche de la Grande Guerre
Indications bibliographiques
Audoin-Rouzeau Stéphane, Les armes et la chair : trois objets de mort en 1914-1918, Paris, France, A. Colin, 2009.
Audoin-Rouzeau Stéphane, Becker Jean-Jacques (dir.), Encyclopédie de la Grande guerre, 1914-1918 : histoire et culture, Bayard Edition, Montrouge, France, 2013.
Barbusse Henri, Le feu : journal d’une escouade, Paris, France, E. Flammarion, 1916.
Beaupré Nicolas, Jones Heather, Rasmussen Anne (dir.), Dans la guerre 1914-1918 : accepter, endurer, refuser, Paris, France, Les Belles Lettres, 2015.
Dorgelès Roland, Les croix de bois, Paris, France, Albin Michel, 1919.
Genevoix Maurice, Ceux de 14, Paris, France, Flammarion, 2013.
Homer Isabelle, Pénicaut Emmanuel (dir.), Le soldat et la mort dans la Grande Guerre, Rennes, France, Presses universitaires de Rennes, 2016.
Le Naour Jean-Yves, 1914 : la grande illusion, Paris, France, Perrin, 2012.
—, 1915 : l’enlisement, Paris, France, Perrin, 2013.
—, 1916 : l’enfer, Paris, France, Perrin, 2014.
—, 1917 : la paix impossible, Paris, France, Perrin, 2015.
—, 1918 : l’étrange victoire, Paris, France, Perrin, 2016.