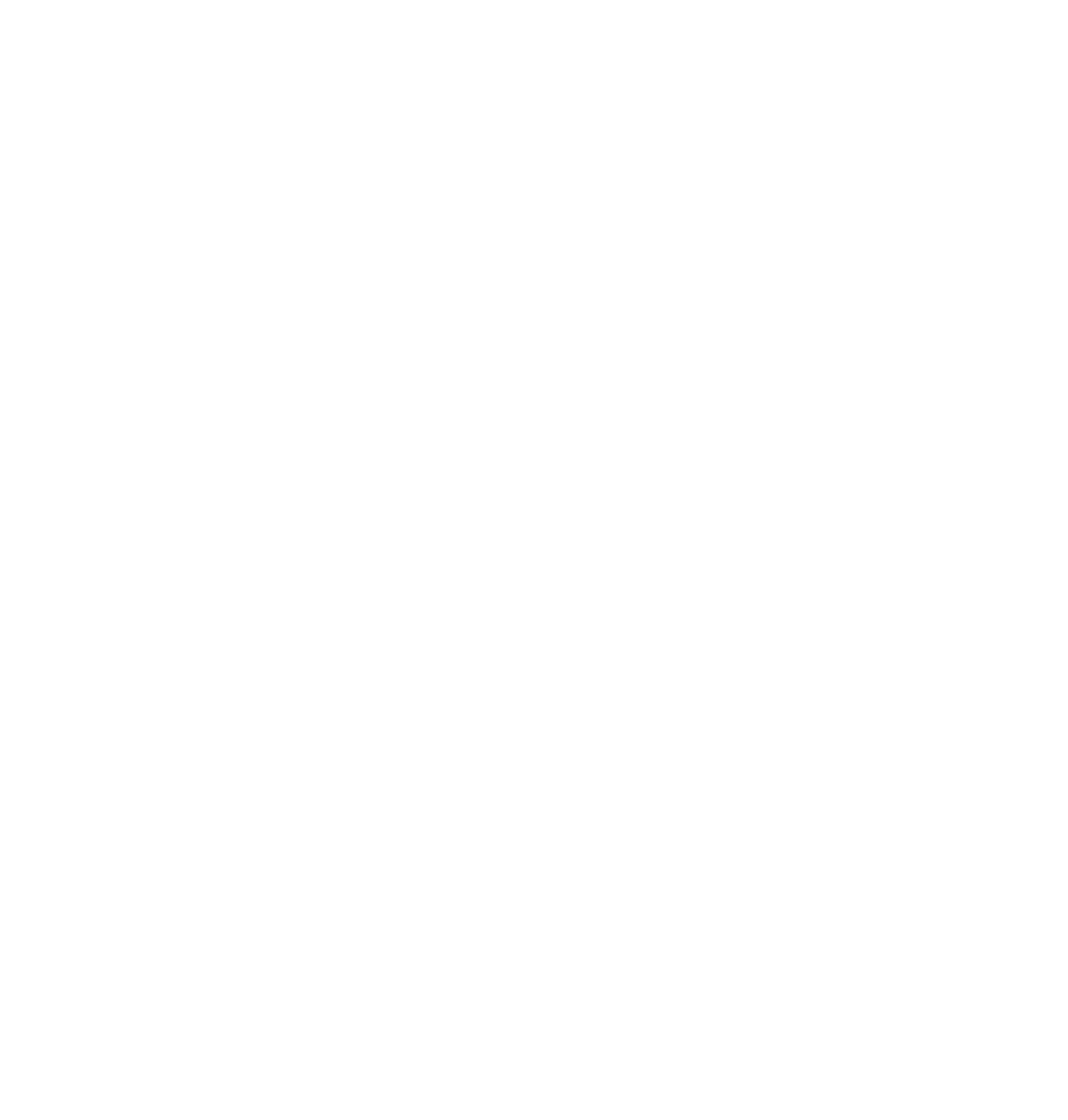L’invasion allemande, au mois d’août 1914, est bientôt suivie de l’occupation de la plus grande partie du pays. Le contexte de guerre et l’occupation font obstacle à la reprise des cours : une partie des professeurs et des étudiants sont partis ou sont sur le front. À Louvain, le sac de la ville, le massacre et l’incendie de la bibliothèque universitaire forment un obstacle majeur. À Liège, le saccage des locaux de l’université empêche toute reprise dans des conditions « normales ». Ces circonstances conduisent les quatre universités que compte alors la Belgique, les universités d’État de Liège et de Gand ainsi que les universités libres de Bruxelles et de Louvain, à fermer leurs portes. À l’université libre de Bruxelles, la séance de rentrée académique, prévue le 14 octobre 1914, n’aura pas lieu. Le conseil d’administration de l’université prend la décision, le 3 octobre 1914, de ne pas organiser la reprise des cours. Les cours sont suspendus pour une durée indéterminée.
Il reste une petite institution, à Bruxelles, qui s’appelle l’université nouvelle. Cette institution, qui est le résultat d’une dissidence de l’université libre de Bruxelles intervenue vingt ans plus tôt, en 1894, organise le doctorat dans plusieurs disciplines, dont le droit. Imprégnée par la pensée socialiste, elle est dirigée par Guillaume De Greef, avocat, l’une des figures fondatrices de la sociologie en Belgique, qui a abandonné sa charge de cours à l’université libre de Bruxelles. L’université nouvelle loue alors un immeuble rue de la Concorde, une rue perpendiculaire à l’avenue Louise, non loin du Palais de Justice. Elle accueille — dès ses débuts — ; de nombreux étudiants étrangers, venus principalement de Bulgarie, de Roumanie et de Russie. Les étudiants bulgares y forment le groupe le plus important, au point qu’on la désigne parfois sous le nom d’ « université bulgare » : sur les 393 étudiants inscrits au cours de l’année académique 1913‑1914, il n’y a pas moins de 328 étudiants qui viennent de Bulgarie. L’université nouvelle n’étant pas habilitée à délivrer des diplômes légaux — ouvrant l’accès aux professions organisées par la loi — le nombre des étudiants belges y est particulièrement faible. La faculté de droit, qui a pour doyen une figure incontournable du monde judiciaire bruxellois, Edmond Picard, compte donc surtout des étudiants étrangers. Mais la guerre et l’occupation, qui s’accompagnent de la fermeture des principales universités du pays, bouleversent la situation et lui donnent une nouvelle attractivité.
La reprise des cours est annoncée dès le mois de septembre. Le secrétaire général de l’université, Joseph Octors, bat le rappel des professeurs. Les étudiants s’inscrivent, mais les professeurs — ou certains d’entre eux — ne sont pas là. Il y a ceux qui ne sont pas en Belgique, qui ne rentreront pas. Il y a ceux qu’on attend, qui devraient rentrer, comme Henri La Fontaine, auquel est décerné le prix Nobel de la Paix, à peine quelques mois plus tôt, au mois de décembre 1913. Mais il y a aussi ceux qui sont à Bruxelles, et qui tardent à reprendre leurs enseignements, comme Bön, Sasserath, ou Des Cressonnières. La reprise des cours dans le contexte de guerre et d’occupation n’est pas une évidence pour tout le monde. Joseph Octors écrit à Simon Sasserath. Est‑ce que Sasserath hésite ? « Je vous avoue que je considère la reprise des cours, qui ne peut être que partielle, comme une tentative sans grand intérêt ». Il en est de même de Des Cressonnières, qui s’interroge : « Si vraiment l’université trouve qu’il est opportun de reprendre les cours, je suis disposé à reprendre le mien (…) ». Dans sa correspondance, le secrétaire de l’université se fait l’écho de la décision du Comité : « Malgré les circonstances nous avons estimé qu’il n’y avait aucune raison de ne pas reprendre cette année le travail des facultés ». Il communique le chiffre des inscriptions, en cette fin du mois d’octobre : « une quarantaine d’étudiants sont prêts à suivre les cours ». Il y a aussi cette justification qui est relayée : la reprise des cours s’impose pour permettre aux étudiants bulgares de demeurer en Belgique. Ils ne sont autorisés à ne pas rentrer en Bulgarie qu’à la condition d’être inscrit à l’université. Il s’agit surtout de « permettre aux étudiants étrangers de parachever leurs études ».
Mais quid des étudiants belges ? Comment justifier la reprise des cours, alors que tant d’étudiants ont été appelés sous les drapeaux, et que les universités ont suspendus leurs enseignements ? Le comité central de l’université nouvelle est convaincu de la légitimité de sa mission. En octobre 1915, ce qui s’impose, c’est une poursuite des enseignements « en vue d’éviter aux jeunes gens et aux jeunes filles de rester oisifs ». L’université relève que les cours de la faculté des sciences sociales, de la faculté de sciences économiques et financières et de la faculté de droit se sont fait régulièrement et ont été suivis par un grand nombre d’étudiants belges et étrangers. Ce discours s’accompagne d’un élément de prudence, d’une précaution bien nécessaire : les étudiants ne seront pas admis à subir les examens légaux. Aux étudiants qui s’inscrivent, comme aux professeurs, le message qui est transmis est clair : « il s’agit dans notre pensée de permettre uniquement à ces élèves de se livrer à une occupation intellectuelle sans autre profit pour eux que de ne pas perdre le fruit de leurs études qu’ils viennent de finir ».
Le « bassin de recrutement » de l’université nouvelle s’étend, bien entendu. La part des étudiants étrangers diminue, celle des étudiants bruxellois augmente. Ils ne viennent pas seulement de Bruxelles, mais de plus loin. Avec la fermeture des universités de Louvain, Liège et Gand, la perspective de l’activité intellectuelle qu’offre l’université nouvelle, même si elle est non‑diplômante, attire ceux qui n’ont pas été appelés sous les drapeaux ainsi que les plus jeunes, sortis des établissements d’enseignement secondaire pendant les années de guerre. Il s’agit d’assurer une activité intellectuelle aux « jeunes gens et jeunes filles » mais en se gardant toutefois d’une publicité trop tapageuse, d’une « propagande » qui pourrait être mal perçue. Il s’agit d’offrir une forme de « service intellectuel » de manière sobre, décente. L’université, par voie de presse, s’adresse aux étudiants belges, à ceux qui ont suivi les cours l’année précédente dans l’institution ou ailleurs, dans une université d’État, ou dans l’une des universités libres du pays, ainsi qu’à tous les étudiants qui seraient porteurs d’un certificat de sortie d’un collège ou athénée. Est‑ce qu’il faut aller plus loin ? Au début du mois de juillet 1916, le secrétaire de l’université nouvelle fait part de son souhait d’adresser une lettre aux préfets, aux directeurs d’écoles moyennes, aux cercles étudiants, que ce soit à Bruxelles, Liège, Gand ou Louvain. Il se propose également d’adresser une lettre aux échevins de l’instruction publique de la ville et des communes du Grand Bruxelles. Le recteur de l’université, De Greef, intervient. Il lui semble qu’il faut éviter une « propagande trop directe qui pourrait être mal interprétée ». Une lettre circulaire est finalement adressée aux préfets des athénées de Bruxelles, d’Ixelles, et de Saint‑Gilles, mais aussi à l’athénée de Louvain, ainsi qu’aux « cours d’éducation » destinés aux jeunes filles et à l’un ou l’autre établissement privé.
Si les cours reprennent, vaille que vaille, avec une certaine hésitation de la part d’une partie du corps professoral, la guerre et l’occupation allemande imposent une série de contraintes à l’organisation des enseignements. Henri La Fontaine, dont on attendait le retour, ne revient pas et il ne reviendra plus avant la fin de la guerre. Il a quitté la Belgique pour les États‑Unis. Et pour ceux qui sont encore sur le territoire belge, en Belgique occupée, les déplacements sont devenus plus difficiles, surtout lorsqu’on vient de loin et que l’on doit traverser des zones sous contrôle renforcé, les « zones d’étapes ». C’est le cas de Van Bladel, sollicité pour reprendre son enseignement du cours de droit maritime, au mois d’octobre 1914. Le professeur Pirard, qui assurait l’enseignement du cours de droit pénal, finit par décliner également, au mois de janvier 1916. Il doit venir de Verviers. Il ne lui est « pas possible (…) de faire le voyage de Verviers par ces temps difficiles ». Les contraintes matérielles sont aussi celles de la consommation de charbon et d’électricité. Au début du mois d’octobre 1917, Octors se demande s’il sera possible d’assurer la poursuite des enseignements. La reprise des cours arrive, mais avec elle c’est aussi l’automne qui vient : « malheureusement je pense que des cours devront être supprimés, eu égard à la difficulté que rencontre l’université à se procurer du charbon ». Jusqu’au cours de l’année 1916‑1917, les cours peuvent encore se donner le soir. Mais cela aussi change au début de l’année 1917 : « La défense faite de consommer plus de 20 kwh d’électricité empêchera, au surplus, tout travail du soir ». Certains, comme Edmond Picard, entrent en résistance contre les restrictions, à leur manière, avec de petits moyens. Celui qu’on appelle familièrement l’ « Amiral », et qui est alors — également — le bâtonnier du barreau de cassation, s’éclaire pendant les cours avec une lampe portative qui lui est prêtée. La guerre perturbe également le fonctionnement de la bibliothèque. Certains ouvrages, prêtés aux étudiants, ne peuvent retrouver leur place dans les rayonnages. Tantôt parce que l’étudiant qui a emprunté le livre manquant est sous les drapeaux, tantôt parce qu’il a quitté la Belgique et a rejoint son pays d’origine dans la précipitation. Les difficultés financières liées à la guerre conduisent finalement à fermer la bibliothèque. Sa fermeture est prévue à la fin du mois de juillet 1915 : « seuls les rouages indispensables continueront, provisoirement, à fonctionner ».
En cette période de privations, l’université nouvelle prend toutefois l’initiative d’offrir des repas à ses étudiants étrangers qui sont sans ressources. Dès les premiers jours de la guerre, au début du mois d’août 1914, elle ouvre un « Réfectoire des étudiants ». Des repas sont distribués le matin et le soir. Ils nourriront de 70 à 75 étudiants par jour. Ces étudiants nécessiteux sont principalement ces étudiants bulgares qui forment le plus grand nombre des étudiants de l’université nouvelle à la veille de la guerre. L’université leur donne également de quoi pourvoir « aux besoins de leur toilette ». Cette initiative prend fin un an plus tard, au mois d’août 1915. La Bulgarie s’apprête à entrer en guerre. Elle rejoint la Triplice aux côtés de l’Allemagne, de l’Autriche‑Hongrie et de la Turquie, quelques semaines plus tard, au mois d’octobre 1915. Les étudiants bulgares sont appelés sous les drapeaux. Ils étaient, pour l’ensemble de l’université, 94 inscrits au moment de la rentrée académique de 1914. Ils ne sont plus que 13 inscrits à la rentrée 1915.
Le nombre des étudiants belges, par contre, augmente de manière significative, pour atteindre 62 inscrits. Il atteint le pic de 139 étudiants en 1916. Parmi les 58 étudiants inscrits en faculté de droit cette année‑là, on compte 32 belges, 16 russes, 8 bulgares, un turc, et un italien. Si l’augmentation du nombre des étudiants belges est assez importante, qu’en est‑il des professeurs ? Est‑ce qu’il leur a fallu le temps de la réflexion, de la digestion ? Peut‑être est‑ce aussi la poursuite de la guerre et de l’occupation qui fait évoluer les positions. Certains membres du corps professoral finissent par se retirer, non pas en raison des obstacles matériels qu’ils pourraient rencontrer, mais à la suite de leur désaccord sur la poursuite des enseignements. C’est le cas de Des Cressonnières, qui finit par prendre plus clairement position. Il écrit au recteur, au mois de juillet 1916. La réunion du comité de l’université vient d’avoir lieu, quelques jours plus tôt. La majorité de ses membres se sont prononcés pour la poursuite des enseignements pour l’année 1916‑1917. Des Cressonnières — qui fait partie des fondateurs de l’université — n’entend pas se ranger à l’avis de la majorité et présente sa démission. Il n’est pas le seul. C’est aussi le cas de Max Hallet, par ailleurs échevin des Finances de la ville de Bruxelles, qui démissionne du conseil d’administration de l’université, « [son] désaccord étant complet avec [ses] collègues au sujet de la réouverture des cours en octobre prochain ». Sasserath paraît plus incertain. Il a donné cours jusque‑là. Son enseignement a été complet en 1914‑1915, à tout le moins. Il donne quelque cours l’année suivante. Mais voilà qu’au mois de février 1917, il écrit au secrétaire de l’université pour lui faire part de ses réticences. Il n’est pas un « partisan enthousiaste de la continuation des cours », affirme‑t‑il, mais il n’a « pas voulu se montrer intransigeant ». Sa décision de poursuivre son enseignement dépend de l’assiduité des étudiants. Il considèrera le cours comme donné s’ils ne sont pas assez nombreux : « à la première leçon j’avais quatre étudiants. Dès la seconde leçon je n’en avais plus que trois. Aujourd’hui il n’y en avait plus qu’un seul ». Il conclut : « nous verrons l’année prochaine s’il y a un nombre de jeunes gens que les donations et testaments intéressent suffisamment pour que je donne à nouveau un cours complet ». Est‑ce qu’il finit par affermir sa position ? Il écrit au mois d’août 1918, à la veille de la reprise des cours : « comme vous le savez, je suis adversaire de la reprise des cours pendant la guerre ». Il répond au secrétaire de l’université qu’il s’abstiendra de donner cours. Sa réponse ne paraît plus dépendre du nombre d’étudiants qui le suivent. Certains positionnements portent sur l’organisation des examens, qui sont encore organisés en faveur des étudiants étrangers. Henri Frick s’y refuse, après l’avoir admis pour ceux qui, au commencement de la guerre, achevaient leurs études et n’avaient plus qu’une épreuve à subir. Il refuse de faire passer un examen à un étudiant russe qui se seraient inscrit à l’université après le début de la guerre : « s’il s’agit d’étudiants se faisant inscrire pendant la guerre pour être diplômés, je me récuse pour des raisons de sentiments personnels ».
La rentrée académique s’annonce une nouvelle fois au mois d’août 1918, à la veille de l’armistice. L’université nouvelle ouvre sa communication vers d’autres communes bruxelloises, et hors de Bruxelles. Une circulaire est envoyée au échevins de l’instruction publique des communes de Bruxelles, Ixelles, Saint‑Gilles, Schaerbeek, Laeken, Molenbeek, Saint‑Josse, Forest, Uccle, Anderlecht, ainsi qu’à Vilvoorde. Mais voilà que les premières semaines de cours sont perturbées par l’Armistice. Les enseignements sont suspendus au cours du mois de novembre 1918. Ils reprennent une semaine plus tard, pour quelques semaines seulement. Des pourparlers s’engagent entre le comité central de l’université nouvelle et le conseil d’administration de l’université libre de Bruxelles. La perspective d’un rapprochement avait déjà été avancée avant le conflit, dès 1908. Les difficultés de trésorerie que connait l’université nouvelle paraissent insurmontables. Les étudiants bulgares, qui formaient la plus large part des étudiants inscrits avant la guerre, ne reviendront plus. La Bulgarie fait partie des pays vaincus. L’obtention d’un visa d’étude paraît désormais compromise. Le comité central de l’université nouvelle se réunit pour la première fois depuis l’Armistice le 28 décembre 1918. Ce sera aussi la dernière fois. Le Comité décide de la dissolution de l’université nouvelle. Seul subsistera un Institut des hautes études en sciences sociales, qui sera hébergé au sein de l’université libre de Bruxelles. Le différend philosophique qui opposait les deux institutions, qui avait provoqué la scission de 1894, vingt‑cinq ans plus tôt, avait manifestement disparu.
Jérôme de Brouwer, Centre d’histoire du droit et d’anthropologie juridique (Université libre de Bruxelles)
Indications bibliographiques
Horge Virginien, L’Université Nouvelle de Bruxelles de 1894 à 1919 Parcours et constitution d’une dissidence intellectuelle, Mémoire de maîtrise, Université libre de Bruxelles, 2014‑2015.
Despy-Meyer Andrée, « Une université bulgare à Bruxelles de 1894 à 1914 », dans Hommage à André Uyttebrouck, Bruxelles, ed. de l’université de Bruxelles, 1996, p159‑172.
Despy-Meyer Andrée, « Les étudiants bulgares dans les deux universités de Bruxelles jusqu’en 1918 (avec liste des étudiants) », dans Revue des Archives de Sofia, s.l., no 52, 1996, p.293‑385.