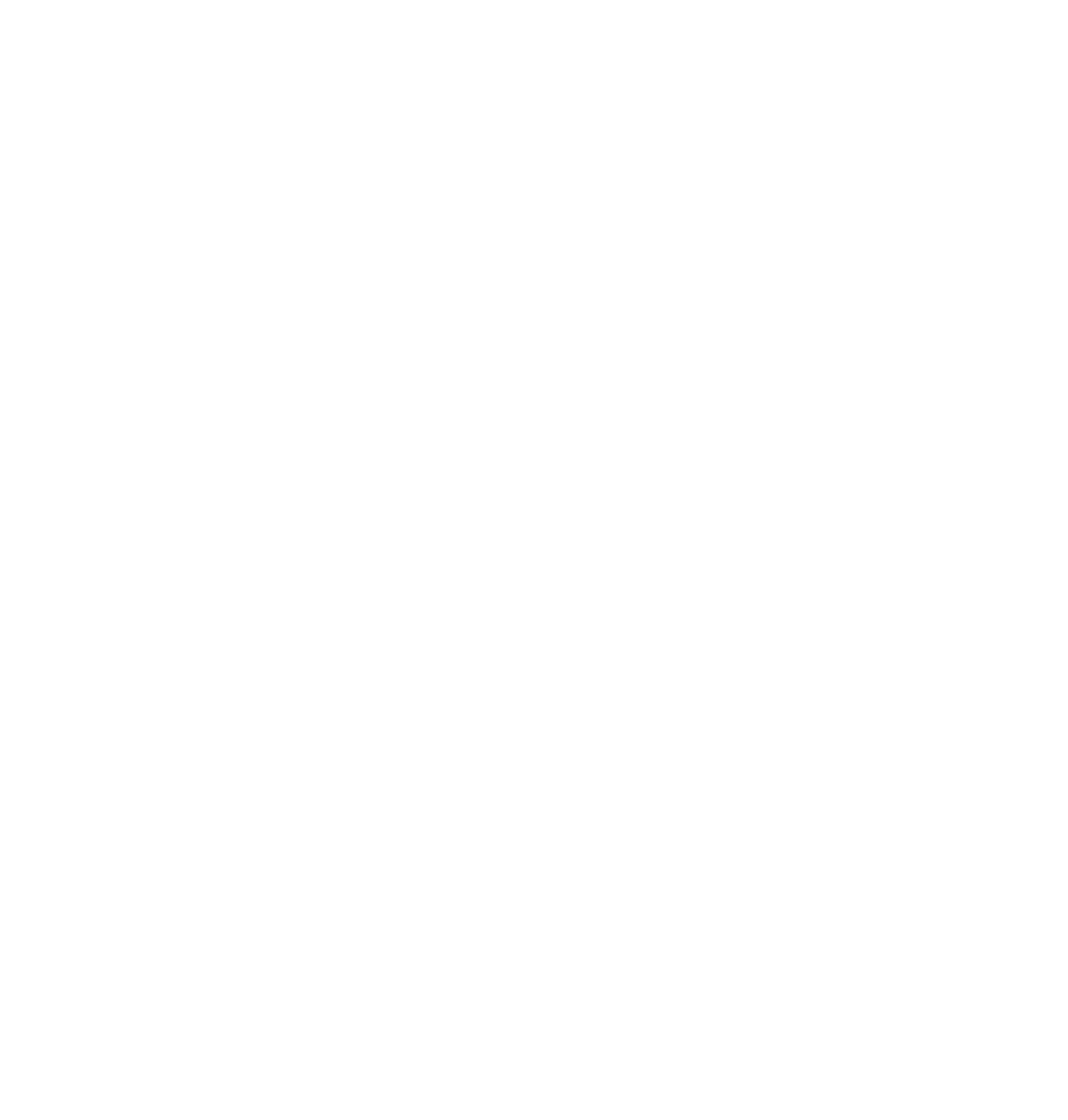La déclaration de la guerre le 1er août 1914 déclenche la mobilisation générale. Le nombre d’hommes âgés de 20 à 38 ans appelés à rejoindre les rangs de l’armée s’élève à plus de 3 800 000. Toutefois l’ampleur de la contribution des Français au conflit ne se résume pas à la gourmandise de l’institution militaire. En effet l’ensemble de la société française se mobilise dans l’Union sacrée. Pendant plus de quatre ans, ce sont en effet les membres de familles entières, combattants et civils, qui voient leurs activités guidées par l’espoir de la victoire. Ceci en réponse aux sollicitations du Gouvernement, qui oriente tous les secteurs de la vie sociale vers le conflit et met en place une propagande de guerre, mais aussi un appel du devoir pour ceux qui ont vu partir leur fils, leur père, leur époux ou leur frère. Les Le Coq de Kerland, représentants de la bourgeoisie bordelaise, ne font pas exception et témoignent de la diversité des formes de mobilisation qui traversent la société française pendant la guerre. Le père de famille, Charles Marie Stanislas, professeur à la faculté de droit de Bordeaux, ainsi que le fils cadet, Marie Charles Maurice Jean, jeune diplômé en droit, offrent d’ailleurs l’exemple de parcours de guerre de juristes appartenant à deux générations différentes : le premier à l’arrière et le second sur le front.
La famille connue dans la haute société bordelaise sous le nom de « Le Coq de Kerland » s’appelle en réalité Le Coq. Dans les familles notables, il est alors monnaie courante d’accoler un nom à particule au sien, à la manière de la noblesse d’apparence sous l’Ancien Régime. Utilisé de manière constante et continue, le nom ainsi formé finit d’ailleurs par devenir le nom officiel de la famille dans l’état-civil, comme ce sera le cas pour les Le Coq de Kerland. Par ailleurs s’agissant du nom additionné « Kerland », il fait probablement référence au berceau breton de la famille. En effet le professeur de droit n’est pas originaire de la capitale girondine, mais il y côtoie rapidement les cercles mondains car il épouse en 1876 la fille d’un notable bien en vue : le chirurgien principal de l’hôpital de Bordeaux. En outre la mère de la mariée est la petite-fille d’un négociant d’origine nantaise guillotiné à Bordeaux pendant la Révolution, en 1794.
Charles quant à lui, est né en 1844 sur l’île de la Réunion alors dénommée « île Bourbon » où son père, originaire de Concarneau, pourvoit au soutien logistique de la flotte française dans le cadre de ses fonctions de commis de la marine. Comme nombre de professeurs de sa génération, il a embrassé jeune homme la carrière d’avocat. Puis ayant obtenu son doctorat en droit en 1865, il est agrégé trois ans plus tard et débute sa carrière à la faculté de droit de Douai avant d’intégrer celle de Poitiers, où il enseigne pendant trois ans la procédure civile, qui deviendra d’ailleurs sa spécialité. C’est en 1872 que Charles Le Coq de Kerland est nommé à Bordeaux, où il vient renforcer l’équipe enseignante alors composée de huit membres, au sein de la faculté de droit nouvellement créée. Il s’établit définitivement dans cette ville, où son mariage est célébré en 1876, et dont naîtront quatre garçons. À la mode des professeurs de droit de cette époque, Charles Le Coq est avant tout un enseignant auquel on ne connaît presque aucune production scientifique mais qui est fort apprécié de ses étudiants, qui goûtent la clarté de ses exposés ainsi que les exemples nombreux qui leur font découvrir avec appétit cette procédure civile, pourtant si aride. À cela s’ajoute un ton éminemment solennel tout à fait seyant à l’Université, où les cours sont encore professés en robe, mais dont Charles Le Coq de Kerland fait également bénéficier la jeune école supérieure de commerce fondée en 1873.
Quelques années avant la Grande Guerre, les Le Coq de Kerland figurent en bonne place dans l’Annuaire du tout Sud-Ouest illustré. On y précise que le professeur et son épouse reçoivent le mardi en leur domicile de la rue d’Aviau située à côté du parc bordelais dans le quartier de prédilection des maîtres juristes bordelais, et le jeudi en leur château des Chambrettes à Pessac, en périphérie de Bordeaux. Leurs quatre fils y sont mentionnés sous les noms aux consonances étrangères de Henry, Robert, Edy et Karl, à une époque où la pratique des langues, et particulièrement de l’anglais, est un signe de distinction sociale. Cadet de la fratrie, Marie Charles qui se fait appeler « Karl » est né en 1887. Il a fréquenté deux grands lycées de la ville avant de passer son baccalauréat : le lycée public de Bordeaux, actuel lycée Montaigne, ainsi que le lycée privé Sainte-Marie Grand Lebrun. Continuant par la suite ses études, pendant lesquelles il effectue son service militaire, il obtient une première licence auprès de la faculté de droit de Bordeaux en 1911, et une seconde en sciences l’année suivante. À la veille de la Grande Guerre, il est ingénieur chimiste. Son père quant à lui, est sur le point d’achever en 1914 ce qui doit être la dernière année de sa carrière, après quarante-six ans d’enseignement. L’éclatement du conflit va néanmoins faire dévier les trajectoires des deux hommes. Le professeur Le Coq, comme nombre de collègues de sa génération, prolonge ainsi sa carrière afin de perpétuer le fonctionnement d’une Université à la fois désorganisée et sollicitée par la mobilisation, tandis que le jeune Karl renoue avec sa passion de jeunesse afin de doter les forces française d’une arme nouvelle.
Monsieur le professeur Charles Le Coq : un enseignant au service de l’Université en guerre
Les quatre frères Le Coq sont mobilisés dès le mois d’août 1914. Henri, né en 1877 et engagé volontaire pendant plusieurs années ainsi que Robert, de deux ans son cadet, sont tous deux appelés en tant qu’officiers d’administration. C’est également le cas d’Édouard, même si celui-ci a été exonéré de tout service militaire à vingt ans, en 1904, à cause d’une malformation cardiaque. Le plus jeune, Charles, intègre également les services de l’administration militaire au sein de la 18e section des commis et ouvriers d’administration. S’il apparaît clairement que la famille bordelaise est nettement mise à contribution dans la mobilisation nationale, les quatre fils du professeur bénéficient néanmoins d’une situation assez enviable parmi les mobilisés. Cela tient à différentes raisons : l’âge, l’expérience passée au sein de l’administration militaire, la faiblesse physique ou encore des compétences spécifiques notamment pour le cadet, qui devient rapidement traducteur de langue allemande. Le professeur est d’autant plus conscient de son privilège que certains de ses collègues voient leur fils prendre le chemin du front. C’est le cas du grand spécialiste de droit administratif et futur doyen de la faculté de droit de Bordeaux Léon Duguit, dont le fils périra à Verdun.
Dès la fin de l’année universitaire 1913-1914, Charles Le Coq de Kerland est confronté à la désorganisation de l’établissement qu’il avait rejoint au lendemain de sa fondation, et dont on pourrait presque dire à présent qu’il fait partie des murs. Outre le départ en masse des étudiants appelés à combattre, dont certains n’ont pas pris la peine de se rendre aux derniers examens en raison de la situation internationale explosive, les facultés doivent palier la mobilisation de certains professeurs. Ceci est d’autant plus vrai dans les établissements de province, qui constituent bien souvent un point de départ de la carrière universitaire contrairement à ceux de Paris, qui en sont un aboutissement et où les professeurs sont par conséquent plus âgés. La faculté de droit de Bordeaux est cependant assez épargnée car la moyenne d’âge du corps professoral y demeure élevée. Néanmoins quatre enseignants sur quatorze sont mobilisés. Charles de Boeck et Jean Lescure mettent à profit leur formation juridique en œuvrant à la censure, Julien Bonnecase, déclaré inapte au combat, est affecté au sein de l’administration militaire et Maurice Palmade, nommé en 1914, rejoint l’infanterie où son action sur le champ de bataille lui vaudra la médaille militaire, puis la Légion d’honneur. À ces quatre mobilisés il faut ajouter le professeur Gustave Chéneaux, qui bien que trop vieux pour être mobilisé, s’engage pour monter au combat avec ses étudiants et y trouvera la mort. Le professeur Bonnecase accomplissant son service sur place, à Bordeaux, parvient certes à poursuivre ses enseignements mais le corps professoral se trouve bel et bien privé de près d’un tiers de ses membres.
De surcroît les autorités politiques mettent en France un point d’honneur à ce que les activités universitaires se poursuivent malgré les combats. Une importance particulière est en effet accordée aux établissements universitaires dans la mobilisation en faveur de l’Union sacrée. L’Université devient ainsi un acteur de premier plan sur cet « autre front » situé à l’arrière, qui se présente comme un « front de la culture » face à la « barbarie allemande », que les intellectuels d’outre-Rhin réfutent en signant l’« appel des 93 » au mois d’octobre 1914 . À Toulouse, le doyen Maurice Hauriou affirme ainsi que le rôle de la France et de ses alliés est d’assurer le maintien de « la culture hélenno-latine, […] la seule culture humaine, l’unique, qu’aucun peuple ne peut […] renier sans retomber immédiatement dans la barbarie ». En outre les facultés de droit se hissent rapidement en première ligne car ce « front de la culture » se mue rapidement en « front du droit » sous la plume des juristes, qui cherchent à participer par tous les moyens à la mobilisation des civils. La visibilité de la mobilisation du corps enseignant n’est pas comparable entre Paris et les villes provinciales, où les cours publics à vocation de propagande se font plus rares, mais de nombreux efforts sont consentis dans tous les centres universitaires. L’effervescence est particulièrement grande à Bordeaux, qui devient pour trois mois le centre politique du pays au mois de septembre 1914. En effet le Gouvernement se replie vers la capitale girondine en raison de l’avancée allemande en direction de Paris, et même si la légèreté de la haute société parisienne en exil est parfois qualifiée d’inappropriée par les observateurs, la ville est bel et bien baignée de sentiments patriotiques.
L’heure est donc plus que jamais au « don de soi » pour la victoire au sein de la faculté de droit bordelaise, où chacun jusqu’au doyen renonce pour un temps à ses commodités afin de laisser s’y installer les principaux services du ministère de l’Instruction publique. Les titulaires non mobilisés assument ainsi gratuitement les cours de leurs deux collègues partis au combat comme Georges Ferron, qui assume gracieusement les enseignements de Gustave Chéneaux. Léon Duguit fonde même un hôpital civil provisoire où ses collègues professeurs d’histoire du droit et de droit romain n’hésitent pas à lui prêter main forte en tant qu’ambulanciers. Baignant dans cette ambiance pour le moins singulière, Charles Le Coq ne peut que se résoudre à différer son départ de l’établissement dans lequel il a passé la plus grande partie de sa carrière. Au lieu de se retirer dans son domaine des Chambrettes afin de se consacrer pleinement à la fabrication de ses vins déjà connus outre-Atlantique pour avoir « du corps, une belle couleur, de la finesse, [et] une sève prononcée », le vieux serviteur de l’État choisit donc de poursuivre bénévolement ses enseignements. C’est également le cas de son collègue Camille Levillain, fraîchement retraité lui aussi. Cette expression du sens patriotique ne rend que plus grand le respect des étudiants à l’égard des deux hommes, mais Charles Le Coq de Kerland ajoutera bientôt à cela, le fait d’être aussi le père d’un talent de la jeune aviation.
Karl Le Coq dit « Kerland » : un licencié en droit dans l’aviation
La jeunesse de Karl Le Coq révèle un profil paradoxal, à la fois conforme aux habitus de son milieu familial, et divergeant par l’indépendance de ses choix personnels. Après l’obtention de son baccalauréat, le jeune homme a suivi la voie paternelle et obtenu une licence en droit, mais aussi une licence en sciences. Pourtant s’il s’éloigne ainsi des carrières juridique, militaire et commerciale chères à ses parents en devenant chimiste, là n’est pas la plus grande divergence de ce fils de bonne famille. En effet ce dernier se passionne pour la discipline naissante qu’est l’aviation.
En 1909, dans le cadre de ses activités sportives au Racing Club de France, Karl a rencontré Géo Chavez, pionnier de l’aviation qui face à son enthousiasme, lui a proposé de voler quelques jours plus tard à bord de son appareil. Il n’en faut pas davantage pour que le descendant de marins soit désormais piqué d’aérophilie. Depuis Bordeaux, il se rend fréquemment à l’aérodrome de Mérignac pour y suivre les enseignements de Marcel Issartier sur avions monoplans, de modèle Blériot XI d’abord, du nom de son conducteur ayant traversé la Manche en 1909, puis Deperdussin. Tout cela en dépit de l’interdiction paternelle de pratiquer cette activité dangereuse et malgré la mort du « gypaète », surnom de Chavez en référence au rapace de montagne, blessé mortellement dans un atterrissage violent après avoir réalisé la première traversée des Alpes. Mais lorsque Charles Le Coq apprend que son fils a bravé son interdiction, celui-ci se voit forcé d’abandonner l’idée de passer son brevet de pilote et contraint de se consacrer uniquement à ses études.
Au moment où la guerre éclate, le rêve aéronautique de Karl Le Coq semble donc révolu. Comme ses frères, il est mobilisé comme officier d’administration, comme ce fut le cas pendant une partie de son service militaire. Il ne semble pas cependant se satisfaire de la routine administrative et tente d’y échapper une première fois par l’obtention du concours d’interprète stagiaire de langue allemande, dans laquelle il dispose de solides connaissances. Mais l’ambitieux caporal ne se trouve toujours pas à son aise dans ces tâches qu’il considère comme subalternes. C’est pourquoi il sollicite rapidement sa promotion au grade d’attaché d’intendance de 2e classe, ce qui lui est accordé au regard des excellentes appréciations de ses supérieurs.
Le conflit entraîne le développement de l’aviation militaire. En effet, malgré les débats que cette nouvelle provoque au sein de l’armée, l’avion est finalement employé dans un premier temps pour des missions de reconnaissance dans l’armée française. Mais le développement d’une aviation de chasse par les Allemands, qui parviennent à synchroniser la mitrailleuse avec l’hélice de l’appareil, engage les Français à en faire de même. Dans la guerre de position qui rive les troupes au sol, les premiers pilotes deviennent de véritables chevaliers du ciel aux yeux des autres conscrits. Ils détrônent même la cavalerie dans son prestige et leurs exploits sont relayés jusqu’à l’arrière, dans une nouvelle presse spécialisée dans l’aventure aéronautique.
De quoi raviver le rêve abandonné de Karl, mais aussi remporter l’adhésion de ses parents, qui s’inclinent face à la noblesse de la tâche. Il sollicite ainsi son intégration dans l’aviation militaire et rejoint l’école de pilotage au mois de février 1916. Après l’obtention de son brevet, il est affecté comme pilote au sein de l’escadrille N 68 basée en Lorraine au mois de septembre après avoir suivi une spécialisation « avion rapide », qui fera de lui un pilote de chasse, alors que les premiers bombardiers font leur apparition. Le jeune aviateur abat d’ailleurs un Aviatik C sur la forêt de Gremecey, en Moselle dès le mois de novembre 1916. Après cette première victoire homologuée, suivront 3 autres non homologuées avant sa mutation dans l’escadrille N 90. En effet l’aviation française se voit soumise à des règles d’homologation parmi les plus strictes, imposant notamment de retrouver la cible au sol, ce qui devient impossible lorsque l’appareil s’écrase derrière les lignes ennemies.
Au sein de cette nouvelle unité, qui porte d’ailleurs le coq pour emblème, Karl Le Coq de Kerland rencontre une bande d’aviateurs particulièrement audacieux qui n’hésitent pas à s’attaquer aux Drachen, ballons captifs allemands situés derrière les lignes ennemies. Parmi eux Marc Ambrogi, qui effectuera même un « doublé » en 1918, c’est-à-dire l’abattage de deux ballons à quelques minutes d’intervalle, partage avec Kerland sa troisième victoire officielle en janvier 1918. Fort de ses succès et avec un an d’ancienneté malgré une période d’hospitalisation, ce dernier accède au commandement de l’escadrille SPA 82 au mois de juin. Ses qualités de chef sont si grandes que ses hommes adoptent un fanion rouge et blanc orné d’une tête de coq comme insigne, en référence directe à son patronyme. Dans ce nouveau poste, l’aviateur remporte encore 5 nouvelles victoires dont deux le même jour, le 11 juillet.
L’escadrille que dirigeait Le Coq de Kerland est finalement fondue avec d’autres dans la GC 23 à la fin de la guerre, mais celui-ci termine la guerre avec un total de 14 victoires, dont 7 homologuées. Son palmarès est certes sans commune mesure avec celui d’un Georges Guynemer, qui totalise 53 victoires homologuées et une trentaine de probables, mais cela lui permet tout de même d’accéder au statut d’as de l’aviation, qui nécessite 5 victoires homologuées. Cité plusieurs fois par les autorités militaires, il est également décoré de la croix de guerre avec cinq palmes de bronze, de la croix de guerre belge, et également fait chevalier de la Légion d’honneur au mois d’octobre 1918.
Quelques jours avant l’armistice, Karl Le Coq de Kerland s’engage dans l’armée d’active. Il n’en démissionnera qu’en 1923 mais sollicite un congé sans solde à compter de son mariage en 1920 afin de se consacrer à la gestion des usines de son beau-père. Son père a quant à lui accédé à la retraite pour de bon au début de l’année 1918. Il s’est alors retiré sur son domaine des Chambrettes où il gère la production de son vin durant quelques années avant de regagner Paris où se sont installés ses fils. Il y mourra au début de l’année 1922. Karl Le Coq de Kerland alliera bientôt son diplôme juridique et son expérience dans l’armée de l’air car exerçant la profession d’avocat auprès de la cour d’appel de Paris à partir de 1921, il se spécialisera dans la défense des aviateurs dans les procès en responsabilité intentés contre eux, notamment les as André Martenot de Cordoux, Dieudonné Costes ou Paul Louis Weiller. Rappelé sous les drapeaux au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il sera intégré à l’état-major du commandement de l’air du Levant et sera l’un des rares officiers à inciter ses hommes à rejoindre l’Angleterre pendant la débâcle. Étant lui-même mis dans l’impossibilité de quitter la France, il y mènera des activités de résistance jusqu’à la fin des hostilités à Paris où les autorités allemandes tenteront de l’arrêter en 1942, puis à Grenoble où il sera nommé chef de la Résistance Air pour le Sud-Est. Rendu à la vie civile après la guerre, il entrera au Conseil supérieur de la magistrature et sera même membre du Conseil constitutionnel de 1959 à 1967. Il décédera finalement dans sa ville natale le 7 novembre 1978, à l’âge de 90 ans.
Kevin Brémond, docteur en histoire du droit (université de Bordeaux)
Indications bibliographiques
Bonin Hubert, La France en guerre économique (1914-1919), Librairie Droz, 2018.
Fillon Catherine, « De la chaire au canon. Les engagements combattants des enseignants des facultés de droit pendant la Grande Guerre », dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 35, 2015, p. 11‑30.
Hubscher Ronald, Les aviateurs au combat 1914-1918. Entre privilèges et sacrifice, Privat, 2016.
Malherbe Marc, La faculté de droit de Bordeaux (1870-1970), Presses universitaires de Bordeaux, 1996.
Malherbe Marc, La faculté de droit de Bordeaux : 1870-1970, Talence, France, Presses universitaires de Bordeaux, 1996.
Prochasson Christophe, « Les intellectuels français et la Grande Guerre. Les nouvelles formes de l’engagement », Bulletin des Bibliothèques de France, no 3 (2014), p. 38-45.