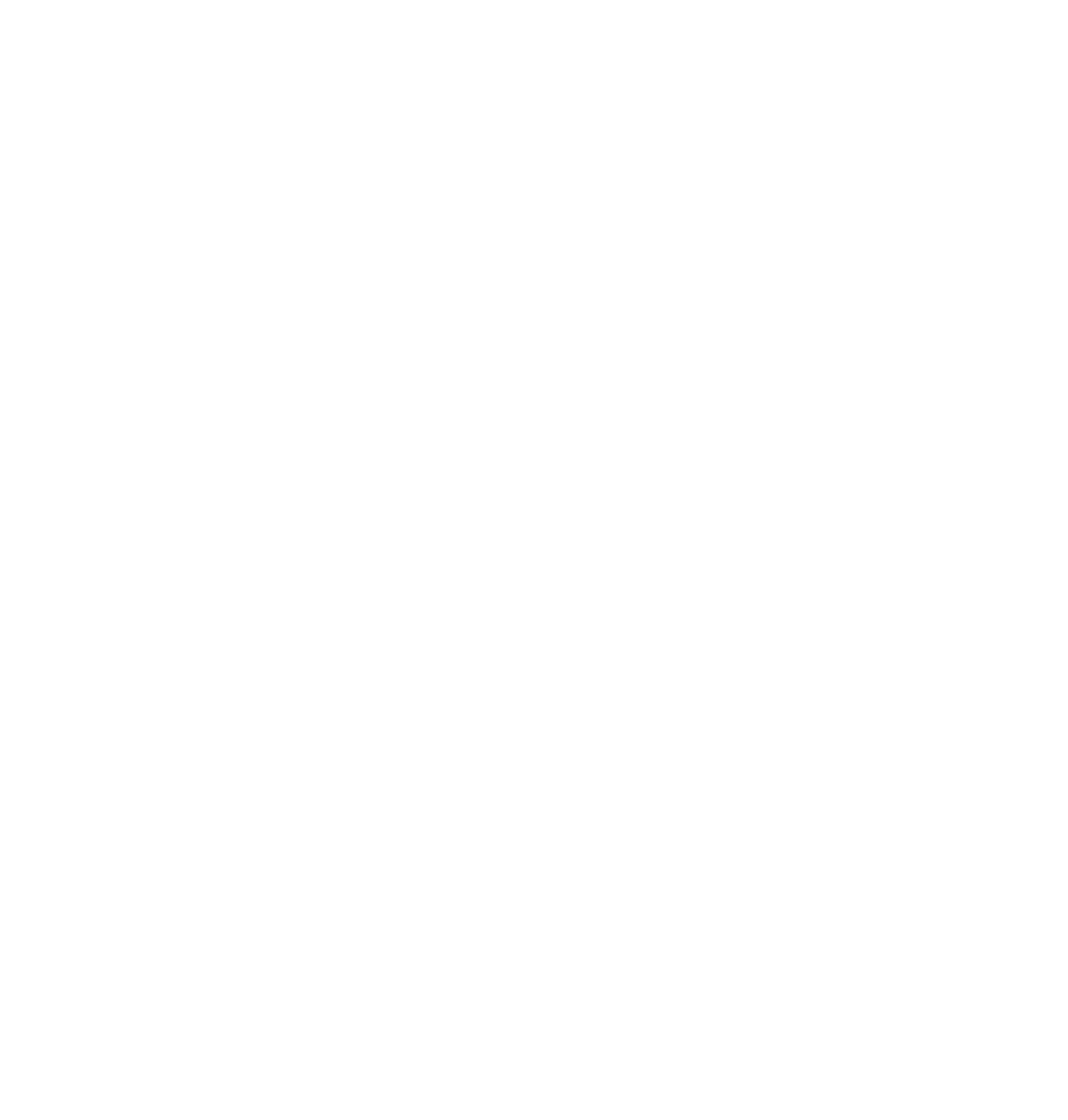Le 8 décembre 1870, Bordeaux, ville de province excentrée des combats qui opposent la France aux puissances allemandes, accueille dans ses murs la délégation du gouvernement durant deux mois. Son éloignement du front est un atout, auquel s’ajoutent ses bonnes relations avec l’Angleterre, lui permettant de se procurer du matériel nécessaire à l’effort de guerre. C’est à cette période que la faculté de droit de Bordeaux – « grande oubliée » de l’Université impériale napoléonienne – ouvre de nouveau ses locaux après presque un siècle de vide total, de 1792 à 1870, et cela, malgré la demande répétée du barreau de Bordeaux pour obtenir sa réouverture. Mais elle n’assume véritablement ses fonctions qu’au milieu de l’année 1871, bien après le départ du gouvernement donc.
La guerre de 1870 vire vite à l’échec cuisant pour la France. A contrario, le Deuxième Reich, dominé par la Prusse, en sort victorieux et devient un exemple à suivre pour toute l’Europe, notamment en matière scientifique. La science juridique française est, en conséquence, fortement affectée par l’affaiblissement du rayonnement culturel national. La situation inverse s’était produite au début du siècle, lorsque Napoléon Bonaparte, à la suite de sa brève campagne de Prusse et de Pologne (1806-1807), chercha à imposer son Code civil à l’ensemble des territoires allemands. En réaction, le romantisme juridique et le nationalisme allemand, perceptibles notamment dans les travaux de l’École historique allemande de Friedrich Carl von Savigny, s’opposaient à l’universalisme et au rationalisme des Lumières françaises, qui s’illustraient selon eux par le Code Napoléon. À la fin du siècle et au début du xxe siècle, c’est à la science allemande de devenir un modèle de rigueur et de réalisme, lorsqu’apparaît en 1900 le Code civil allemand, le Bürgerliches Gesetzbuch, abrégé BGB. Quant à la France, son modèle universitaire est jugé en partie responsable de la défaite de 1870. De nombreux juristes français, tels qu’Aubry et Rau, s’inspirent par conséquent des travaux allemands. Le juriste français Henri Capitant, par exemple, considère la classification juridique allemande comme étant la plus simple et la plus logique qu’il puisse être (Introduction à l’étude du droit, 1898). Les choses changent toutefois avec l’annonce de la Grande Guerre.
Le 4 aout 1914, le chef d’état-major allemand Helmut von Moltke, applique le plan Schlieffen. De son côté, la France échoue dans sa manœuvre du plan XVII. Sur toute la ligne de front, les soldats français, belges et britanniques reculent. Fin août, l’avancée allemande est telle que l’attaque de la capitale semble imminente. Cela conduit au départ précipité du gouvernement français, qui quitte Paris entre le 29 aout et le 2 septembre, pour s’installer à Bordeaux. Au début du mois de septembre 1914, tous les ministères et parlementaires gagnent donc la ville du Sud-Ouest, suivis rapidement par la Présidence de la République. Pour les installer le plus décemment possible, on réquisitionne les édifices publics, dont la faculté de droit, qui accueille le ministère de l’Instruction publique. Le ministère de la Guerre, quant à lui, occupe les locaux de la faculté de lettres. Cette dernière voit son personnel transféré au sein de la faculté de droit, car le ministère de l’Instruction publique n’est venu qu’avec un effectif réduit, contrairement à celui de la guerre. Quant au ministère des Finances, il s’installe dans les locaux de la faculté de médecine et de pharmacie. Enfin, quant au Conseil d’État, il tient ses séances dans une salle de concert. L’université de Bordeaux devient, in fine, le théâtre privilégié de la rencontre entre les sciences allemandes et les universitaires français, en raison des effets indirects de ce court passage du gouvernement dans la ville, qui facilite les relations et les arrangements.
L’un de ces arrangements est perceptible avec la lecture des séances de la commission des bibliothèques, notamment celle du 24 mars 1916. Le bibliothécaire y rapporte une lettre du ministre des Finances datée du 21 du même mois, destinée au recteur, visant à lever l’interdiction d’importer des livres d’origines austro-allemandes « destinés aux grands établissements scientifiques » et cela, malgré le conflit. Il précise toutefois que cela ne peut être fait qu’en vertu de conditions très précises, évoquées dans ladite lettre. Les revues restent proscrites malgré cette autorisation pour les ouvrages. Il est également précisé que le montant de ces acquisitions annuelles est évalué à 1000 francs (soit 2600€) pour l’année 1916, chiffre identique à celui de l’année précédente. La commission a ainsi débattu sur ces importations d’ouvrages issus du camp ennemi, impliquant de payer l’adversaire et donc de l’aider financièrement dans sa lutte armée. Ce cas de conscience est d’autant plus sensible que les prix de ces acquisitions ne cessent d’augmenter et que les budgets généraux des facultés sont prévus à la baisse pour les années à venir. Cependant, cette préoccupation morale et patriotique est dépassée durant le conflit, puisque, dans le même registre, dans une séance du 23 novembre 1917, il est indiqué que la somme accordée pour l’acquisition annuelle des ouvrages est élevée à un peu plus de 1100 francs. Si la somme est alors plus importante qu’au début du conflit, ceci s’explique par la baisse continue de la valeur du franc, qui perd 15 % entre 1916 et 1917. De même, et au nom de plusieurs professeurs de la faculté de droit, le président de cette commission, Monsieur de Boeck, évoque le souhait de renouveler les abonnements à des revues austro-allemandes, malgré l’interdiction du ministre datant du début du conflit. Cette demande révèle ainsi le vif intérêt des enseignants français d’acquérir des connaissances précises et récentes sur la science allemande tout en garantissant l’authenticité des sources. À ce sujet, les professeurs ont également fait savoir, par la voix de Monsieur de Boeck, qu’il était possible de compter sur l’aide de l’ambassade de France située à Berne, même si ses échanges représentaient un coût non négligeable, d’abord parce que l’intermédiaire demandait à être payé d’avance, et puis surtout parce que ces acquisitions se voient grevées par des taux de change défavorables pour un acheteur français. Il est aussi ajouté dans ce registre que cet accord n’a donné lieu qu’à un accord officieux de la part du ministre des Affaires étrangères.
S’agissant de l’effort de guerre sur le plan militaire, dès le 1er août, l’ordre de mobilisation générale est placardé dans toutes les grandes villes de France. Les locaux de la faculté de droit de Bordeaux sont réquisitionnés dès le lendemain par une compagnie militaire qui cantonne dans celle-ci, avant de partir à la frontière avec les autres soldats mobilisés. Le 2 août, ce sont des bataillons coloniaux qui s’installent dans les locaux de la faculté des lettres de Bordeaux, avant d’être eux aussi remplacés, le 15 du même mois, par des bataillons de zouaves venus du Maroc. À l’autonome 1914, la population étudiante de la faculté de droit ne représente plus qu’un cinquième de celle de l’année précédente. Elle est passée de 1600 étudiants en 1913, à 320. Pourtant, à l’échelle nationale, malgré cette réduction des effectifs étudiants, les enseignants ne sont plus suffisamment nombreux. Certaines villes en pâtissent, comme Lille par exemple, où seuls quatre des seize enseignants sont présents pour la rentrée. À Bordeaux, le professeur Gustave Chéneaux se porte même volontaire malgré la dispense à laquelle il a droit. D’origine martiniquaise, cela faisait trente ans qu’il n’était pas rentré sur son île, n’ayant pas l’argent pour se payer le voyage. Cependant, alors qu’il arrive enfin à le faire durant l’été 1914, il apprend que la France entre en guerre. Il débarque alors et repart aussitôt après avoir revu sa mère afin de s’engager. Cet agrégé décède à la bataille des Éparges le 20 avril 1915, un secteur stratégique défensif pour Verdun, d’une balle en plein front. Sa mort donne lieu à un hommage de Léon Duguit dans la Revue philomathique d’octobre-décembre 1920. Certains enseignants bordelais restés à l’arrière perdent aussi un fils. Ce fut le cas du doyen Henri Monnier et de son assesseur Léon Duguit. Ce dernier perd son fils ainé, à Verdun, tandis qu’Henri Monnier, vétéran de la guerre de 1870, voit mourir son enfant qui, malgré une blessure l’amenant à revenir à l’arrière, se fait emporter par la grippe espagnole avant l’armistice. Enfin, la guerre bouleverse aussi la vie à l’arrière, au sein des facultés. Certains professeurs participent à l’effort de guerre par une activité universitaire et civique plus active, faisant preuve d’un engagement administratif, conjointement à leur fonction d’enseignant. C’est le cas du professeur de droit public Léon Duguit, qui prend en charge l’hôpital militaire temporaire situé rue Ségalier, durant l’ensemble du conflit.
En parallèle à ce conflit militaire se déroule un combat d’ordre intellectuel. La science allemande apparaît dès le commencement du conflit comme « l’ennemi à abattre » dans le milieu universitaire et intellectuel français. Si la science juridique allemande semble incontournable depuis la Troisième République, cette dernière tente de faire de la question de l’enseignement une préoccupation patriotique de première importance, comme l’attestent par exemple les lois Ferry de 1881-1882. Les sciences et la méthode scientifique évoluent donc, pour preuve la multiplication des agrégations de droit avec le sectionnement du concours en 1896 ou encore la création de l’École libre de sciences politiques par Émile Boutmy en 1872. C’est aussi dans ce contexte qu’apparaissent et se développent la méthode comparative et le droit comparé, avec les travaux par exemple d’Édouard Lambert. L’objectif est d’abord de panser la blessure de la défaite de 1870 et de se remettre du traumatisme qu’elle a causé dans les esprits. Si dans le domaine universitaire, il s’agit dans un premier temps de s’inspirer de la méthode allemande, pour les enseignants du secondaire, les « hussards noirs de la République », il est toutefois davantage question de réveiller la fierté nationale et de cultiver un esprit de revanche. Avec le conflit, l’ensemble du corps enseignant, secondaire comme universitaire, se dirige alors dans une même direction, c’est-à-dire une opposition farouche au modèle allemand.
C’est à partir de 1914 que se développe l’idée d’une culture juridique « à la française ». L’opposition à la science allemande et sa méthode devenant systématique, elle contribue paradoxalement à ce que les auteurs français approfondissent plus encore leur connaissance de la science adverse, afin de mieux la combattre. Or, l’université bordelaise joue ici un rôle prépondérant dans cette lutte idéologique, notamment en raison de la présence du germanophile Léon Duguit. Avant le conflit mondial, le professeur de droit public bordelais avait écrit que le BGB et la jurisprudence française étaient des modèles de « scientificité » du droit, ayant en pratique de « nombreux et grands avantages » face à l’ancienne méthode exégétique. Toutefois, à son opposition à l’individualisme du Code, s’est aussi ajouté une vive critique de la théorie de la fiction, formulée par le juriste prussien Savigny. Cette contestation s’intensifie avec son article Jean-Jacques Rousseau, Kant et Hegel – Doctrine politique et juridique de Kant (1918), dans lequel il s’oppose aux principes de « fiction juridique » et de l’autolimitation de l’État, défendues par Jhering et Jellinek. Ces derniers définissent le droit comme le regroupement des règles de l’État, garantissant sa force obligatoire. Or, cette « fascination » de l’État dans le discours allemand contribue, selon le juriste bordelais, à en faire une arme dangereuse contre le droit. De même, il considère Hegel comme le « responsable de l’idéalisme qui a fait naitre un Reich absolutiste et belliqueux ayant pour modèle la Prusse », ce dernier ayant systématisé les concepts luthériens de « guerre juste » (Gerechter Krieg) et « d’histoire du Salut » (Heilsgechichte), en faveur d’une doctrine de la puissance d’État.
Enfin et pour en terminer avec les éléments qui font de l’université bordelaise un lieu privilégié dans ce conflit idéologique, il reste à évoquer deux noms d’universitaires bordelais qui, bien qu’ils ne fassent pas partie du cercle de l’étude juridique stricto sensu, restent proches de celle-ci. Il s’agit d’Émile Durkheim et Pierre Duhem, deux proches de Léon Duguit. L’un comme l’autre se sont montrés en effet particulièrement critiques envers les théories scientifiques allemandes. Le sociologue Durkheim, qui a donné son premier cours de sociologie en 1888 à la faculté de lettres de Bordeaux, suite au refus de la faculté de droit de l’accueillir, influence fortement le juriste Léon Duguit, qui, dès 1891, met en pratique dans un séminaire ses conceptions de la sociologie. Durkheim, dans son ouvrage « L’Allemagne au-dessus de tout », La mentalité allemande et la guerre (1915), présente alors la science allemande comme seule responsable du déclenchement de la Grande Guerre. En effet, c’est son nationalisme exacerbé qui est à l’origine de sa violente hostilité envers les puissances voisines. Aussi, la science allemande souffre d’une pathologie profonde : elle est « malade de sa volonté, car elle pratique l’idéalisme de manière abusif ». Tout comme son ami juriste Duguit, il critique ouvertement ce modèle idéologique qui fait de l’État un organe au-dessus des lois dont la souveraineté est sans limites et la nature autosuffisante. Cet État dépend alors d’une multitude de « forces morales » qu’il dénonce comme étant dangereuses, car toute chose qui lui est supérieure lui paraît intolérable. Il personnifie cet État en le présentant comme « susceptible, ombrageux même, [voire] jaloux ». Ainsi, sans barrières ou limites efficaces, cet État agit sous l’égide de lois morales politiques, présentées par le sociologue comme étant « trop vives d’honneur » et de principes « d’étiquettes ». Dans cette logique, la guerre n’apparaît pas seulement comme inévitable et inéluctable donc, mais devient morale et sainte, servant à venger les affronts multiples que le sociologue présente comme étant en réalité dérisoires et insignifiants à l’échelle humaine. Dans ce schéma de pensée, l’État est décrit comme « une personnalité impérieuse et ambitieuse, impatiente de toute sujétion même apparente ».
Quant à Pierre Duhem, physicien, chimiste et historien, fervent catholique et proche des milieux nationalistes de l’Action française, il porte lui aussi une charge virulente contre la méthode scientifique allemande, dans un ouvrage La science allemande, dans lequel il y reprend les leçons données à Bordeaux sous les auspices de l’Association des étudiants catholiques de l’Université, au début de l’année 1915. Duhem, bien qu’opposant farouche à la Troisième République, participe au conflit idéologique qui oppose la France à l’Allemagne, en s’inscrivant dans la lignée des intellectuels français qui participent à l’Union sacrée. Duhem décrit les scientifiques allemands comme étant dotés, il est vrai, d’une forte capacité de raisonnement et de déduction, mais restant avant tout dans l’impossibilité de recourir à l’intuition, contrairement aux intellectuels français dont c’est l’une des forces essentielles. Dans cette approche caricaturale, il présente le scientifique allemand comme étant « patient, [ignorant] la fiévreuse précipitation » et capables de « forger une longue chaîne de raisonnements dont chaque maillon a été minutieusement éprouvé [et] de déduire avec une impeccable rigueur ». Cet éloge est néanmoins rapidement à nuancer, puisqu’il ajoute à l’attention d’Hegel et plus généralement à l’attention de la science allemande : « ce qui mérite ici d’être noté, ce n’est pas qu’un Hegel se soit trouvé parmi les Allemands ; dans tous les temps et chez tous les peuples se rencontrent de malheureux maniaques qui raisonnent à perte de vue sur des principes absurdes. Ce qui est grave, c’est que les Universités allemandes, au lieu de tenir l’Hégélianisme pour le rêve d’un dément, y aient salué avec enthousiasme une doctrine dont la splendeur éclipsait toutes les philosophies de Platon ou d’Aristote, de Descartes ou de Leibniz. Le goût excessif pour la méthode déductive, le dédain du sens commun, ont vraiment rendu l’Allemagne pensante toute semblable à la maison de Chrysale, le raisonnement en a banni la raison. » (La science allemande, 1915).
En somme, la relation entre la science juridique allemande et française durant tout le xixe et le début du xxe siècle, est celle d’un amour impossible, digne des œuvres romanesques de cette même période. Les deux grandes puissances continentales ont eu, en effet, constamment « besoin » de l’autre, tantôt comme modèle, tantôt comme adversaire viscéral, afin de se (re)construire ou prouver son originalité, voire sa supériorité. Ils ont ainsi formé un duo unique en Europe. C’est encore le cas durant la Grande guerre, quand les juristes bordelais deviennent des acteurs non négligeables, sur le « front du droit ». Mais, en faisant preuve d’une haine aussi farouche envers la science allemande et pour prouver qu’ils en étaient l’exact opposé, les juristes français manquèrent parfois d’objectivité. Cependant, cette haine, qui trouvait sa justification dans les horreurs de la guerre, cachait malgré tout un profond respect, inavouable certes, mais conséquence inévitable des profondes influences antérieures. Sentiment qu’il nous est possible de reconnaître dans les portraits caricaturaux des scientifiques allemands, où encore dans l’exigence des professeurs bordelais à obtenir « à tout prix », les travaux les plus récents de leurs adversaires. Aussi, comme l’écrivait le romancier et homme politique français Alphonse Esquiros : « la haine, c’est encore de l’amour, mais c’est de l’amour aigri » (Histoire des Montagnards, 1847).
Nicolas Llesta Ferran, doctorant (université de Bordeaux)
Indications bibliographiques
Audren Frédéric, Halpérin Jean-Louis, La culture juridique française. Entre mythes et réalités : xixe–xxe siècles, Paris, France, CNRS, 2013.
Bonhomme Éric, « Bordeaux et la Défense nationale », dans Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 110, n°223, 1998. p 319-342.
Chapoutot Johann, Histoire de l’Allemagne (1806 à nos jours), Paris, Que sais-je, PUF, 2014.
Giacuzzo Jean-François, « Un regard sur les publicistes français montés au ‘front intellectuel’ de 1914 à 1918 », dans Jus politicum : revue de droit politique, no 12, 2014, http://juspoliticum.com/article/Un-regard-sur-les-publicistes-francais-montes-au-front-intellectuel-de-1914-1918-884.html (consulté le 25/07/2018).
Hakim Nader, Melleray Fabrice (dir.), Le renouveau de la doctrine française : les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du xxe siècle, Paris, France, Dalloz, 2009.
Jaubert Pierre, Centenaire de la faculté de droit, Annales de la faculté de droit des sciences sociales et politiques et de la faculté des sciences économiques, édition Bière, Bordeaux, 1976.
Malherbe Marc, La faculté de droit de Bordeaux : 1870-1970, Talence, France, Presses universitaires de Bordeaux, 1996.
Moses John Anthony, « La théorie de la guerre juste dans l’Empire allemand (1871-1918) : un phénomène protestant », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2005/1 (n° 23).
Université de Bordeaux,« Registre des délibérations de la Commission de la bibliothèque universitaire de Bordeaux » (instituée par l’arrêté du 20 novembre 1886).