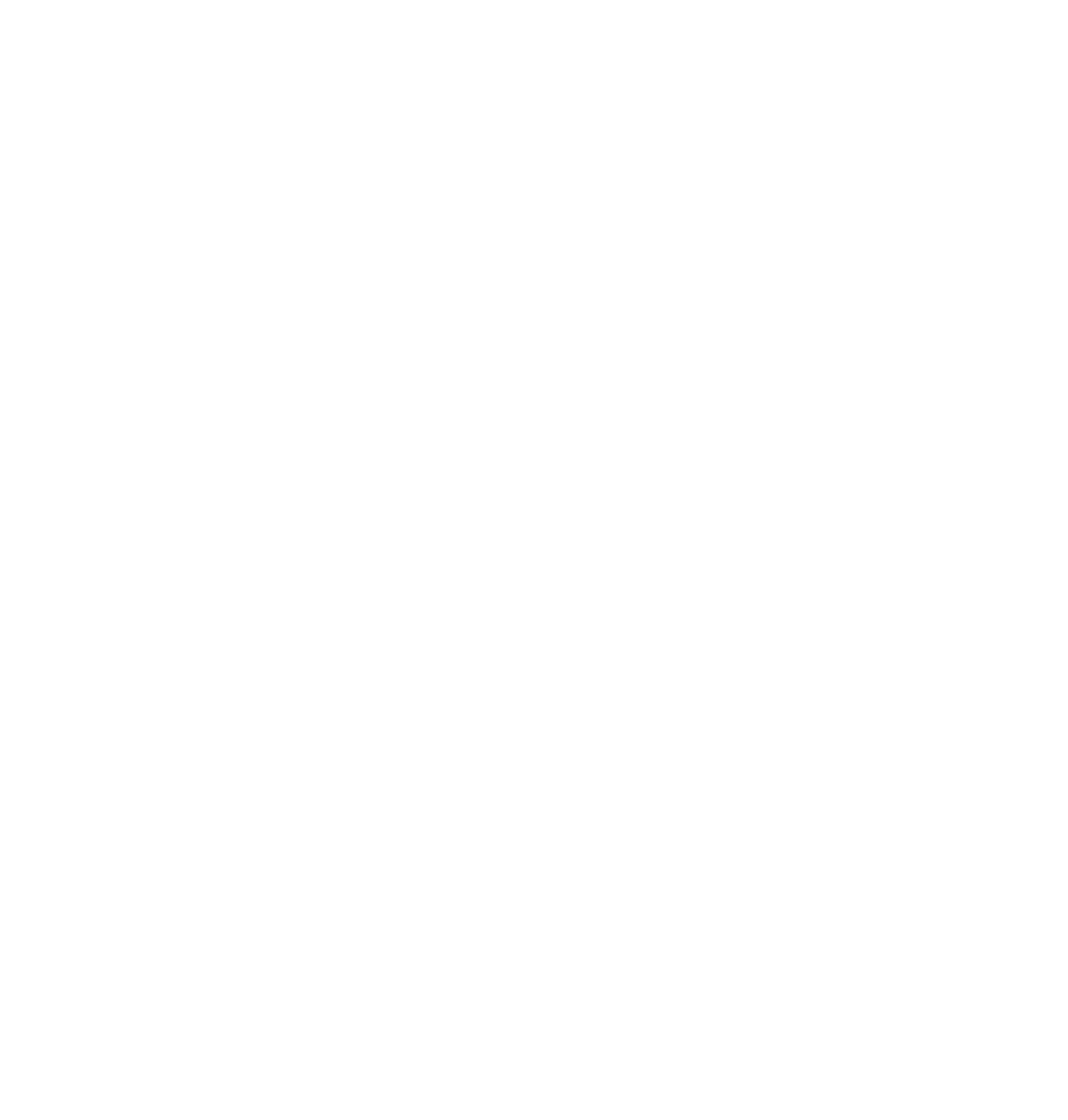Ayant connu assez tôt l’expérience de l’enseignement avec son auditorium et les cours d’Ausone (≃ 310-394) au ive siècle de notre ère, Bordeaux doit pourtant attendre longtemps avant de voir l’ouverture de sa première université officielle. Ville riche d’un port marchand à l’importante activité, ce n’est qu’au xve siècle que l’enseignement du droit y est dispensé dans l’Universitas Burdigalensis. Sa structure restera sensiblement identique pendant près de 350 ans avant d’être balayée par les élans révolutionnaires. La cité connaîtra nombre d’arrêtistes/jurisconsultes de renom tels que Nicolas Boerius (1469-1539), Bernard Automne (1574 ?-1666), Étienne Cleirac (1583-1657), Abraham Lapeyrère (1598 ?-1690 ?), ou encore le célèbre parlementaire Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755).
La Révolution de 1789 entraîne, à Bordeaux comme ailleurs, la disparition de l’enseignement du droit. Ainsi, il faut attendre la loi du 22 ventôse an xii (13 mars 1804), promulguée quelques jours avant le Code civil des Français, pour que, dans son principe, l’enseignement du droit soit réadmis. Précisons qu’il est demandé aux enseignants de respecter le Code. Par ailleurs, un décret du 21 septembre 1804 fixe la liste de la dizaine de villes, heureuses élues, qui pourront accueillir ces nouvelles facultés. Une absente de taille : Bordeaux. Plusieurs raisons sont évoquées à cet « oubli », se parant des atours d’une vengeance pour certain.e.s en mémoire d’une ville frondeuse, de son parti pris pour les Anglais, son opposition farouche aux perspectives montagnardes, etc. Pour autant, jamais les édiles de la cité n’ont perdu espoir dans l’érection d’une faculté de droit bordelaise tout au long du xixe siècle, mettant en branle tous les ressorts mis à leur disposition.
Mais quel chemin semé d’embûches les attendait ! Leurs espoirs n’ont que trop souvent été balayés d’un revers de manche sous le coup d’une fortune qui ne leur était décidément pas bien favorable…
I. Les espoirs déchus
À la suite de la suppression des deux facultés de droit de Bordeaux – l’une de droit canonique, l’autre de droit civil –, l’opposition commence à s’organiser en 1804 lorsque l’on constate que le décret de réouverture des facultés laisse la ville de côté. Le mouvement s’organise, notamment, sous la houlette de deux avocats : Joseph-Henri Lainé (1768-1835) et Philippe Ferrère (1767-1815). Pour eux, il est impensable qu’une telle cité soit dépourvue d’un enseignement aussi noble que peut l’être celui du droit. À défaut de convaincre le gouvernement, la mairie, elle, y porte une oreille attentive.
Néanmoins, trouver un interlocuteur s’avère difficile en cette période de grands changements pour la France. La succession de régimes, et donc d’idéologies quant à l’enseignement supérieur et son développement, sont ici des freins puissants.
Pourtant, les occasions ne manquent pas, et l’objectif est frôlé de peu à maintes reprises ! C’est par exemple le cas avec l’arrivée au gouvernement du ministre de l’Instruction publique Salvandry (1795-1856) en 1838, plutôt favorable à un maillage universitaire plus dense en France. La ville obtient de lui la même année l’ouverture d’une faculté de lettres et une autre en sciences. Il est vite remplacé. Son successeur ne partage pas la même vision et un coup d’arrêt brutal est donné à la prétention de la capitale girondine pour sa faculté de droit.
En 1840, nouvelle remontée d’espoir : Villemain (1790-1870), ami de Salvandry, prend la tête du ministère de l’Instruction publique. Plutôt bien avenant, il laisse échapper l’idée évanescente d’une ouverture probable, impulsant une effervescence vigoureuse dans les milieux juridiques bordelais : des pétitions sont paraphées par la Chambre des notaires et le Conseil de l’Ordre des avocats, avec la certitude qu’il s’agira là du coup de grâce donnant concrétisation à leurs attentes. La ville part au front, créant une commission pour porter ce projet. Nonobstant, son dossier rejoint lui encore les limbes de l’oubli. Motif ? Cette faculté de droit aurait fait de l’ombre aux autres de Toulouse et Poitiers déjà ouvertes…
Ces échecs cuisants ont raison d’une motivation qui pourtant semblait indéfectible. Jouant de malchance, la phase autoritaire du Second Empire oblige encore la ville à reporter son projet car d’autres préoccupations plus urgentes y marquent le pas. Notons de surcroît que le soutien tardif de la ville à l’Empire entraîne avec lui son lot de suspicions. Le préfet Haussmann (1809-1891) exile alors à qui mieux mieux celles et ceux sur qui plane le soupçon de l’insoumission, et la désorganisation institutionnelle qui gagne Bordeaux assèche le terreau qui aurait pu conduire à l’implantation d’un nouveau lieu d’enseignement du droit.
Un souffle nouveau est donné en 1864 par le maire Henri Brochon (1810-1974). Bientôt le Conseil académique se joint à la demande de la municipalité, vite accompagné par le conseil général de la Gironde. Émile Fourcand (1819-1881), futur édile bordelais, dresse un rapport relevant le hiatus entre le grand nombre de praticiens du droit à Bordeaux et cette absence de centre de formation aux matières juridiques. Bilan ? Nouveau refus catégorique de la part du ministère.
Faisant acte d’une ténacité retrouvée, et voulant profiter de la libéralisation du régime, une nouvelle requête est formulée en 1867, cherchant l’appui de Charles Zevort (1816-1887), recteur tout juste installé dans ses bureaux – et parfaitement favorable à cette ouverture. Ce dernier, convaincu des bienfaits que la ville pourrait retirer de cette faculté, recrute cinq avocats au barreau pour qu’ils commencent à dispenser des cours publics et gratuits entre 1869 et 1870. Le conseil municipal, conscient de cette avancée significative, prend ces enseignements sous son patronage.
En parallèle, la ville mande un nouveau rapport, plus complet, répondant avec une meilleure acuité aux inquiétudes formulées par le ministre de l’Instruction publique, et dont les conclusions sont rendues le 5 février 1869. Cette fois sont présentés les coûts exacts de construction, de fonctionnement, ou encore les perspectives de rentabilité à court-terme. Comme d’autres prétendantes à l’obtention d’une faculté de droit, Bordeaux utilise des exemples de villes dont la taille est plus modeste mais qui, pour autant, dégagent des bénéfices – à l’exemple de Douai, créditrice dès son premier exercice budgétaire. En somme, les faits sont présentés de manière abrupte et triviale, mais les arguments semblent convaincants. Persuadés que les circonstances leur sont désormais favorables, aidés par les amorces de cours de droit données par les avocats bordelais, des députés – notamment M. Amédée Larrieu (1807-1873) dont la ville porte aujourd’hui une place en son honneur – harcèlent Paris pour que le coup de grâce arrive enfin.
L’ultime obstacle qui se dresse sur leur route tient désormais en la personne du Ministre, par ailleurs doyen de la faculté de droit de Poitiers… C’est alors que, désinhibés par cette réunion de faits, les requérants poussent au point de rappeler au Ministre l’importance de poser un mouchoir sur ses préférences personnelles pour le salut de l’intérêt général, intérêt commandant impérieusement l’ouverture de l’établissement tant attendu. Le hasard voudra que l’instabilité politique écarte le doyen poitevin du pouvoir, à la faveur d’un remplaçant plus enclin à leur prêter une oreille attentive.
Avant que cette porte toute juste entrebâillée ne se referme, la ville décide de l’enfoncer au bélier, abattant sa carte la plus puissante au moment le plus opportun, lors du conseil municipal du 7 février 1870 : Bordeaux s’engage solennellement et officiellement à acquérir à ses frais le terrain pour la construction de la faculté, de mener sur ses propres ressources les travaux nécessaires à la construction du bâtiment, et d’en assurer tous les frais de fonctionnement, charges de personnel comprises !
Le 25 avril 1870, le recteur Zevort écrit au maire de Bordeaux pour l’informer que la démarche gagne en crédibilité auprès du Gouvernement. Galvanisée, la ville prend alors des engagements toujours plus poussés, presque indécents, dans ses délibérations du 11 juillet 1870 : en plus des frais de construction, d’entretien, et de personnel, elle s’engage formellement à reverser pendant 12 ans ( !) l’excédent de son budget de fonctionnement à l’État – prenant le pas des promesses portées par d’autres cités aux prétentions analogues.
Cette fois, le dossier semble bien ficelé, les promesses avancées difficiles à écarter ; alors la ville voit poindre la lumière au bout de ce demi-siècle d’attente. Le destin, si imprévisible, en décide autrement lorsque la bataille de Sedan éclate, entraînant dans son sillage la chute de l’Empire. La République est déclarée le 4 septembre 1870, moins de deux mois après l’apogée d’un dossier sur le point d’être finalement accepté par le régime précédent. La requête est donc remise sur la touche.
Néanmoins, dans son malheur, un coup de pouce est finalement donné à la capitale girondine : une délégation du gouvernement de la Défense nationale se réfugie à Bordeaux dès la fin septembre. Peut-être y-ont-ils discuté de ce projet avec les élus locaux, et sont parvenus à convaincre Jules Simon (1814-1896), alors ministre de l’Instruction publique resté à Paris, de la nécessité de l’ouverture de cette faculté. La légende – ou réalité ? – veut que ce soit un ballon, envoyé depuis Paris assiégée par les Prussiens, qui aurait porté le décret du 15 décembre 1870 offrant l’autorisation de cette ouverture.
En toile de fond, le traumatisme de cette défaite militaire affecte l’organisation universitaire. Dès 1867, Ernest Renan (1823-1892) relevait l’intérêt qu’une nation devait porter à ses universités en pointant du doigt la victoire de la Prusse sur l’Autriche, permise par sa science. 1870 voit nombre d’intellectuels se rallier à la cause de Renan : pour eux, les riches et puissantes universités allemandes sont la cause de la débâcle française. Louis Liard (1846-1917) y voit même la marque de la construction d’un esprit patriotique allemand, façonné par la science partagée. C’est alors qu’en France, la réforme des facultés ne devient plus simplement qu’une question de sciences, mais une question de lien entre français et françaises, lien que l’on veut retrouver et renforcer.
Sedan a donc été le catalyseur du malaise des élites françaises face aux sciences allemandes, et il paraît désormais évident que l’on voulait reconstruire nos universités, diversifier nos facultés, leur redonner grandeur et noblesse, afin d’y trouver la promesse d’une revanche morale sur le vainqueur de 1870.
Du reste, quelles qu’en soient les causes mentionnées avant, Bordeaux est désormais autorisée virtuellement à ouvrir sa faculté. Ne manque plus à cette institution qu’à trouver son accomplissement dans la construction d’un édifice, lui, bien réel.
II. La construction chaotique
Dès 1869, la ville commence à réfléchir à un emplacement pour sa faculté en projet. Plusieurs lieux sont en lice, et c’est une zone située sur la place Pey-Berland, face à la cathédrale, qui est choisie. La localisation actée, les travaux débutent très tôt à la suite du décret de décembre 1870.
Comme promis, la ville utilise ses fonds propres pour financer les travaux, aidée par la générosité de Charles Fieffé de Lièvreville (1791-1857). Ce dernier, à sa mort, légua à Bordeaux 600.000 francs, dont 300.000 en patrimoine immobilier. Aussi, le sacrifice financier concédé au Gouvernement par la ville n’en était pas vraiment un. Dans la foulée, l’architecte Charles Burguet (1821-1879) propose des plans et un devis en mai 1871, immédiatement acceptés. Ainsi, les travaux débutent en août de la même année.
En parallèle, des cours provisoires, mais officiels, commencent à être dispensés dans le cadre de cette nouvelle faculté. Sans locaux, les enseignements sont essaimés dans différentes salles de la ville. Cela permet de mettre en lumière une énième embûche : les étudiants sont déjà plus de 200, et la future construction est prévue pour une capacité maximale de fonctionnement de 300 personnes… Cette prise de conscience du manque d’envergure dans la taille du bâtiment à venir marque un arrêt brutal du chantier, offrant le temps à Charles Burguet de délivrer de nouveaux plans le 16 décembre 1871. Une fois les obstacles administratifs surmontés, place aux entraves du gros œuvre : le bâtiment est situé sur un terrain marécageux, car très proche du Peugue, ruisseau traversant la ville. Or M. Burguet, en ajoutant un étage à son plan initial, alourdit l’ensemble de la bâtisse ; aussi faut-il stabiliser plus solidement les fondations, ouvrant droit aux entrepreneurs de résilier leurs adjudications en réponse aux coûts supplémentaires engendrés.
Ces difficultés retardent le projet et le 8 mars 1872 la commission du Budget de l’Assemblée Nationale en profite pour supprimer purement et simplement la faculté de droit de Bordeaux, alors enlisée dans des travaux difficiles, bien qu’ayant déjà commencée à dispenser ses cours depuis deux ans. Grâce à ce dernier argument, la commission revient sur cette décision malheureuse.
Consciente que son projet est sur la brèche, la ville décide de reprendre urgemment la construction de l’édifice, négociant des augmentations avec les artisans face aux difficultés rencontrées. Tous acceptèrent, sauf un (mais l’affaire fut réglée par l’acceptation d’une transaction, en justice, 5 ans plus tard). Dans le même temps, le travail d’ouvrage peut reprendre au prix d’un devis lourdement modifié – de 150.000 francs initialement, il faut désormais compter 208.000 francs.
Après moult péripéties, les travaux s’achèvent sans encombre, avec une réception définitive le 11 août 1874. Notons une petite originalité : l’inauguration avait déjà été organisée le 20 novembre 1873. Le discours du doyen Couraud (1827-1892) y est d’ailleurs long, trop long. Truffé de références en latin, flirtant avec des airs de cours magistral de droit, l’intention est pourtant bonne : il réclame l’ouverture de nouvelles chaires d’enseignement et appuie sa requête en offrant la démonstration de cette nécessité impérieuse. Mais, emporté par son lyrisme en évoquant l’Histoire du droit, il se met à poser des questions philosophiques telles que « Qu’est-ce que la Loi ? », et d’y répondre lui-même, au grand dam de ses auditeurs et auditrices à qui la patience vient à manquer…
D’aspect extérieur, cette faculté a superbe allure, comme ne manquent pas de le souligner les journaux. L’intérieur, lui, est bien plus épuré, pour ne pas dire désolant : à la venue du ministre en 1876, aucun embellissement n’est présent. Le sculpteur Dumilâtre (1844-1928) – père du Monument des Girondins place des Quinconces – avait bien été approché, mais rien n’avait été finalisé. Le doyen s’en plaint au directeur des enseignements supérieurs du ministère de l’Instruction publique qui, dans un élan de générosité, lui accorde deux statues : une de Montesquieu, l’autre de Cujas. Là encore, l’histoire n’a pas été une sinécure puisque les statues ne furent pas livrées en même temps et on s’aperçoit, après coup, que n’ont pas été prévus de socles sur lesquels les faire reposer : les deux bustes gisent donc à même le sol… jusqu’en 1882 !
III. La vie institutionnelle houleuse
Cette faculté tant attendue, désirée, espérée, se doit d’être le nouveau fleuron de l’enseignement supérieur bordelais, à plus forte raison en réponse aux surcoûts engendrés par les changements de plans évoqués. La ville ayant pris à sa charge l’ensemble des dépenses se trouve obligée de démontrer à ses contribuables que l’argent a été raisonnablement utilisé. La presse joue un rôle considérable, les journaux ne tarissant pas d’éloges quant à ce bâtiment majestueux, fièrement dressé face à la cathédrale de la place Pey-Berland. Mais encore faut-il insister sur son utilité, et c’est à grands coups de statistiques sur l’utilisation des bibliothèques ou de l’assiduité que la presse locale assomme ses fidèles lecteurs et lectrices.
Nous relevons néanmoins une contradiction ici avec le discours de rentrée du doyen Couraud. En effet, lui-même se plaint de l’absentéisme des étudiants aux cours – qui peut être expliqué par la grande sécheresse des leçons exégétiques alors prononcées dans les amphithéâtres. Il n’empêche que ce dernier se félicite des bons résultats obtenus par ses élèves, tout en appuyant l’idée qu’ils pourraient être bien meilleurs si les familles prenaient pleine conscience de la nécessité d’envoyer leurs enfants, régulièrement, aux cours dispensés au sein de la faculté. Il est d’ailleurs intéressant de rappeler qu’une des raisons soulevées pour soutenir la construction de ce nouveau lieu d’enseignement était de permettre aux jeunes de rester proches de leurs familles, et ainsi leur éviter un voyage dispendieux à Paris, reconnue par ailleurs comme capitale de tous les vices. À trop vouloir empêcher l’éloignement de la jeunesse du noyau familial, cette dernière ne prend même plus la peine de se déplacer jusqu’à la place Pey-Berland !
Des vagues, la faculté de droit en connaît d’autres, cette fois dans ses enseignements. Dès 1876, la ville de Bordeaux avec sa faculté des lettres, suit un mouvement novateur en ouvrant une chaire de géographie. De surcroît, aux sections en place en 1886 continuent de s’ajouter de nouvelles disciplines comme l’histoire de l’art et l’archéologie qui ne sont plus placées sous la coupe de l’histoire, ou encore la psychologie puis la sociologie s’émancipant de la tutelle de la philosophie.
C’est d’ailleurs du premier cours de sciences sociales par Émile Durkheim (1858-1917) en 1888 que provient le plus gros séisme. Qui des lettres ou du droit doit héberger cette nouvelle science ? Sujet bien épineux qui oppose Gabriel Baudry-Lacantinerie (1837-1913) – doyen de la faculté de droit – à Alfred Espinas (1844-1922) – doyen de la faculté des lettres – lors du conseil des facultés du 17 juillet 1888. On y entend notamment dire que « Monsieur le doyen de la faculté de droit fait observer que par définition et par essence la science sociale appartient exclusivement au domaine des études juridiques. Monsieur le doyen de la faculté des lettres insiste au contraire sur la différence existant entre la science des sociétés et l’art du légiste », preuve des conflits exacerbés autour de cet enseignement. Le point décisif sera finalement offert aux lettres.
Derrière cette querelle de clocher se dissimule une concurrence nébuleuse dont nous pouvons trouver écho à la Sorbonne : le même type de dissensions s’y présente, et la motivation principale des juristes à s’approprier la matière n’est autre que leur soif d’asservir entièrement les sciences sociales à l’enseignement du droit ! S’il en fallait une preuve, nous nous contenterions de rappeler que, immédiatement après l’abandon de ce projet par la faculté des lettres parisienne, la faculté de droit n’entretint sitôt plus aucune prétention à l’obtention d’une chaire en sciences sociales…
Pour autant, droit et sociologie veulent se rencontrer, d’abord sous l’impulsion de Durkheim qui, dans son discours inaugural, invite fortement les juristes à venir assister à son cours. Léon Duguit (1859-1928) – par ailleurs ami de Durkheim – fait remonter, lors de l’assemblée de la faculté de droit du 9 décembre 1887, que l’horaire des cours du sociologue coïncide avec un autre cours de droit ; il est donc nécessaire de trouver un compromis entre les deux facultés pour éviter ce chevauchement, sans pour autant que le cours de sciences sociales ne batte le pavillon de la science juridique. Signe de victoire pour cette mixité souhaitée, le conseil des facultés de 1889 met en lumière le rendez-vous entre juristes et sociologues : étudiants en droit, comme professeurs, assistent aux cours d’Émile Durkheim !
Enfin, la problématique des locaux vient à se poser une nouvelle fois. En 1898, le doyen commence à se plaindre de l’exiguïté de la bâtisse. En 1899 les copies d’examen conservées depuis l’ouverture de la faculté sont détruites pour libérer de l’espace. La ville doit nouvellement se lancer dans l’acquisition de locaux proches de la faculté avec l’idée de l’agrandir : on propose d’acquérir le bâtiment mitoyen, à l’angle de la rue du Commandant-Arnould et de la place Pey-Berland, ce qui ne sera concrétisé qu’en 1907. Encore trop à l’étroit, les regards se tournent vers la rue Cabirol, choix qui n’est pas des plus simples. En effet, cet ensemble appartient à l’Église, et pour qu’une procédure d’expropriation puisse être mise en action, encore convient-il d’en démontrer l’utilité publique. Le décret éponyme n’arrive qu’en 1910 et les immeubles rue Cabirol peuvent alors être acquis par la mairie en 1911. Les travaux commencent en 1913, juste avant que la Grande Guerre ne vienne interrompre cet énième projet… qui ne reprendra qu’en 1920 !
En définitive, si la faculté n’a pas été un champ de guerre au sens littéral, sa sortie du sol, elle, fut un véritable combat de tous les instants. Il fallut lutter avec les gouvernements successifs, les entrepreneurs, les doyens des facultés, et même s’engager dans une bataille coûteuse contre le Peugue ! Ce n’était là qu’un avant-goût du combat interne que cette institution allait devoir traverser face au grand conflit de 1914.
Alexandre Frambéry-Iacobone, A.T.E.R. IRM-CAHD (université de Bordeaux)
Indications bibliographiques
Brémond Kevin, Une histoire politique des facultés de droit ; l’image des facultés de droit dans la presse quotidienne d’information nationale sous la troisième république (1870-1940), thèse droit, université de Bordeaux, 2018.
Cadilhon François, Lachaise Bernard, Lebigre Jean-Michel, Histoire d’une université bordelaise : Michel de Montaigne, faculté des arts, faculté des lettres, 1441-1999, Talence, France, Presses universitaires de Bordeaux, 1999.
Clavel Elsa, La faculté des lettres de Bordeaux (1886-1968). Un siècle d’essor universitaire en province, thèse histoire moderne et contemporaine, université Michel de Montaigne, 2016.
Malherbe Marc, La faculté de droit de Bordeaux : 1870-1970, Talence, France, Presses universitaires de Bordeaux, 1996.
Poux Ludovic, La construction des palais universitaires de Bordeaux au xixe siècle, thèse histoire contemporaine, université Michel de Montaigne, 1993.