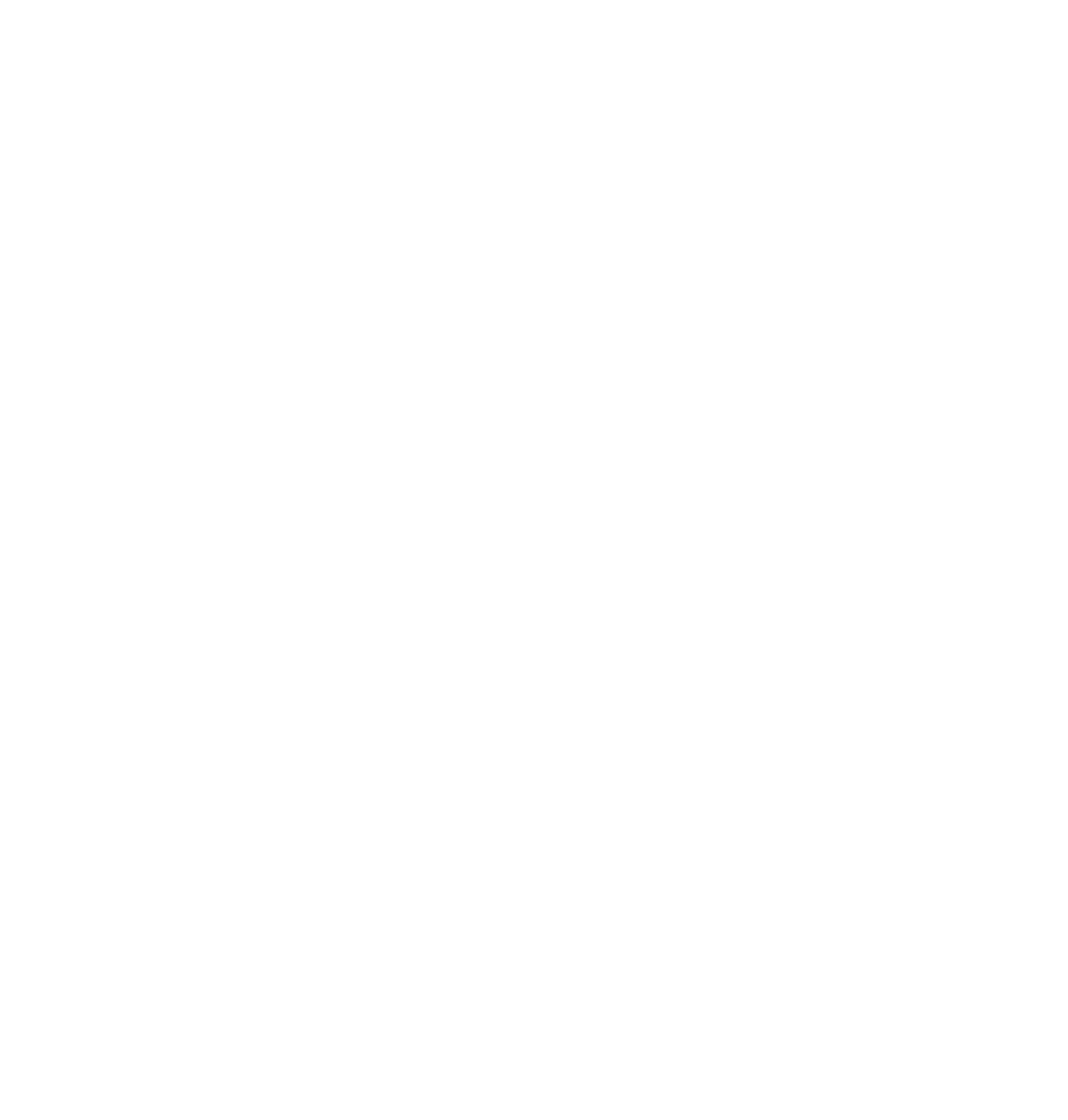En 1915, l’exposition universelle quitte le Vieux Continent pour les États-Unis ; ce n’est pas une première, puisque Philadelphie, Chicago et Saint-Louis avaient déjà accueilli cet évènement auparavant. Tout juste remise du terrible séisme de 1906, c’est la ville de San Francisco qui est cette fois choisie pour recevoir les exposants des vingt-quatre pays participants ; entre mars et décembre 1915, elle accueillera environ dix-neuf millions de visiteurs.
L’événement, comme toujours, est articulé autour d’un grand thème. Pour cette itération, c’est le canal de Panama, achevé et inauguré un an plus tôt, qui est à l’honneur : l’exposition est renommée « Panama-Pacific » pour l’occasion. En effet, ce canal, dont les titanesques travaux ont débuté en 1882, a permis une extension sans précédents du commerce maritime et participe au fort développement de la Côte Pacifique américaine.
Malgré l’existence de dissensions douanières entre la France et les États-Unis, le gouvernement français, sollicité dès 1912, reçoit favorablement l’invitation de l’ambassade américaine, gardant en mémoire la participation enthousiaste des États-Unis à l’exposition universelle parisienne de 1889.
En 1915, toutefois, le contexte national et international a radicalement changé. Depuis l’été 1914, la France est en guerre, et lorsque débute l’exposition, l’Europe toute entière se déchire. À San Francisco, l’Hexagone cherche alors bien plus que du prestige et des débouchés pour son industrie. Il s’agit pour la France de renforcer son image, sa légitimité et son tissu diplomatique, en exportant « sa cause » qu’elle veut universelle, celle de la science, de la culture, de la civilisation.
Pour cela, le gouvernement français a fait installer dans les pavillons occupés par ses exposants des œuvres d’art, mais aussi de nombreux ouvrages et opuscules, anciens et contemporains, témoins de l’excellence et de la vitalité de la science française. Pour permettre aux visiteurs de saisir la portée de ces travaux, pas toujours intelligibles aux néophytes, il est décidé de joindre à ces collections des notices explicatives faisant la synthèse de la production savante française depuis l’époque moderne. Chaque notice est consacrée à une discipline scientifique dont elle dresse un bilan sur le long cours, et souligne l’apport de la pensée française et de ses savants à la marche universelle de la science.
Il est alors stratégique pour la France de vanter les mérites – pour ne pas dire l’éminence –, de « sa » science. En effet, la science française est perçue comme déclinante, notamment chez les anglo-saxons, depuis la fin du xixe siècle. C’est la science et la pensée allemandes qui, désormais, suscitent intérêt et admiration. Les français eux-mêmes, dans le traumatisme né de la défaite de Sedan, ont restructuré leurs institutions scientifiques, leurs disciplines et leurs universités à la Belle Époque. Or, prétendant agir dans un esprit universel et civilisateur, la France doit affirmer son leadership scientifique face à l’« Allemagne prussienne », son ennemie, qu’elle présente comme brutale et sauvage. Pour rassembler autour d’elle le « camp du droit », le « monde civilisé », la France veut démontrer à San Francisco qu’elle peut s’enorgueillir d’une longue histoire savante et que ses penseurs contemporains sont encore à l’avant-garde de la science.
Les notices de San Francisco vont être regroupées et publiées dans un même ouvrage à la demande du ministère de l’Instruction publique. Preuve de la dimension politique du projet, c’est Lucien Poincaré, physicien et directeur de l’Enseignement supérieur, qui en rédige la préface. Publié par la maison Larousse sous le titre La Science française (1915, 2 vol., 397 et 403 p.), le livre est à la fois un travail de synthèse, de vulgarisation scientifique et de propagande. Avec cette publication, la Librairie Larousse renforce son engagement dans la littérature de guerre, en multipliant les publications patriotiques et anti-allemandes comme l’ouvrage d’Henri Clouard, Les Allemands par eux-mêmes, paru la même année. La Science française compte 53 chapitres d’importance inégale ; chacun traite d’une science particulière, et est rédigé par une autorité de la discipline. Ainsi, par exemple, le chapitre consacré à la sociologie est l’œuvre d’Émile Durkheim ; celui dédié à la philosophie est écrit par Henri Bergson.
Pour les sciences politiques et juridiques, c’est le doyen de la faculté de droit de Paris Ferdinand Larnaude qui prend la plume. Présenter en moins de 100 pages le droit français de Cujas à nos jours, dans toutes ses branches et ramifications, était un défi redoutable, en particulier pour un universitaire habitué à écrire pour ses pairs et non pour le profane.
Le travail de vulgarisation mené par Larnaude impliquait d’évidentes simplifications et omissions, mais il est néanmoins réussi : synthétique, limpide et pédagogue, le doyen parisien parvient à dresser une fresque glorieuse de la doctrine juridique française et de ses apports à la science du droit. La première partie du plan est érigée autour de la rupture politique, juridique et intellectuelle de la Révolution française (« Le droit et la science politique avant 1789 » – « Le droit écrit et la codification » – « Le droit et la science politique depuis 1789 »). La suite du plan, plus thématique, décline les différentes branches du droit ; Larnaude présente enfin, sans ordre ni logique, toutes les matières qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes, comme la procédure ou encore l’histoire du droit, et achève son exposé par un tour d’horizon des « Répertoires, recueils, revues, journaux judiciaires, sociétés juridiques, travaux des universités et des facultés ». Une conclusion et une bibliographie sommaires viennent clore les 75 pages du chapitre.
Glorieux, le portrait de la science juridique française dressé par Larnaude l’est à l’excès ! L’œuvre, en effet, ne saurait être dissociée du contexte de sa rédaction. Comme le fait la doctrine dans les revues juridiques de l’époque, Larnaude écrit ici davantage au service de la patrie en armes que de la science, l’esprit de propagande le poussant bien souvent à la faute scientifique et historique.
Ainsi, l’auteur n’hésite pas à faire des juristes français les principaux porteurs, à travers les âges, de la flamme de Thémis qui éclaire toujours les nations civilisées, en omettant soigneusement de mentionner les apports de la pensée allemande et les relations ambiguës que la doctrine française a entretenues avec les juristes d’outre-Rhin tout au long du xixe siècle. Au-delà des gloires passées, l’auteur insiste aussi sur le « renouveau » de la science juridique française depuis les années 1880 : la génération à laquelle il appartient aurait en effet régénéré les approches du droit, rendant à la pensée juridique française ses lettres de noblesse injustement contestées.
Légitimer le « camp du droit » : la France, mère des lois et flambeau des « nations civilisées »
La lecture du texte de Larnaude étend et décline à l’envi le premier vers du célèbre sonnet de Joachim du Bellay : « France, mère des arts, des armes et des lois ». En effet, le doyen dresse un portrait si éclatant et si exclusif de la pensée juridique française que le monde entier semble redevable d’une dette éternelle de civilisation à son égard. Un tel panégyrique, loin d’être le premier du genre, étonne toutefois dans un travail qui se veut « scientifique », d’autant que Larnaude prend souvent de fâcheuses libertés avec l’histoire.
En abordant la doctrine ancienne, le doyen commet des raccourcis ou des oublis significatifs. Par exemple, si les Commentarii juris civilis de Doneau ont bien « exercé une grande influence » en Europe comme l’écrit l’auteur, ce dernier ne dit toutefois pas un mot sur le départ forcé de ce jurisconsulte calviniste vers l’Allemagne où il trouva refuge, où il exerça le reste de sa vie comme professeur, et où sa doctrine eut beaucoup plus de succès qu’en France. Même chose à propos de Montesquieu : Larnaude présente De l’esprit des lois comme une œuvre majeure de la science politique, inspiratrice des plus grandes constitutions modernes, oubliant de mentionner que le philosophe bordelais ne cachait pas son admiration pour le modèle anglais dans lequel il puisa bien des idées. Quant à Jean-Jacques Rousseau et à Grotius, Larnaude les naturalise bien volontiers, le premier en raison de sa « fréquentation des cercles littéraires de Paris » qui ont « influé grandement sur ses doctrines », le second du fait de ses racines familiales bourguignonnes, comme en raison de son installation à Paris lors de la rédaction du De jure belli ac pacis, ouvrage qu’il dédia à Louis XIII.
Fêté en grande pompe à l’occasion de son centenaire en 1904, le Code civil reste un monument de fierté en 1915, même si des voix de plus en plus nombreuses appellent à une refonte d’envergure de l’ouvrage, le BGB allemand ayant sérieusement vieilli le vénérable code de Portalis.
Là encore, Larnaude écrit que la rationalité de « l’esprit juridique français » s’est manifestée très tôt, dans les grandes ordonnances de Colbert et de D’Aguesseau ; mais il ne dit mot des codifications beaucoup plus systématiques et modernes adoptées dans de nombreux pays d’Europe centrale et du nord au xviiie siècle. Ne pouvant esquiver la question du Code prussien de 1794, le Doyen en souligne surtout le destin anecdotique face au triomphe européen des codes français. « Les codes napoléoniens », écrit Larnaude, « répondaient mieux [que le Code prussien] aux aspirations générales des peuples qui les ont adoptés », car « la forme en était si parfaite, la langue si claire, que ces codifications ont pu s’adapter très facilement, soit par transplantation directe, soit par infiltration, aux mœurs de ces peuples. Le Français, en légiférant pour lui-même, s’est trouvé légiférer pour ces peuples ».
S’il n’est pas question de contester les qualités de la codification napoléonienne, et en particulier du Code civil, il faut toutefois nuancer l’argument du génie juridique français prompt à répondre « par l’universelle » aux besoins des peuples de la Terre : les baïonnettes et la soumission de l’Europe à Napoléon ont aussi joué un rôle non négligeable dans la diffusion du droit français au xixe siècle.
D’ailleurs, Larnaude ne dit mot de la « querelle du Code » de 1814, et du rejet qui s’ensuivit pendant près d’un siècle, par l’Allemagne libérée de l’occupant français, de toute idée de codification du droit national au profit du professorenrecht Savignien. Cette « autre voie » a pourtant fasciné une partie de la doctrine française, qui, lassée des commentaires légalistes et étroits du Code, enviait le dynamisme et la liberté scientifique des Allemands. Les travaux de l’« école historique allemande » seront d’ailleurs relayés très tôt au sein de la Thémis d’Athanase Jourdan (1819-1831), revue juridique française dont les principaux rédacteurs furent taxés de « gallophobie » en raison de leur intérêt appuyé pour la science d’outre-Rhin.
Si Larnaude affirme avec raison que les Japonais sont librement allés chercher du côté de la France un modèle de législation, il omet de signaler que le Code civil japonais de 1896 s’inspire tout autant – sinon plus –, du droit allemand. Quant au droit colonial, imposé cette fois par le colonisateur aux peuples indigènes, le doyen en parle peu, sinon pour louer la modernité du Code marocain de 1913. L’exemple du protectorat du Maroc n’est évidemment pas choisi au hasard, ce dernier étant, depuis le début du xxe siècle, l’objet de sévères rivalités entre la France et le Reich.
Enfin, l’ennemi allemand est directement visé toutes les fois où, en exemple ou en soutien, l’auteur cite les systèmes juridiques et politiques des « peuples libres », c’est-à-dire des démocraties libérales alliées de la France. Comme dans les revues juridiques, les systèmes anglo-saxons sont à l’honneur, et Larnaude ne manque pas de souligner les héritages et les parentés qui les lient au droit français.
En excluant ainsi l’Allemagne du champ juridique, l’auteur néglige évidemment les apports – et parfois l’avance –, de la législation allemande sur la législation française, notamment en matière de protection sociale et de droit du travail. À l’image de la doctrine de son temps, il feint d’oublier que les regards des juristes français étaient largement tournés vers l’Allemagne avant la Grande Guerre. Ainsi, par exemple, Larnaude rédige un paragraphe très intéressant sur les travaux de la Société de législation comparée et du Comité de législation étrangère ; toutefois, il omet de préciser que c’est l’élaboration et la promulgation du BGB en Allemagne qui ont accéléré l’intérêt pour les études comparatistes en France à la fin du xixe siècle.
Certes, la science juridique française justifiait bien des honneurs et la France pouvait à bon droit s’enorgueillir de ses lois et de ses jurisconsultes. Toutefois, le texte de Larnaude efface sans cesse les aspérités historiques par des touches ou des omissions plus ou moins subtiles ; en occultant quasi-systématiquement les influences et les enrichissements étrangers (surtout Allemands) dans la construction de la science et du droit français, en faisant de la France le flambeau des lois universelles, le doyen fait davantage œuvre de combat et de propagande qu’œuvre de science.
« Mère des lois », la France juridique présentée par Larnaude incarne donc aux yeux du monde le camp du droit et de la civilisation face à la violence teutonique. Surtout, ce leadership juridique n’est pas qu’un souvenir des temps passés : parfois présentée comme déclinante, la science juridique française serait au contraire plus aboutie que jamais en cette aube du xxe siècle !
Une science à la pointe du progrès : le « renouveau » de la pensée juridique française
L’opuscule de Larnaude s’inscrit pleinement dans le contexte de la Grande Guerre, mais aussi dans celui de la « rénovation scientifique » du droit à la Belle Époque, instant épistémologique et académique charnière où la doctrine, acculée par les nouvelles sciences sociales, réécrit son histoire contemporaine et redéfinit sa discipline et ses méthodes.
La crise est d’abord civiliste : le Code civil est en effet devenu le symbole – voire l’instrument – du conservatisme. Prisonnière d’un texte vieillissant maintes et maintes fois commenté, la doctrine ne parvient plus à répondre aux nouveaux enjeux sociaux et économiques engendrés par la révolution industrielle, ni même à susciter l’intérêt des étudiants. Pour concurrencer la sociologie, les sciences politiques et l’économie, les facultés de droit introduisent alors officiellement de nouveaux enseignements et multiplient les cours optionnels. Larnaude décrit parfaitement cet « accroissement » et ces « ramifications » de l’enseignement juridique : « D’une part des formations nouvelles, fruit d’un développement économique (industriel et commercial) nouveau, sont venues s’ajouter aux formations anciennes. Le droit industriel et le droit international privé comptent parmi ces branches nouvelles de l’organisation et de la science juridique. D’autre part, les anciennes disciplines elles-mêmes se sont quelquefois ramifiées et divisées » à l’image de la science pénitentiaire détachée du tronc du droit criminel. Enfin, Larnaude insiste sur « la prépondérance prise à notre époque par l’élément de comparaison entre les lois et les théories des auteurs des différents pays ».
Au-delà des enseignements nouveaux, la doctrine se lance dans une vaste réflexion méthodologique et épistémologique pour mettre un terme à la « décadence » des études juridiques ; Claude Bufnoir, Raymond Saleilles, François Gény, Edouard Lambert, Adhémar Esmein, Louis Josserand ou encore René Demogue sont animés par une mission « régénératrice » et produisent une réflexion de fond sur la science juridique. En opposition à la vieille « école des commentateurs », ou « école de l’exégèse » dépeinte au même moment par Julien Bonnecase et Eugène Gaudemet, les jeunes universitaires de la Belle Époque se réclament désormais d’une nouvelle « école scientifique ». Le temps de la glose et des abstractions est révolu ! Place à la « science d’observation », le droit étant un « objet vivant » en « perpétuel devenir ». Enrichis des méthodes historiques, sociales, économiques, comparatistes, les universitaires se donnent alors pour mission d’anticiper et d’ordonner les phénomènes juridiques pris dans toute leur complexité.
Le droit retrouve ainsi le premier rang des sciences, et le juriste redevient le « spécialiste du social » qu’il était traditionnellement. Larnaude ne manque pas de faire connaître cette « révolution scientifique » du droit et de la doctrine dans son ouvrage.
Ainsi, le doyen défend le rôle majeur joué par la doctrine dans l’élaboration du droit. C’est la doctrine, « c’est-à-dire les écrits des jurisconsultes et des publicistes » et surtout « l’enseignement des professeurs dans les universités » qui donne aux futurs praticiens et au législateur de demain « l’orientation juridique qu’ils suivront plus tard ». Formant les esprits, la doctrine assure aussi la cohérence, l’évolution et le perfectionnement des multiples « manifestations judiciaires, législatives, oratoires de l’élaboration juridique et politique » par une critique « libre et désintéressée ». Elle retrouve ainsi, du moins virtuellement, la première place au sein des sources du droit.
À l’image des universitaires de son temps, Larnaude dresse ici le portrait d’une doctrine ayant renoué avec la science et repris la marche du progrès. Si les idées et programmes les plus audacieux de l’« école scientifique » n’ont pas – ou trop peu – été suivis après la Grande Guerre, Larnaude inscrit toutefois son propos dans une dynamique forte de la doctrine de son temps.
Le doyen rappelle surtout que, loin d’être déclassée, la science juridique française a, au contraire, retrouvé son éminence perdue ; la France est donc parfaitement légitime à assurer le leadership des nations appartenant au « camp du droit ».
Toutefois, l’auteur achève son propos patriotique – voire propagandiste –, par un appel à la coopération et au refus de toute hégémonie, fût-elle intellectuelle, qui détonne un peu avec le reste de l’ouvrage : « Nous désirons rendre justice à chacun, aux petits peuples comme aux grands. Que ce soit tel ou tel peuple par sa législation, telle ou telle nationalité par ses penseurs, à qui l’humanité est redevable de ses progrès, nous nous en réjouissons, même lorsque ce peuple, cette nationalité ne sont pas la France. Une hégémonie intellectuelle ou morale serait aussi odieuse qu’une hégémonie matérielle dans le concert des nations qui doit rester libre pour être fécond ». Si elle tient le premier rang dans la science juridique, la France ne saurait pour autant écraser les autres nations de sa splendeur. Ne nous détrompons pas : sous une apparente bienveillance, cette conclusion n’est qu’une ultime flèche décochée à l’Allemagne et à son désir (prétendu) de « domination ».
Pierre-Nicolas Barenot, maître de conférences en histoire du droit (université Jean-Monnet – Saint-Étienne)
Indications bibliographiques
Barenot Pierre-Nicolas, « Compte rendu : ‘Ferdinand Larnaude, Les sciences juridiques et politiques’, La Science française, Larousse, 1915 », dans Revue trimestrielle de droit civil, no à paraître, 2018.
Chambost Anne-Sophie, Gottely Alexandra, « Guerre du droit, droit de la guerre. La faculté de droit de Paris, observatoire de l’enseignement supérieur en guerre », dans Revue d’histoire des sciences humaines, no 33 , 2018.
Hakim Nader, Melleray Fabrice (dir.), Le renouveau de la doctrine française : les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du xxe siècle, Paris, France, Dalloz, 2009.
Halphen Louis, « Exposition universelle et internationale de San Francisco. La science française », dans Revue historique, no 122 fasc. 1, 1916, p. 137‑141.
Larnaude Ferdinand, Les sciences juridiques et politiques, « La science française », Paris, France, Larousse, 1915.
Mollier Jean-Yves,Dubot Bruno, Histoire de la Librairie Larousse, 1852-2010, Paris, France, Fayard, 2012.
Nouailhat Yves-Henri, France et États-Unis : août 1914-avril 1917, « Publications de la Sorbonne », Paris, France, Institut d’histoire des relations internationales contemporaines, 1979.