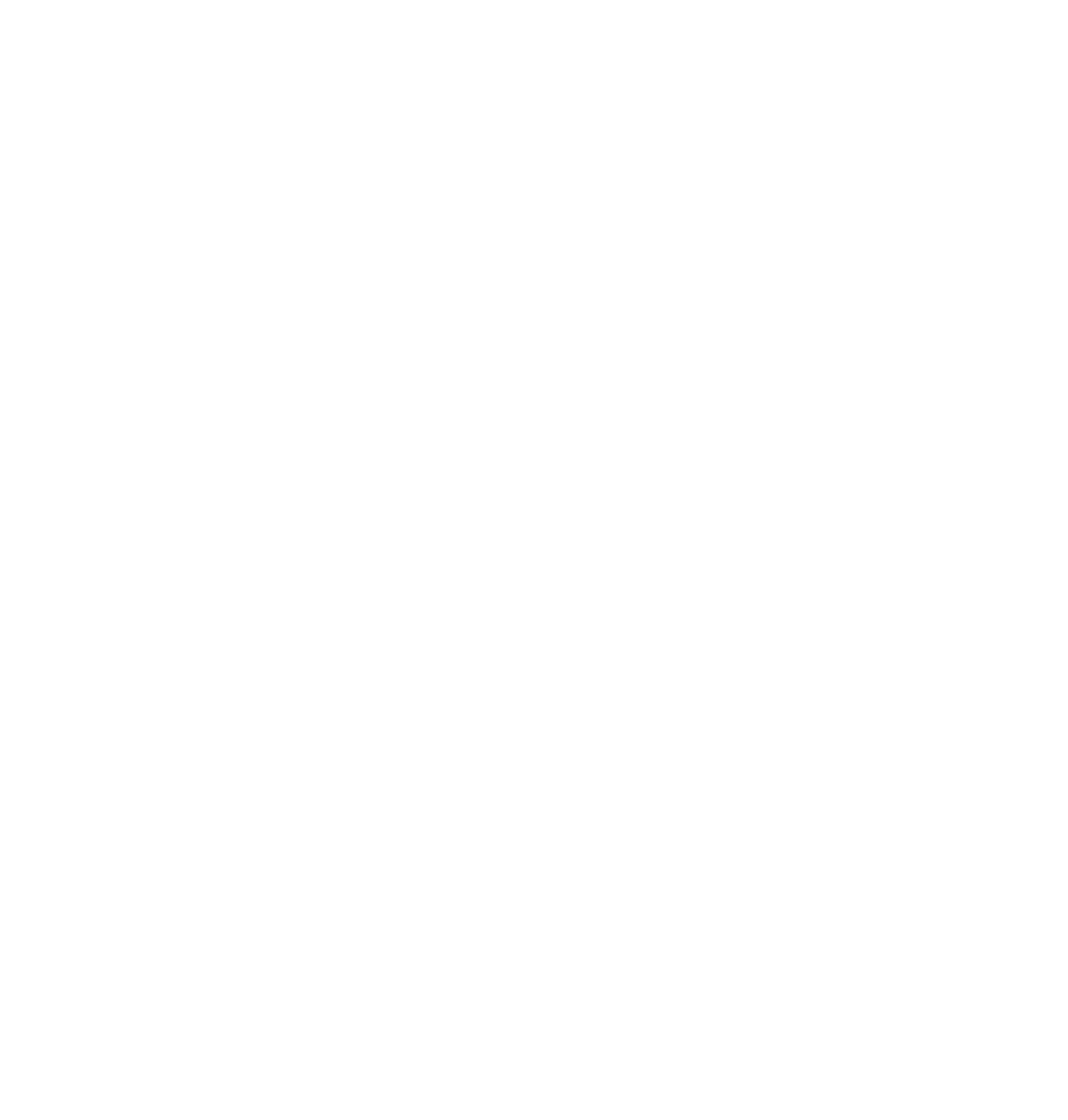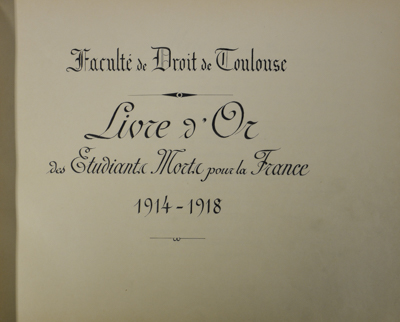Dès le début d’une guerre que l’on imaginait rapidement victorieuse, les pertes en vie humaines se sont avérées immenses et, pour en tenir à jour la comptabilité, l’on n’attendra pas la loi du 25 octobre 1919 « relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre » prévoyant la constitution d’un Livre d’or qui devait recenser les noms des fils de chaque commune ayant pris part au conflit. Pour des raisons financières d’ailleurs, les 120 volumes prévus ne verront pas le jour. Comme bien d’autres institutions, la faculté de droit de Toulouse prend rapidement l’initiative de dresser la liste « glorieuse et funèbre » de ses étudiants tués au combat et, le 2 décembre 1918, le doyen Maurice Hauriou pourra annoncer à ses collègues que « les dossiers […] sont à peu près réunis ». Une commission composée de trois professeurs est dès lors chargée de veiller aux opérations de publication de l’ouvrage qui dénombrera 227 notices et se présentera sous forme d’un gros volume gainé de cuir marron, à la première page de couverture ornée d’un bandeau de fleurs dorées et enrichie d’un passage emprunté à l’Énéide : Manibus date lilia plenis, « Donnez des lys à pleines mains ».
Tôt commencée puisque l’on voit le doyen Hauriou contacter les familles en 1917, la tâche ne sera achevée qu’en 1924. Elle s’est en effet avérée bien plus ardue qu’il aurait pu y paraître de prime abord, d’autant que, dans un premier temps, la faculté a envisagé de recenser, avec une photographie de chacun d’eux, non seulement ceux qui sont décédés en service ou ont été portés disparus, mais aussi ceux qui n’ont subi que des blessures ; ce projet sera finalement abandonné. En outre, on a voulu entendre le terme « étudiant » dans un sens large ne se limitant pas à ceux qui suivaient les cours de la faculté lorsqu’ils ont revêtu l’uniforme, mais incluant aussi « les anciens » ayant quitté ses murs et engagés dans la vie active depuis parfois bien des années, dont on a souvent perdu la trace qu’il a fallu retrouver. Enfin, l’inscription dans un Livre d’or, tout comme sur un monument aux morts suppose que soient remplis des critères précis. La loi du 2 juillet 1915 dispose, avec effet rétroactif au 2 août 1914 (donc au jour de la mobilisation générale), que la mention « mort pour la France » doit, après avis positif de l’autorité militaire, être portée sur l’acte de décès des personnes ayant trouvé la mort du fait de la guerre, dans des circonstances qu’elle énumère : civils et militaires tués à l’ennemi, morts des suites de leurs blessures ou de maladies contractées en apportant des soins aux militaires blessés ou malades. Elle est complétée par la loi du 28 février 1922 qui inclut les militaires « morts de maladie contractée en service commandé, ou encore des suites d’accidents survenus en service ou à l’occasion du service, en tant de guerre » et précise que, lorsque l’acte de décès « ne contiendra pas, par erreur administrative, omission ou toute cause la susdite mention », l’officier d’état civil devra, toujours sur avis favorable de l’autorité militaire, l’inscrire en marge du document. Autant de précautions qui ne gommeront pas toutes les difficultés. Le cas de Marc Araou en est une illustration parfaite. En mai 1917, en tentant de poser son avion de chasse atteint d’une panne de moteur, il percute des lignes télégraphiques. L’appareil s’écrase mais le pilote s’en sort vivant et, bien que fortement contusionné, reprend ses missions de combat. Atteint de lésions internes, il doit pourtant rapidement renoncer ; évacué, il mourra finalement à son domicile de Béziers le 22 mai 1919, à l’âge de 23 ans. Est-il bien « mort pour la France » s’interrogera longuement l’administration, alors même qu’il a été cité à l’ordre de la division et décoré à titre posthume de la médaille militaire, puisque l’acte de décès ne l’indique pas et que la mairie de Béziers s’est contentée de déclarer qu’il « avait été réformé temporairement et serait mort de maladie contractée en service ». En dépit de l’impatience du doyen Hauriou qui, le 28 février 1922, relève que, s’il est mort de maladie contractée en service, il remplit bien les conditions exigées par la loi, l’état civil biterrois fait de la résistance ; l’acte de décès est muet et, si le jeune homme « est en réalité » décédé dans les circonstances prévues par les textes, c’est à sa famille, dûment munie de l’avis militaire favorable, de faire la demande d’inscription. Marc Araou obtiendra finalement de figurer dans le Livre d’or ; les lenteurs administratives feront cependant que, malgré la demande que formule encore son père le 17 janvier 1924, son nom ne sera pas inscrit sur le monument des étudiants de la faculté de droit morts pour la France : « Trop tard. Plus une seule place », note sur son dossier le secrétaire de la faculté.
Accompagnée d’un courrier type signé par le doyen Hauriou, la collecte des renseignements s’est faite par le biais de l’envoi aux familles d’un questionnaire détaillé, riche de 15 rubriques : nom, prénoms, date et lieu de naissance, situation civile au jour de la mobilisation, régiment (ou formation) auquel l’étudiant appartenait, grade militaire au jour de la mobilisation, promotions de grade obtenues et dates de la promotion, grade militaire au jour de la mort ou de la blessure ou de la décoration ou de la citation, combats auxquels il a pris part, lieu où il est tombé ou a été blessé, blessures reçues, citations obtenues, décorations décernées, œuvres qu’il a publiées avant ou pendant la guerre, indication des notices qui ont été écrites sur lui ou sur ses œuvres. La fiche de renseignements prévoit qu’elle sera complétée par le père, la mère, le tuteur ou le frère du soldat. Si les réponses émanent le plus souvent des pères, les plus proches parents ne trouvent pas toujours le courage de raviver leur douleur en se plongeant dans la relecture des documents indispensables ou en effectuant les démarches nécessaires. D’autres diffèrent si longuement que le nom de leur fils ne figurera pas dans le Livre d’or ; le dossier de Melchior Ferrand, tué le 20 décembre 1914, ne sera ainsi réexpédié à la faculté que le 15 mai 1924, son père ne fournissant de surcroît que des « renseignements incomplets » car, fait-il valoir, son fils « se trouvait à cette époque dans un régiment qui ne comptait personne du pays » (en l’occurrence Saverdun), tandis que « ses chefs [sont] tombés en même temps que lui ». Intervient alors un grand-père, un oncle, un ami, un camarade de combat, celui qui a succédé au disparu dans les fonctions qu’il exerçait avant la guerre, un ancien condisciple, un confrère, voire, dans un cas, la sœur de la veuve remariée d’un ancien étudiant mort au combat. Assez étrangement, le document a parfois été transmis à l’étudiant qui répond lui-même, soit depuis le front, soit après la guerre lorsqu’il a survécu. Faute de réponse ou lorsque les tentatives pour localiser un membre de la famille ont échoué, il faudra procéder à une véritable enquête auprès des administrations civile et militaire. Ainsi en est-il, entre autres exemples, du cas de Ferdinand Ducassou né à Carcassonne le 27 novembre 1885 et qui n’a fréquenté les bancs de la faculté que durant l’année universitaire 1910-1911. On sait, par une brève note fournie par « Maître Marignac, ancien huissier de justice [à Toulouse] qui avait cédé sa charge, peu de temps avant la guerre, à M. Ducassou et a dû la reprendre en attendant de lui trouver un nouveau titulaire », qu’il « a pris part aux combats de Verdun », y a été grièvement blessé à une date inconnue et qu’il est mort des suites de ses blessures à l’hôpital militaire de Marseille le 3 mars 1920. Tout ceci demande confirmation. Comme « il habitait Toulouse depuis longtemps », le doyen Hauriou se rapproche donc des services de l’état civil toulousain qui ne possèdent aucune trace d’une transcription de décès. Simultanément, est contactée l’administration du 217e régiment d’artillerie lourde dans les rangs duquel servait Ducassou lorsqu’il a été blessé. Nouvel échec : l’intéressé étant « inconnu dans les contrôles du Corps », il faut s’adresser « au recrutement de Carcassonne » ou à celui de Toulouse selon qu’il était domicilié dans l’une ou l’autre ville au moment de son incorporation. L’interlocuteur compétent dûment contacté se chargera ensuite de transmettre la requête « au Corps ou l’intéressé comptait lors de son décès ». Ce à quoi s’emploie sans délai la faculté qui essuie un second échec. Au terme de nouvelles démarches, il s’avère finalement que, lorsque Ferdinand Ducassou avait été appelé au service militaire en 1906, il dépendait de la subdivision et donc du « recrutement » de Marseille, qui, en confirmant la date et le lieu de décès, indique qu’il avait été incorporé au 13e régiment de dragons, unité qu’il avait rejoint le 2 août 1914 avant d’être affecté au 17e régiment de réserve du train et, finalement, au 57e d’artillerie lourde ; le dossier est enfin complet… au début du mois d’avril 1922.
Dans de nombreux cas, les familles ne se sont pas limitées aux informations succinctes sollicitées par la faculté. Faisant œuvre pieuse, elles ont alors constitué un volumineux dossier comprenant extraits de lettres envoyées du front par leurs enfants, témoignages de camarades de combat ou de supérieurs hiérarchiques, notice nécrologique parue dans la presse locale ou une revue professionnelle, faire-part de décès accompagné de gravures patriotiques, etc. À plusieurs reprises, y ont été joints de véritables opuscules comprenant parfois plusieurs dizaines de pages, publiés à compte d’auteur et retraçant dans le détail la vie du jeune homme. Il faudra alors procéder à un patient travail de synthèse, aboutissant à la rédaction de la notice individuelle figurant dans le Livre d’or ; brève, elle se limitera aux indications essentielles : nom, prénoms, date et lieu de naissance, scolarité et diplômes, parfois la profession, grade et unité, date et lieu du décès, extraits des citations et mention des décorations éventuelles. Tout ceci, non sans quelques omissions et erreurs. Parmi ces dernières, la plus flagrante concerne Joseph-Noël (Édouard, Anselme, Simon), tué dans la Somme « entre Cléry et Maurepas », sans que l’on sache précisément où, sans non plus que soient mentionnés son grade et l’unité dans laquelle il servait ; il figure dans le Livre d’or ainsi que sur le monument aux morts de la Grande Guerre de la faculté sous le nom de Simon (Édouard, Anselme). Il est vrai qu’il était né bien loin de la métropole, en Martinique, dans la commune de Lamentin et que la faculté s’est satisfaite des informations fort parcellaires et erronées transmises par le commandant du bureau de recrutement des Antilles. Il faut donc se reporter à la liste des morts pour la France gravée sur le monument de sa ville natale qui, elle, ne s’y est pas trompée, pour rétablir sa véritable identité.
Olivier Devaux, professeur d’histoire du droit (université Toulouse-1-Capitole)
Indications bibliographiques
Devaux Olivier, Garnier Florent, Ceux de la faculté : des juristes toulousains dans la Grande Guerre, « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », no 24, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2017.
Fillon Catherine, « De la chaire au canon. Les engagements combattants des enseignants des facultés de droit pendant la Grande Guerre », dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, no 35, 2015, p. 11‑30.
Gojosso Éric, « Les ‘Morts pour la France’ de la faculté de droit de Poitiers durant la Première Guerre mondiale », dans Cahiers poitevins d’histoire du droit, no 2, 2009, p. 221‑227.
Mesquida Raoul, Les monuments aux morts de l’université Toulouse-1-Capitole : une mémoire vivante de la Grande Guerre, Mémoire de master 2 d’histoire du droit et des institutions, soutenue à l’Université Toulouse-1-Capitole, 2017.