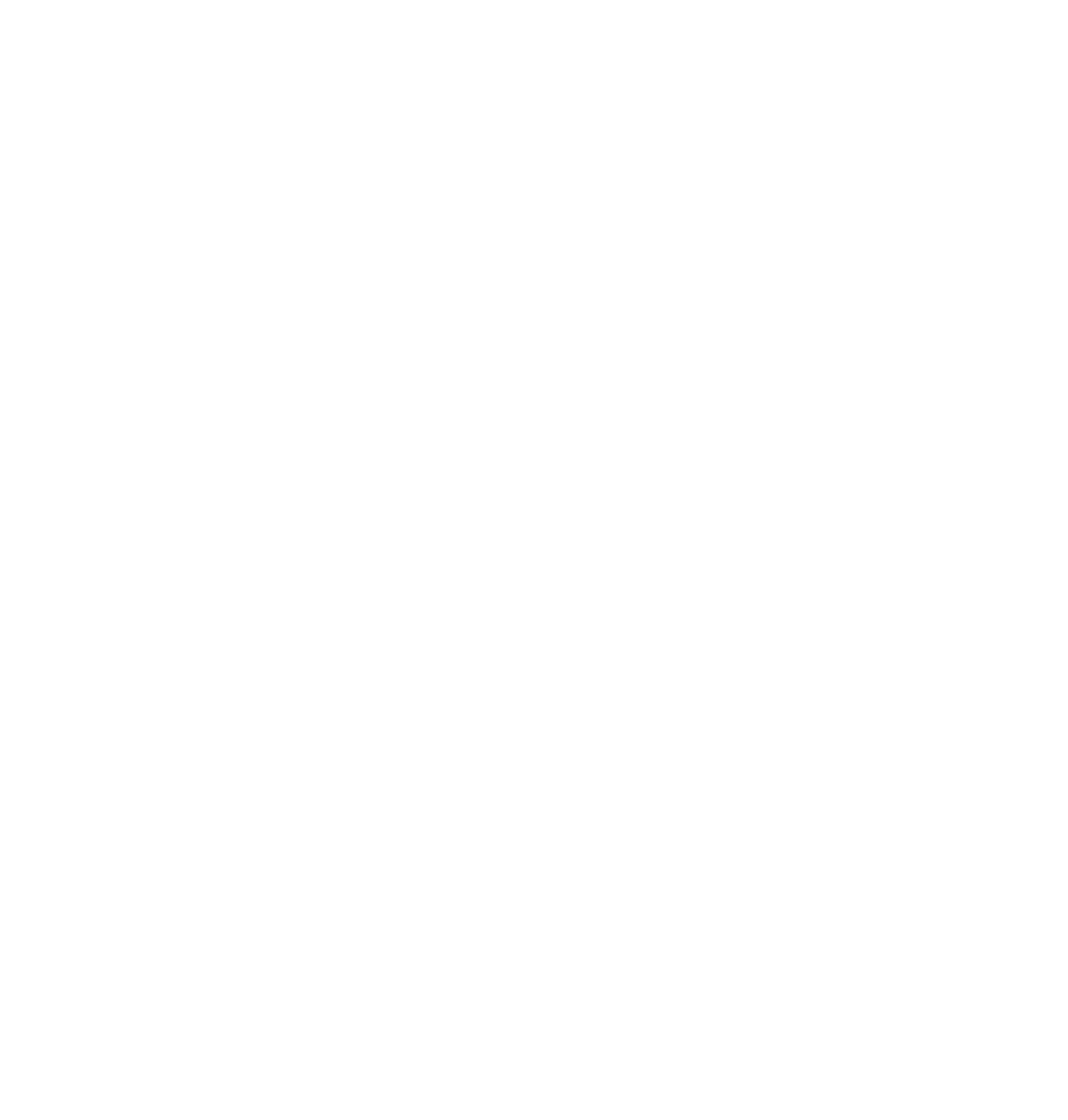L’acte de violation de la neutralité des États belges et luxembourgeois, commis par l’Allemagne dans les premiers jours du mois d’août 1914, a puissamment contribué à façonner une représentation du conflit dans laquelle la France et ses alliés ont eu beau jeu de se poser en vertueux champions du droit menacé par la barbarie germanique. Mais il a eu, aussi, pour effet paradoxal de placer les pays neutres au cœur de cet affrontement où ils refusaient d’entrer militairement. Car l’attitude désinvolte de l’Allemagne à l’égard de deux États bénéficiant d’un pareil statut, reconnu et protégé par des traités internationaux qu’elle-même avait ratifiés, le mépris affiché à l’égard desdits traités, ramenés au rang de « chiffons de papier » par le chancelier Bethmann-Hollweg, ne constituaient pas seulement une radicale remise en cause de la discipline balbutiante qu’était alors le droit international et, au-delà de lui, du droit dans son entier. Ces actes et ces termes étaient encore une énorme faute politique, dont l’impact fut considérable sur les opinions publiques des États non belligérants. Aussi, dès l’été 1914, en parallèle des opérations militaires, un intense combat de propagande en direction des neutres était engagé par les divers belligérants, l’Allemagne n’ayant de cesse de vouloir justifier l’agression commise à l’endroit de la Belgique et du Luxembourg quand ses adversaires, pour leur part, travaillaient d’arrache-pied à l’enfermer dans l’image d’une nation gouvernée par la seule ivresse de la force, définitivement incapable de respecter ses engagements tant juridiques que moraux.
C’est dans cette bataille intellectuelle que le professeur parisien Albert Geouffre de La Pradelle fut plongé dès le mois d’août 1914. Il était à bien des égards très qualifié pour le rôle qu’il était appelé à jouer au pied levé, mais s’il prit dans les premiers jours du mois de septembre 1914 le chemin de l’université Columbia de New York, il le dut assurément aussi à une conjonction de hasards, d’opportunités et de nécessités. Ayant vite administré la preuve de sa capacité à pratiquer l’art délicat de la propagande en sourdine, cher à l’ambassadeur de France Jean-Jules Jusserand, le professeur de La Pradelle a poursuivi son action aux États-Unis jusqu’à l’entrée en guerre du pays.
Une mission hâtivement improvisée
Encore balbutiantes et ténues à la veille de la grande déflagration, les relations universitaires franco-américaines, un peu stimulées depuis 1895 par la création du comité France-Amérique, avaient connu un premier développement auquel, du côté français, l’on était d’autant plus attaché que l’on savait bien, depuis longtemps, l’attrait exercé par les universités allemandes tant sur la clientèle scolaire que sur l’élite universitaire américaines. Au moment de la création du comité France-Amérique, le professeur Furber avait noté la présence de plus de 200 étudiants américains inscrits à l’université de Berlin, quand celle de Paris ne pouvait en revendiquer qu’une trentaine. Si l’on imputait alors volontiers à une réglementation universitaire française, trop rigide, la responsabilité de la désaffection américaine à l’égard de l’enseignement supérieur français, l’on ne se méprenait pas sur les conséquences qu’entrainait cette dernière. Le professeur Furber les avait dépeintes en des termes qui avaient beaucoup frappé ses homologues français : « Les jeunes savants qui visitent l’Allemagne en nombre croissant influencent déjà l’opinion américaine. Berlin commence à être considérée comme La Mecque scientifique du monde… Il y a dans certains cercles, en Amérique, des manifestations de l’existence d’un culte pour la Germanie ; il y a un enthousiasme pour la pensée germanique où s’unit inconsciemment, avec la haute estime justement professée pour l’éducation allemande, une sympathie pour les aspirations politiques de l’Allemagne. Ce sont des causes comme celles-là qui souvent produisent les sympathies et les antipathies nationales. Les Américains étudiant en Europe sont ceux qui formeront les générations qui grandissent, et les sympathies de la nation américaine seront guidées par ces étudiants. »
Même si, à la veille du déclenchement du conflit, l’Université parisienne avait légèrement progressé dans la conquête de ce public étudiant bien spécifique, puisqu’elle comptait alors 84 étudiants américains (dont 72 pour la seule faculté des lettres, mais 5 seulement pour la faculté de droit), on peut parier qu’en août 1914 l’avertissement lancé deux décennies plus tôt par leur collègue américain résonnait à nouveau puissamment dans les esprits des responsables universitaires français.
Aussi, lorsqu’il apparut, au commencement d’août 1914, que la mobilisation du professeur de la faculté des lettres, Paul Hazard, empêcherait ce dernier d’occuper comme prévu, au premier semestre de l’année universitaire 1914-1915, la chaire française de l’université Columbia, il sembla absolument impératif de trouver un autre enseignant parisien, susceptible de porter la parole française dans cette prestigieuse institution américaine. Très déterminé à faire jouer à l’institution dont il avait la charge un rôle intellectuel actif dans le conflit, Ferdinand Larnaude, doyen de la faculté de droit, s’empressa de donner suite à l’idée qui lui avait été suggérée par son collègue romaniste, Gaston May. Il proposa donc au recteur Liard, qui l’accepta immédiatement, une solution de remplacement particulièrement bien adaptée aux nouveaux enjeux internationaux, en la personne d’Albert Geouffre de La Pradelle.
Ancien élève de la faculté de droit de Paris, agrégé en 1897, nommé à l’issue du concours à la faculté de droit de Grenoble, Albert Geouffre de La Pradelle avait réintégré sa faculté de formation en 1910. Nécessité administrative faisant loi, il avait été titularisé en 1912 sur une chaire de droit administratif (contentieux et finances) qui ne correspondait guère à sa véritable spécialité : le droit international public et privé qu’à la suite d’Antoine Pillet il avait enseigné à Grenoble pendant plus d’une décennie et à la promotion duquel il œuvrait de multiples manières. Membre associé de l’Institut de droit international, il avait déjà eu le loisir de travailler dans ce cadre sur les questions relatives à la neutralité des États. Il était aussi depuis 1909 le directeur de la Revue de droit international privé fondée par Darras. En 1913, à la faveur des travaux juridiques relatifs au protectorat marocain, Albert Geouffre de La Pradelle avait en outre fait son entrée dans le groupe des experts du ministère français des affaires étrangères. Bien connu des services diplomatiques parisiens, il ne leur était toutefois pas aussi indispensable que l’était en revanche son maître, Louis Renault. Âgé de quarante-trois ans, sans enfants mobilisés au contraire de ses collègues plus âgés, Antoine Pillet et André Weiss, et bien qu’il ne parlât pas anglais au moment de son départ pour les États-Unis, il apparaissait comme le candidat le plus approprié pour cette mission, d’autant que sa charge d’enseignement pouvait facilement être assurée par Joseph Barthélemy, lequel s’apprêtait à être installé à la rentrée 1914 en qualité d’agrégé à la faculté de droit de Paris.
Le 5 septembre 1914, heureux bénéficiaire d’un sursis de mobilisation au titre du ministère des Affaires étrangères, il montait à bord du bateau qui devait le conduire à New York avec la mission officielle donnée par l’Université parisienne de délivrer en sa qualité de visiting professor à Columbia un enseignement consacré au droit de la guerre. Bien évidemment, sa mission officieuse consistait à discréditer le plus possible l’Allemagne, en faisant savoir aux Américains comment le droit était compris et pratiqué par l’ennemi. Nul ne s’en doutait encore, mais le semestre d’enseignement allait se prolonger en un séjour de près de trois ans.
Certes, dès l’automne 1914, les illusions que l’on avait pu nourrir quant à la brièveté de la guerre étaient dissipées. En conséquence, l’enlisement dans un conflit épuisant, dont le terme ne se laissait pas aisément deviner, rendait désormais plus cruciale encore la préservation de la neutralité bienveillante de la première puissance économique mondiale à l’endroit de la France et de ses alliés. De celle-ci, dépendaient en large part non seulement la poursuite de l’effort matériel de guerre, puisque les États-Unis fournissaient à la France, pêle-mêle, matières premières, munitions, crédits financiers, mais aussi la réussite d’un blocus maritime de l’Allemagne que les États-Unis, forts attachés à la liberté des mers, n’appréciaient que très modérément. Or, la France était sans aucun doute le meilleur atout de l’Entente outre-Atlantique : la Russie, archaïque et autocratique, déplaisait fort outre-Atlantique et l’Angleterre, l’ancienne puissance coloniale, faisait naître des sentiments ambivalents qui tournaient facilement à l’exaspération.
Ce changement de circonstances n’explique toutefois pas à lui seul le renouvellement de la mission de Geouffre de La Pradelle à partir du printemps 1915 ; mission désormais placée sous l’égide du ministère français des Affaires étrangères. Si l’universitaire parisien est demeuré aussi longtemps aux États-Unis, c’est surtout parce qu’il avait épousé les vues stratégiques subtiles que l’ambassadeur de France, Jean-Jules Jusserand, défendait opiniâtrement depuis le commencement du conflit.
Un auxiliaire exemplaire de l’ambassadeur de France aux États-Unis
Dès les premières semaines du conflit, Jusserand avait établi le constat que l’opinion américaine, certes viscéralement pacifiste et dont il ne fallait pas espérer qu’elle basculerait dans la guerre avant longtemps, était dans sa grande majorité spontanément favorable à une France à laquelle l’attachaient des liens historiques fondateurs et une identité de régime politique républicain et démocratique. Il en avait conclu qu’il fallait absolument se garder de déployer une propagande outrancière et agressive du type de celle à laquelle l’Allemagne se livrait et il expliquait à longueur de rapports adressés au Quai d’Orsay qu’il ne fallait pas s’inquiéter outre mesure des dix millions de citoyens américains d’origine allemande, lesquels étaient bien peu susceptibles de faire pencher la balance sentimentale en faveur de leur pays d’origine. En effet, la propagande tapageuse orchestrée à grands frais par l’Allemagne – et très précisément par l’ancien secrétaire d’État aux Colonies Bernhard Dernburg, mandaté par le kaiser à cet effet – sapait leurs efforts, bien plus qu’elle ne les consolidait. Admirablement contre-productive, cette propagande agressive indisposait les interlocuteurs américains qui y étaient confrontés et, par son insistance même, elle corroborait les doutes sur le bien-fondé de la cause allemande. Intimement convaincu que les meilleurs propagandistes de la cause française n’étaient autres que les Américains eux-mêmes, la stratégie de Jusserand était dès lors simple, en même temps qu’économe des deniers publics : il suffisait de laisser agir les Américains. On pouvait leur fournir des faits, en s’abstenant soigneusement de vouloir orienter la lecture de ceux-ci ou de chercher à les convaincre à tout prix de la justesse de la cause française ; on devait les remercier à chaque fois qu’ils apportaient leur soutien à la cause hexagonale, mais plus encore on devait briller par la retenue et la discrétion – seules attitudes compatibles avec la posture de neutralité définie par le président Wilson – et afficher enfin une très grande dignité dans une adversité qu’il n’était pas question de nier. Or, cette ligne de conduite avait été précisément celle observée par le professeur parisien plongé depuis octobre 1914 dans l’atmosphère complexe d’une université Columbia où l’influence intellectuelle exercée par son ancien président, John W. Burgess, très favorable à cette Allemagne où il avait reçu une large part de sa formation universitaire, se faisait sentir sans légèreté, bien que le professeur fût officiellement à la retraite depuis 1913.
Ainsi qu’il l’expliquait à Jusserand dans une lettre du 27 février 1915, Geouffre de La Pradelle ne s’était jamais départi d’une attitude d’extrême prudence. Il s’était jusque là servi de sa qualité de professeur de droit international pour avoir un accès direct aux milieux universitaires et intellectuels new-yorkais dans lesquels par des conférences, soit techniques, soit accessibles au grand public, puis dans des conversations particulières, il s’était attaché à détruire « avec une modération de forme absolue, mais une fermeté de fond très grande, les doutes, les objections, les préjugés, les équivoques nés spontanément dans les esprits, ou plus souvent provoqués contre la politique française par les adversaires de la France ». Il s’était acquis dans le milieu universitaire des sympathies non négligeables comme celle du professeur de droit international E. C. Stowell qui, bien que sensible dans un premier temps aux arguments déployés par Dernburg, avait fini par basculer dans le camp francophile et s’apprêtait à le démontrer dans un ouvrage consacré aux origines de la guerre ou bien celle de l’historien Muzzey qui avait traduit en anglais, sous le titre de « War and Law » les conférences faites par le professeur français à Columbia pendant le semestre écoulé. Il avait réussi également à nouer de fructueux contacts avec les milieux journalistiques américains, de sorte que quelques-uns de ses articles avaient déjà été publiés dans Scribner’s Magazine, The Atlantic Monthly et le New York Times. De plus, il comblait les attentes de l’ambassadeur de France aux États-Unis lorsqu’il se disait convaincu qu’il fallait que la presse française relaye, avec les éloges de circonstances, les prises de position en faveur de la France émanant des universitaires et des intellectuels américains. Aux yeux d’un diplomate persuadé que « la meilleure propagande que nous puissions faire ici consiste à marquer chez nous le cas que nous faisons des preuves de sympathie que nous donnent les Américains. », Geouffre de La Pradelle, « collaborateur de la Revue Bleue, de La Revue Hebdomadaire, de la Revue de Paris, de la Revue des deux mondes, de la Revue politique et parlementaire, sans compter Le Temps, le Journal des débats », était une intéressante courroie de transmission entre les États-Unis et la France. Alors qu’il redoutait constamment que Paris ne lui envoie des missionnaires maladroits et peu subtils, l’ambassadeur Jusserand décernait au professeur parisien un rare satisfecit quand il faisait savoir qu’il n’entendait pas se priver des services d’un collaborateur intelligent « réservé de manières, modéré de langage, fort expert en sa partie », lequel avait compris la nécessité de dissimuler son action de propagande politique sous le paravent d’une paisible et pacifique activité universitaire, ayant toutes les apparences de l’objectivité scientifique.
Jusserand tenait probablement d’autant moins à se priver des services d’Albert de La Pradelle que celui-ci était lié, dès avant la guerre, par une amitié probablement nouée dans le cadre de l’Institut de droit international, avec James Brown Scott. L’ancien professeur de Columbia, ancien doyen de l’université de l’Illinois, avait été le fondateur de l’université de Californie. Son carnet d’adresses très fourni offrait à son collègue français l’opportunité de s’introduire plus avant dans le milieu des juristes universitaires américains. En outre, très proche des cercles du pouvoir, James Brown Scott était alors président du Board of Neutrality et Jusserand notait que son amitié pour Geouffre de La Pradelle permettait de faire triompher des solutions très françaises aux divers problèmes juridiques posés par la guerre. Enfin, Brown Scott était membre de la Dotation Carnegie pour la paix internationale et président de l’Institut américain de droit international. À ces deux derniers titres, il avait proposé dès le commencement de l’année 1915 à l’ami français de prendre part à une tournée de conférences à travers toute l’Amérique du Sud. Officiellement destinées à susciter la création de sociétés locales de droit international, essentielles pour le développement de l’Institut, ces conférences devaient surtout promouvoir cet idéal de la paix par le droit auquel les deux internationalistes étaient très attachés. Au cours de cette vaste tournée de conférences, Geouffre de La Pradelle devait intervenir en sa qualité de Français, représentant non pas son pays, mais le droit dans sa dimension internationale. Si cette opportunité de continuer à travailler en sous-main à la défense des intérêts de la France à une échelle spatiale plus vaste encore, séduisait grandement le professeur, elle fit en revanche grincer bien des dents en France, tant au ministère de l’Instruction publique qu’au rectorat de l’académie de Paris. La Dotation Carnegie étant connue pour être une organisation profondément pacifiste, les autorités parisiennes jugèrent bien peu judicieux qu’un professeur de droit français se range sous son égide et prenne le risque, en plein conflit, d’apparaître comme un porte-parole de la paix. Aussi, en juin 1915, à quelques jours de son départ, Geouffre de La Pradelle recevait-il l’ordre de s’abstenir de participer à cette entreprise que son gouvernement jugeait contraire à sa préoccupation première : gagner la guerre. Il consacra son temps devenu libre à une tournée de conférences, réalisées dans le cadre de l’Alliance française, ainsi qu’à la préparation d’un petit ouvrage : War letters from France. Composé d’extraits soigneusement choisis de lettres de Français, civils ou militaires, adressées à leurs amis résidant en Amérique, l’ouvrage confortait cette image de la France que les journalistes américains volontiers pro-français véhiculaient déjà spontanément depuis deux ans : l’image d’une France courageuse, calmement déterminée, toute imprégnée de la conviction qu’elle combattait, non pas égoïstement pour sa seule survie, mais au service d’un idéal bien supérieur, celui de la défense des droits et des libertés des nations…
Ayant finalement réussi à vaincre les réticences de ses autorités de tutelle parisiennes, que ses liens avec la Dotation Carnegie avaient fait naître en 1915, Geouffre de La Pradelle effectua à partir de l’automne 1916 le périple annulé l’année précédente. Ce dernier le conduisit à travers le Pérou, le Chili, le Brésil et l’Argentine. À la demande de l’Université de Paris et du ministère de l’Instruction publique, il profita de l’opportunité qui lui était ainsi offerte pour explorer aussi les possibilités de partenariats universitaires dans cette partie du monde jusqu’alors négligée.
Au terme de trois années consacrées à la pratique délicate de la propagande en sourdine, les États-Unis étant finalement entrés en guerre en avril 1917, la mission d’Albert Geouffre de La Pradelle prenait logiquement fin. Outre la remise de la Légion d’honneur, les services rendus au pays lui valurent de prendre tout naturellement la succession de son maître Louis Renault, décédé en février 1918, non seulement à la faculté de droit, mais encore au ministère des Affaires étrangères, dont il devenait en 1919 l’un des jurisconsultes attitrés, et d’être désigné en qualité d’expert de la délégation française à la conférence de la Paix.
Au sortir du conflit, c’est à une nouvelle œuvre de propagande intellectuelle que Geouffre de La Pradelle allait se consacrer, sans risquer désormais d’encourir les foudres de son gouvernement : celle en faveur de la Société des Nations, fragile institution censée donner vie à l’idéal de la paix internationale par le droit.
Catherine Fillon, professeure d’histoire du droit (université Jean-Moulin-Lyon-3)
Indications bibliographiques
Guieu Jean-Michel, Le rameau et le glaive : les militants français pour la Société des Nations, Paris, France, Presses de Sciences Po, 2008.
Nouailhat Yves-Henri, France et États-Unis : août 1914-avril 1917, « Publications de la Sorbonne », Paris, France, Institut d’histoire des relations internationales contemporaines, 1979.
Rousseau Charles, « Albert Geouffre de La Pradelle », dans Revue internationale de droit comparé, vol. 7, no 2, 1955, p. 383‑384.
« Rapport Lavisse », Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Direction de l’Enseignement supérieur, Règlement des Universités, Paris, France, 1897, p. 56‑64.
« Rapports des conseils des universités pour l’année scolaire 1910-1911 », Collection Enquêtes et documents relatifs à l’enseignement supérieur, Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Paris, France, 1912.
« PV du conseil de la faculté de droit de Paris », Archives nationales de France, AJ/16/1799, Paris, France.
« Mission Geouffre de La Pradelle », Centre des archives diplomatiques, 1 CPCOM511, La Courneuve, France.