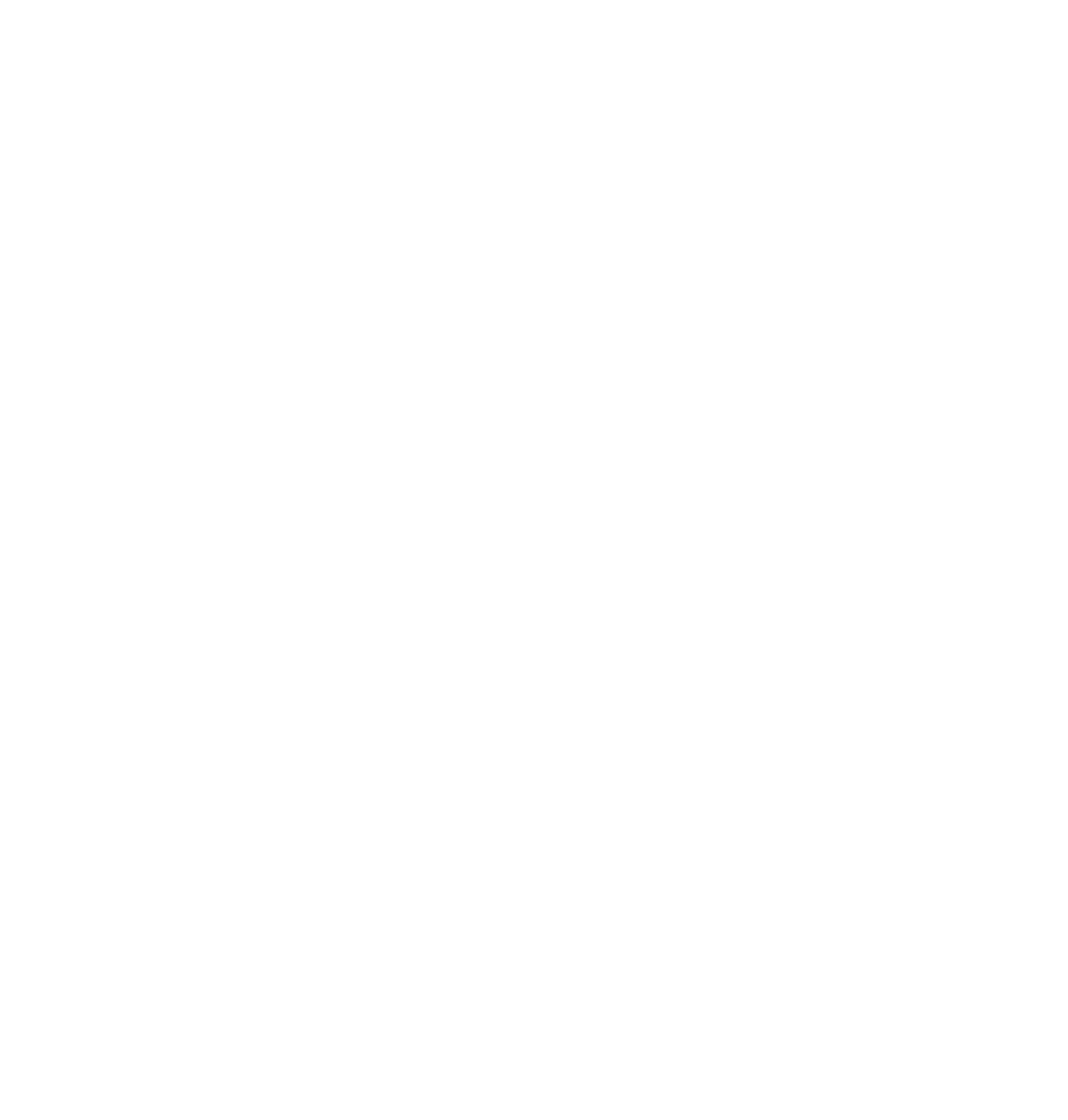Épreuve pour la société française dans son ensemble, la Grande Guerre l’est aussi pour l’Université, et notamment les facultés de droit. Ces « petites sociétés diverses », selon les mots d’Emmanuel Kant, qui seraient une parcelle de l’« État scientifique » qu’est l’Université, sont alors bouleversées par un conflit qui mobilise toute la société dans l’effort de guerre. Les facultés de droit, selon une tradition bien ancrée, sont jusqu’à présent demeurées assez fermées à l’extérieur. Jouissant de la position de « facultés professionnelles », au même titre que les facultés de médecine, elles n’ont cessé d’attirer dans leurs amphithéâtres, des promotions d’étudiants dont les effectifs importants ont garanti les finances, ainsi que la croissance du corps enseignant. En outre, cette affluence a rendu difficile l’usage même des locaux universitaires, pourtant reconstruits dans les premières décennies de la Troisième République.
Quelques mois après le début des hostilités, en novembre 1914, la traditionnelle rentrée solennelle, l’une des rares manifestations universitaires où le public se masse aux côtés des professeurs, étudiants, et notabilités locales et nationales, révèle l’ampleur de la mobilisation. Si les professeurs de la faculté de droit de Paris, les plus présents à travers la presse nationale, en ont pour beaucoup été épargnés en raison de leur âge, il en est tout autrement pour ceux des facultés provinciales mais surtout pour les étudiants, appelés en masse pour défendre la patrie. C’est donc à une poignée de réformés, de jeunes hommes non encore mobilisables et de quelques étudiantes que se résume désormais une promotion en faculté de droit.
En dépit de la désertification des amphithéâtres qui hier encore, étaient combles, les professeurs demeurés à l’arrière cherchent malgré tout à apporter leur contribution à l’Union sacrée. Maurice Hauriou, doyen de la faculté de droit de Toulouse, fixe ainsi à l’universitaire, le but de défendre « la culture helléno-latine ». Son homologue parisien, Ferdinand Larnaude, affirme quant à lui vouloir préparer « la Victoire contre les Barbares ». La guerre à mener est donc plus profonde qu’un simple conflit interétatique : il s’agit de la « guerre du droit ». Dès lors, parmi les lettrés, les juristes qui n’ont pas rejoint les champs de bataille se trouvent investis d’une mission particulière, qui prend différentes formes sur la scène publique. En premier lieu, les facultés juridiques ouvrent leurs cours au public, qui s’y rend pour y voir des sommités académiques traiter de sujets liés à la guerre. Ces interventions ont en réalité pour objectif de démontrer les multiples fautes imputables à l’Allemagne. C’est le cas des interventions de Louis Renaud, le célèbre « juriste du ministère des Affaires étrangères » et prix Nobel 1907, qui traite du thème du « droit de la guerre continentale », mettant ainsi au jour les infractions allemandes à cet ensemble de règles juridiques. Pour leur part, les étudiants qui n’ont pas été mobilisés organisent les premières commémorations en l’honneur de leurs camarades et aînés tombés au combat. Une messe en leur honneur rassemble même les enseignements supérieurs du public et du privé en 1916.
La participation des facultés de droit à l’effort de guerre ne se limite pas cependant à cette adaptation du milieu universitaire aux conditions exceptionnelles du temps. Les facultés sont présentes au feu, ce dont le lecteur des journaux peut juger en scrutant les rubriques de « morts pour la France » consacrées au personnel du ministère de l’Instruction publique. Mais les maîtres de ces établissements qui demeurent à l’arrière travaillent également à concevoir de nouveaux mécanismes juridiques, à même de faire face au contexte sans précédent. Ils créent ainsi le Comité national d’action pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre, qui devient leur espace de réflexion de prédilection durant le conflit. Confrontés aux destructions effroyables provoquées par celui-ci, et s’appuyant sur une loi votée à la fin de l’année 1914 prévoyant la création future de mécanismes de réparation, ils entendent ainsi contribuer par leur expertise à la volonté nationale. D’ailleurs, s’attachant à concevoir les règles selon lesquelles particuliers et professionnels pourront requérir une indemnisation auprès de l’État, ils semblent échapper, contrairement à leurs collègues d’autres disciplines, à la simple promotion des vertus d’une société démocratique face à la barbarie, sur un fond d’antigermanisme latent depuis la défaite de 1870. Jusqu’à la fin des hostilités, la question de l’indemnisation des dommages de guerre demeurera donc la vitrine de la participation des juristes universitaires à la mobilisation collective. Elle leur permettra même d’occuper un rang à part dans le monde académique en confortant leur image d’experts libres de toute inférence idéologique et politique, image qu’ils recherchaient depuis si longtemps.
La paix qui se dessine à compter de la signature de l’Armistice à Rethondes, le 11 novembre 1918, semble devoir mettre à nouveau à contribution les facultés de droit, si ce n’est davantage. Le droit international doit en effet devenir l’outil d’une paix durable. Ainsi, à la « guerre du droit », succède la « paix par le droit ». Toutefois, la reconstruction dans laquelle sont engagées les facultés de droit s’annonce difficile. Deux mondes facultaires, séparés pendant la guerre, se trouvent à nouveau réunis : celui qui s’est fondu dans la masse des combattants partis au front, et celui qui a pris part à la mobilisation intellectuelle à l’arrière. Pour ce dernier, cette réunion signifie l’émergence d’un certain nombre de problèmes concrets. Car s’agissant d’idéologie, lorsque les professeurs démontraient l’innocence de la France dans le déclenchement des hostilités, ou bien de technique, lorsqu’ils déterminaient les contours de l’indemnisation des dommages matériels, ils s’en tenaient essentiellement à des constructions théoriques. La constatation de l’étendue des destructions, mais surtout le retour des soldats à la vie civile provoquent un choc dans l’ensemble de la société française, qui résonne tout particulièrement dans les facultés de droit. Elles essuient en effet un lourd bilan de quatre années de guerre. Leurs effectifs estudiantins mettront d’ailleurs près de dix ans à regagner ceux d’avant 1914. Tout cela se mêlant à la joie de la victoire et de la paix retrouvée fait planer une atmosphère étrange qui fera le substrat de la reconstruction.
Au lendemain de la Grande Guerre, les facultés de droit se trouvent donc tiraillées entre mémoire du sacrifice, et devoir de surmonter l’épreuve d’un conflit particulièrement meurtrier. La même tension est visible dans toute la société française, mais pour ce qui est du second impératif, les facultés juridiques doivent redoubler d’énergie car elles sont des dépositaires du droit international, présenté comme une clef de la paix. En réalité, les deux visages qui ont été ceux des facultés juridiques pendant le conflit, l’un idéologique et galvanisant, l’autre scientifique et pragmatique, ne cessent de coexister. Elles apparaissent ainsi comme des agents nettement ambivalents. Clamant la victoire sur l’ennemi allemand, elles entretiennent l’esprit de la revanche. Mais participant à la construction d’une paix durable, elles tentent également de surmonter les querelles passées.
De Strasbourg à Versailles : consacrer la victoire
Depuis le début de la Troisième République, la mémoire des territoires perdus de l’Alsace et de la Lorraine a fait planer le spectre de la défaite face à la Prusse. Le monde universitaire s’en trouve également meurtri par l’amputation de ses facultés strasbourgeoises. Aussi, en janvier 1919, c’est avec fierté que les quotidiens nationaux annoncent que le drapeau français flotte à nouveau sur l’université alsacienne. Les professeurs allemands en sont congédiés sans ménagement. Ce retour de l’Université française, après plus de quarante ans d’absence, a tout d’abord lieu dans la précipitation, mais la rentrée solennelle de l’année suivante promet d’être fastueuse. Y assistent le président de la République Raymond Poincaré, mais aussi l’Académie française, à travers la personne du philosophe Henri Bergson, ou encore celui que l’on présente comme le « vainqueur de Verdun », Philippe Pétain. Rien n’est laissé au hasard pour marquer le retour dans le giron français, de cette « forteresse du pangermanisme ».
Les délégués des étudiants strasbourgeois sont reçus au palais de l’Élysée dès le mois de juin 1919. Ils visitent alors le château de Versailles, où doit avoir lieu la signature du traité de paix avec l’Allemagne, à peine deux semaines plus tard. Ferdinand Larnaude, doyen de la faculté parisienne, y est d’ailleurs présent au sein de la délégation française. Ayant participé à la rédaction d’un mémoire à la demande du Gouvernement afin d’établir la responsabilité du kaiser dans le déclenchement de la guerre, il y porte d’ailleurs l’idée d’un tribunal spécial, qui cependant ne verra jamais le jour.
La conférence de la Paix recèle cependant un enjeu plus important : la fixation du montant des indemnités dues par l’Allemagne et ses alliés. C’est en réalité la contrepartie de la « charte des sinistrés », votée en avril 1919, qui met en place la fameuse procédure d’indemnisation sur laquelle se sont penchés les professeurs de droit depuis plus de quatre ans. En effet, si les discussions se sont longtemps concentrées sur les règles à adopter, afin d’indemniser les citoyens lésés de la manière la plus juste, la contrepartie de l’indemnisation a toujours résidé dans le paiement d’un lourd tribut par l’ennemi. La conférence de la Paix rappelle ainsi que les jurisconsultes n’ont pas seulement œuvré pour une indemnisation intégrale. Leur démarche avait aussi pour objectif la maximisation de l’évaluation des destructions afin de faire peser les plus lourdes sanctions financières sur l’Allemagne.
C’est d’ailleurs contre l’avis de la France que le traité de Versailles retient la responsabilité conjointe de l’Allemagne ainsi que de ses alliés. Son article 231 fixe le montant total des indemnités à 132 milliards de marks-or. Sur cette somme, seuls 52 milliards doivent être versés immédiatement. Cet ajournement de la dette doit permettre à ses titulaires d’en demander ultérieurement la révision. Toutefois, la France mettra toujours un point d’honneur à appliquer la devise du ministre des Finances de l’époque, Louis-Lucien Klotz : « l’Allemagne paiera ». Les professeurs de droit emboîteront d’ailleurs le pas au Gouvernement en rassérénant, sans succès, la valeur normative du traité de Versailles et en dénonçant la mauvaise foi allemande à chaque nouvelle opportunité de révision, en 1924 par le plan Dawes et en 1931 par le plan Young.
L’attitude des professeurs de droit au lendemain de la victoire est pour le moins déroutante. Parmi les intellectuels qui ont pris part à l’effort de guerre, ceux-ci se sont illustrés par une distance marquée à l’encontre de la passion guerrière. Leur cours publics, à vocation nettement idéologique, se sont d’ailleurs raréfiés à partir de 1916, époque à laquelle la lassitude a grandi à travers le pays. Néanmoins, tandis que les autres intellectuels prennent rapidement leurs distances avec les simplifications qu’ils ont opérées, l’adhésion soudaine des maîtres juristes à une victoire où le vainqueur écrase les vaincus, ressemble fortement à un revirement. Toutefois, ce dernier s’inscrit dans une tendance forte, dont le Gouvernement est l’initiateur. Ce comportement attire d’ailleurs les foudres de la presse de gauche à partir des années 1920, qui déplore par exemple que l’hommage aux morts soit récupéré, au sein de la faculté de droit de Paris, par des étudiants de l’Action française désireux d’attiser l’inimitié entre les peuples européens.
Les raisons de cette évolution sont sans doute multiples. Aussi, le regain de l’antigermanisme chez les jurisconsultes n’est-il probablement pas sans lien avec la prise de conscience de l’horreur de la guerre, après le retour des étudiants ainsi que des collègues partis combattre. Néanmoins, même si ces hommes d’âge mur n’ont pas vu de leurs yeux la guerre des tranchées, ils sont nombreux à y avoir perdu au moins un fils. La volonté de graviter autour du pouvoir semble dès lors une explication plausible. Ces hommes ont espéré, pendant le conflit, pouvoir apporter enfin leur concours au processus législatif. Néanmoins, leurs conseils n’ont été que vaguement entendus et la fameuse « charte des sinistrés » est à ce titre un cuisant échec. Malgré cette déconvenue, ils ne désespèrent pas pour autant de devenir un jour, le soutien précieux des gouvernements. Ils préfèrent alors confondre fidélité et impartialité, plutôt que d’être de nouveau mis à l’écart. L’attitude des professeurs de droit n’est pas cependant homogène. D’ailleurs, la plupart des professeurs qui interviennent dans le débat public montrent aussi un deuxième visage, plus favorable à une paix durable.
Des États-Unis à La Haye : construire une paix durable
Les facultés de droit, longtemps attelées à la reproduction routinière du corps social des juristes, ont longtemps été de simples machines à examens. Elles ont cependant connu un véritable renouveau dans les dernières décennies du xixe siècle, pendant lesquelles les nouveaux professeurs se sont de plus en plus consacrés à la recherche. Elles ont même commencé à développer des liens avec des universités étrangères à la veille de la Grande Guerre. Malheureusement, celle-ci met fin à ce processus récent. Toute communication est bien évidemment coupée avec les universités des pays ennemis, mais les relations avec les établissements des pays amis ou neutres sont également réduites à la portion congrue.
Il faut attendre l’entrée en guerre des États-Unis, en avril 1917, pour noter un regain de l’Université française pour ses relations internationales. Quelques jours plus tard, le ministre de l’Instruction publique Théodore Steeg accorde une interview au New York Times ainsi qu’au Chicago Daily News, par laquelle il invite les étudiants américains à venir étudier « la science probe et propre » auprès de l’Université française. Il entend faire de cette dernière le nouveau séjour universitaire des jeunes américains, auparavant plus enclins à fréquenter les universités allemandes. La signature de l’Armistice offre la première occasion d’exhausser ce vœu. Les soldats alliés présents au front doivent attendre la ratification du traité de Versailles pour être démobilisés. Néanmoins, sur les sollicitations de deux associations de soldats américains que sont l’American University Union (AUU) et la Young Men Christian Association (YMCA), le général Pershing, chargé des forces américaines débarquées en Europe, autorise les hommes ayant abandonné leur cursus universitaire pour rejoindre l’armée américaine à regagner l’Université française jusqu’à la fin de leur incorporation.
Nonobstant l’inertie des autorités politiques, dont les déclarations ne sont suivies d’aucun effet, les universités françaises s’organisent pour accueillir les soldats venus d’outre-Atlantique. Au mois de février 1919, un millier d’étudiants-soldats est ainsi accueilli à Montpellier. En tout, six mille hommes rejoignent quatorze villes universitaires, où la presse incite les habitants à ouvrir leurs portes à ces étudiants atypiques. Mais l’exotisme de la langue, du jazz et de la peau noire de certains « marines », s’efface devant l’iniquité qu’endurent les soldats français. Ces derniers n’ont pas été autorisés à regagner leurs amphithéâtre tandis que les américains y trouvaient refuge et que les britanniques rejoignaient les universités de leur pays d’origine. La venue des étudiants américains dans les facultés françaises génère donc un engouement éphémère. Toutefois, si les relations universitaires transnationales ne seront plus traitées que dans le cadre académiques jusqu’à la fin de la Troisième République, cet événement est symbolique d’une volonté existant au sein de l’Université, de surmonter les antagonismes nationaux.
L’engagement des professeurs de droit en faveur d’une reconstruction heureuse est particulièrement visible à travers leur investissement en faveur de la Société des Nations. Cette dernière, introduite par le traité de Versailles, fait renaître un mouvement qui s’est intensifié au début du siècle : celui de la « paix par le droit », qui se fixe pour objectif l’orientation du droit international en faveur d’une paix durable entre les peuples. Alors que la violence des combats a fait croître le pacifisme sous ses formes les plus diverses dans toute la société, cette tendance est l’incarnation de sa forme libérale. Par ailleurs, celui-ci n’est pas totalement incompatible avec l’esprit revanchard qui sévit après 1918. L’Union juridique internationale (UJI), qui regroupe universitaires et hommes politiques avec pour but d’accompagner les développements de la SdN, ne rassemble par exemple que des personnalités issues des pays de l’Entente. L’UJI ranime l’Institut de droit international de la faculté de droit de Paris, qui entreprend désormais de former les fonctionnaires de tous pays au droit international, afin de garantir la paix entre les peuples.
La vision du droit international portée par la France à la SDN s’avère déterminée par la conception qu’en a le personnel politique. En effet, lorsqu’il nomme ses délégués aux assemblées successives, le Gouvernement choisit des personnalités en accord avec sa ligne. L’arrivée au pouvoir du cartel des gauches donne ainsi l’avantage à des internationalistes plus optimistes. C’est le cas de René Cassin, professeur lillois et président de l’Union fédérale des anciens combattants (Ufac), qui est à l’origine de la Conférence internationale des associations de mutilés de guerre et anciens combattants (Cimiac), travaillant au rapprochement des anciens soldats de la Grande Guerre, par-delà leurs nationalités.
Malgré la sollicitude d’un certain nombre de leurs maîtres à l’égard du projet internationaliste défendu par la SdN, les facultés de droit paraissent s’en éloigner diamétralement. La faculté de droit de Paris, qui est au premier plan dans la presse nationale, est déchirée par les luttes entre étudiants sympathisants de l’Action française, qui deviennent majoritaires au sein de l’Association générale des étudiants de Paris (Agep), et ceux de la Ligue d’action universitaire républicaine et socialiste (LAURS). Les premiers provoquent de violentes manifestations en 1936, lorsque Gaston Jèze, réputé professeur de droit public, devient le conseiller de l’empereur éthiopien Haïlé Sélassié auprès de la SdN, dans le cadre du conflit qui l’oppose à l’Italie de Mussolini. La SdN est à l’agonie depuis les années 1930. Elle n’a pas pu faire face à la montée des extrêmes droites en Europe et se montre impuissante à apaiser nombre de conflits internationaux. Elle est finalement anéantie par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, tout comme le projet de « paix par le droit ».
Le propos n’est pas ici de juger de l’efficacité des facultés de droit dans le processus de reconstruction. Leur influence réelle y est d’ailleurs bien maigre. Comme cela a pu être évoqué, la réceptivité du personnel politique à la théorie juridique s’avère limitée. La complexité du message en est certainement la cause, mais aussi la notion même de volonté nationale, qui fait émaner la loi des représentants du peuple. Ce portrait en demi-teinte des facultés de droit met néanmoins en évidence la complexité même du mot « reconstruction » tel qu’il résonne dans la société de l’entre-deux-guerres. Théorie et affects s’y rencontrent, générant des forces contradictoires, pouvant aller jusqu’à la paralysie.
Kevin Brémond, doctorant en histoire du droit (université de Bordeaux)
Indications bibliographiques
Barrera Caroline, « Les étudiants-soldats américains en France au sortir de la Première Guerre mondiale », dans Histoire de l’éducation, no 125, 2010, p. 27‑48.
Guieu Jean-Michel, Le rameau et le glaive : les militants français pour la Société des Nations, Paris, France, Presses de Sciences Po, 2008.
Milet Marc, La faculté de droit de Paris face à la vie sociale et politique, de l’affaire Scelle à l’affaire Jèze, 1925-1936, soutenue à l’Université Panthéon-Assas, 1995, 219 p. (dactyl.).
Pauthier Céline, « ‘Nous ne formons qu’une avant-garde’. La refondation d’une faculté de droit française à Strasbourg en 1919 : des professeurs en terre de mission », dans Jean-Christophe Gaven, Frédéric Audren (dir.), Les facultés de droit de province au xixe et xxe siècles. Tome 3, Les conquêtes universitaires, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2011, p. 139‑161.
Soutou Georges-Henri, La grande illusion : quand la France perdait la paix, 1914-1920, Paris, France, Tallandier, 2015.