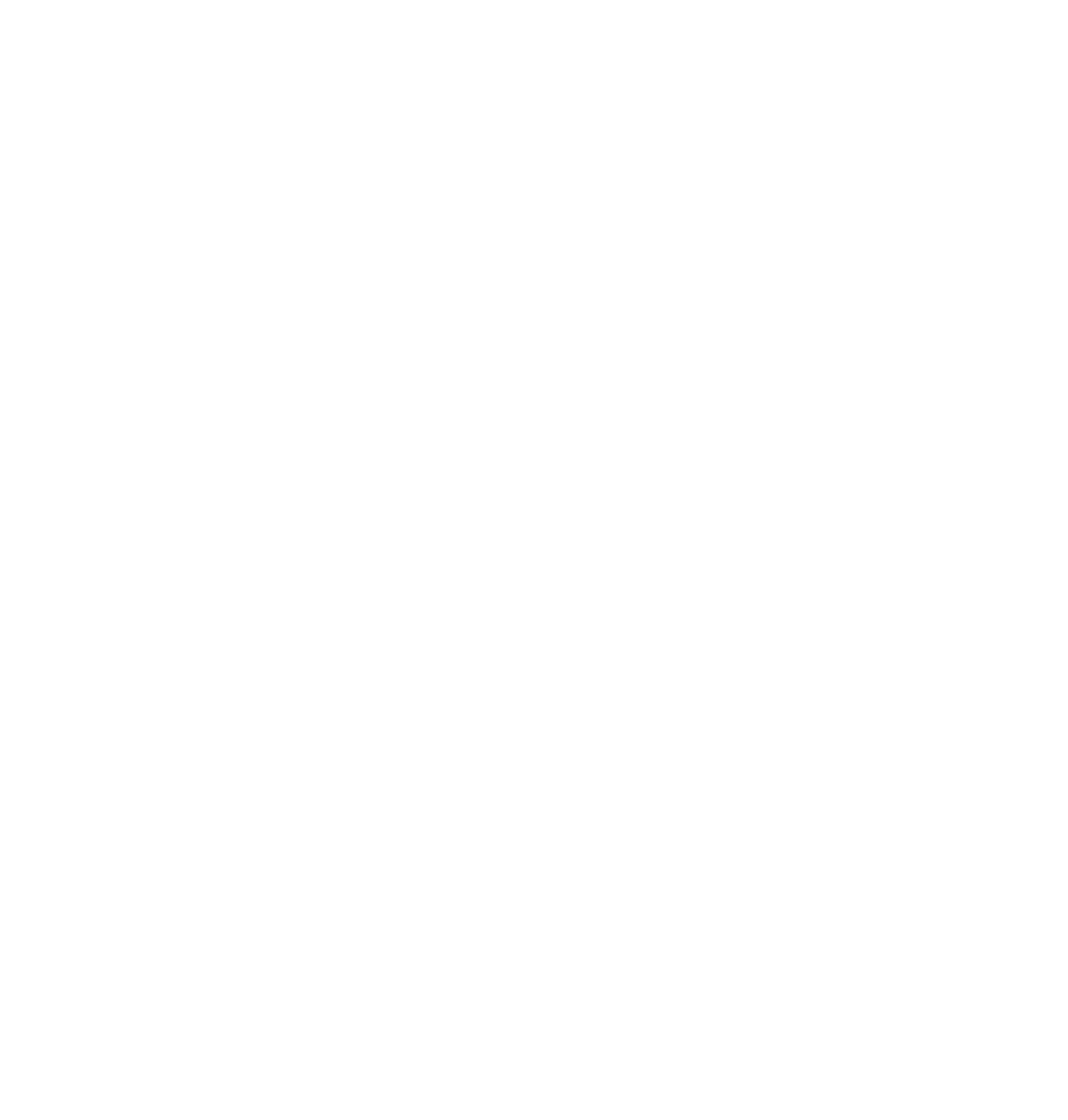Évoquer ce thème montre combien l’environnement des universités a changé en très peu de générations d’étudiants. Combien de générations d’ailleurs ?
Pour la faculté de droit de Toulouse, le point d’inflexion peut être associé à un changement de statut ; de lieu du pouvoir ; de symbole. En 1971, la faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse devient l’université des sciences sociales ; le dernier doyen, le professeur Marty, est le premier président de la nouvelle entité ; le lieu du pouvoir bascule de la « vieille fac. » des habitués vers les espaces perçus comme bien aseptisés de la « nouvelle fac. », rapidement décorée du nom hérité de l’ancienne emprise militaire qui l’habitait depuis la Révolution : l’Arsenal.
Dans le nouvel ensemble, les étudiants étrangers ne sont plus seulement les individualités, quelques poignées venues de loin ou de très loin, venus fréquenter l’Alma mater. Aujourd’hui, les seuls programmes d’échange, dont Erasmus, drainent chaque année environ six cents étudiants, autant ceux en mobilité entrante, que ceux partis en mobilité sortante.
À un moment où le pourcentage des inscrits étrangers dans les formations universitaires est un indice très recherché de l’attractivité de l’établissement, 19 % et plus des étudiants de l’université Toulouse-Capitole en 2017 sont des étrangers. Par rapport à ces 3 603 inscrits de 2017, les quelques dizaines d’étudiants d’ailleurs (selon l’expression de Caroline Barrera) semblent peser bien peu statistiquement, moins de 1 % de l’ensemble avant 1910. Mais les paramètres à considérer sont bien différents pour dresser le tableau au vrai d’une comparaison non biaisée entre hier et aujourd’hui.
D’abord, le nombre des inscrits à la faculté. Ils sont quelques centaines à peine par an sur la longue durée, un temps qui court jusqu’au début des années 1930. Cette époque semble même revenir à la fin des années 1950. Avec l’impact des années de guerre et l’arrivée à Toulouse des « étudiants repliés » comme le fut Edgar Morin, les effectifs de la faculté avaient augmenté significativement. Lorsque les classes d’âge peu nombreuses des années 1935 et suivantes intègrent les facultés, et spécialement la faculté de droit, les vieux maîtres croient pour certains au retour des effectifs peu nombreux de jadis. Or il y a en 2018, 21 300 inscrits à l’université Toulouse-Capitole, dont la majorité il est vrai sur les registres de la faculté de droit.
Ensuite, la faculté d’hier est un monde de l’entre-soi. La reproduction sociale y est forte. Elle utilise les réseaux de parenté et de notabilité tissés par les usages et la pratique du droit d’alors. Des générations de notaires, d’avoués, d’huissiers, de greffiers, d’avocats, de magistrats passent sur les bancs vénérables de la faculté de droit. Cette dernière adule justement ses racines médiévales, sans d’ailleurs relever que la Révolution a détruit ce continuum, continuum reconstruit par Napoléon Ier sans souci effectif de la réalité historique. Les professions réglementées ou à monopole – les officiers ministériels en particulier tels qu’ils sortent des volontés du premier consul Bonaparte, puis de celles de l’empereur Napoléon –, sont de fortes citadelles que le vulgaire ne peut prétendre pendant longtemps attaquer, et où il ne peut s’intégrer sauf cas particulier. Certes, on dresse toujours la liste des exceptions comme la République les adore plus tard pour montrer que, justement, les humbles sont aussi et d’abord ses enfants. Venu du peuple, le fils du boulanger de Revel, boursier, étudiant brillant, avocat, devient ministre du Front populaire et président de la IVe République : Vincent Auriol (1887-1966), en est un exemple éminent.
La faculté est généreuse. Elle l’est aussi pour les étrangers, voilà l’idée. Mais de surcroît, des dispositions particulières réservent en tout ou partie les accès des professions à monopole aux nationaux. C’est dire que les étrangers, contrairement aux formations scientifiques ouvertes sur des savoirs techniques exportables, doivent précisément calculer leur projet en droit. Il faut concéder qu’au début du xxe siècle l’influence du modèle français, y compris dans sa dimension juridique, laisse espérer des occasions nombreuses de faire valoir ses parchemins toulousains. De la sorte et dans un monde pétri de traditions mélioratives, les étudiants étrangers sont une des composantes, certes minoritaire, de la faculté, mais choyée. La peregrinatio academica de l’époque médiévale peut s’interpréter, et s’accommoder d’une sauce bien plus moderne en accueillant par exemple Martín de Azpilcueta (1492-1586) et bien plus tard, lorsque se reconstitua l’école de droit (1805) et ensuite la faculté, les tenues académiques de robe longue furent à nouveau l’indice et l’insigne d’un apostolat particulier réservé à des hôtes de qualité, les extranei.
Panorama sur le xxe siècle
Dans le cours du xixe siècle, on ne relève jamais plus de 10 étudiants étrangers par année universitaire avant 1895. Ce n’est qu’à partir de la Restauration (1814-1830) que l’on peut vraiment établir le volume de ces présences étrangères à travers les archives conservées.
Les rôles de la faculté de droit de Toulouse sont ensuite peu fournis en la matière lorsqu’on observe la première décennie du siècle dernier : entre 6 et 16 étudiants étrangers prennent les inscriptions pour chaque année universitaire, soit nettement moins de 1 % du total des inscrits du moment. Bulgares surtout et Roumains – deux pays neufs à cette époque sont en tête. Avec les Égyptiens, dont les élites sociales pensent et parlent souvent français depuis le canal de Suez, voilà l’essentiel de la petite phalange. Ce temps est celui des dernières années de paix, celles de la Belle Époque – expression consacrée et porteuse de nostalgie. Le chiffre des étudiants étrangers monte à 31 en 1913-1914 (environ 5 % des inscrits), mais s’effondre à 4 en 1916-1917 : Égypte, Grande-Bretagne, Grèce et Russie fournissent chacun un étudiant. Une sorte de présence toute symbolique.
À la fin du conflit, la faculté de droit avait ouvert les bras aux étudiants serbes, et encore plus américains (P. Moulinier – Étudiants étrangers et F. Garnier – Étudiants américains). Les Serbes (25 inscrits en 1917-1918 ; 41 l’année suivante ; 28 encore en 1919-1920 ; 13 en 1920-1921) font augmenter le volume des inscrits étrangers. La petite Serbie, écrasée par les Puissances centrales, avait suscité en France une intense sympathie. Les troupes serbes évacuées de leur pays envahi avaient été rééquipées par la France. Réfugiés aussi, les collégiens serbes furent accueillis avec chaleur au collège de Gaillac (Tarn) et de sa « section serbe » entre 1916 et 1918 ; les étudiants de ce pays le furent aussi par la faculté de droit, et par d’autres structures toulousaines.
Les jeunes Américains, ces 167 Sammies qui vont passer le printemps 1919 sur les bancs de la faculté en attendant leur démobilisation, sont vraiment emblématiques d’un basculement. Ces étudiants sur lesquels veille pour la faculté de droit le professeur Alcée Dugarçon (1879-1932), sont les fruits d’une opération décidée à l’échelle nationale, même si Toulouse n’est pas la seule ville universitaire concernée. À défaut de pouvoir combattre l’ennemi allemand subjugué qui avait demandé l’armistice finalement signé le 11 novembre à Rethondes, les Américains vont aussi donner à Toulouse un air nouveau : leur orchestre Stilley’s Jazz lance avec ses 10 boys tous blancs d’ailleurs, des sonorités inconnues sur la place ; leur journal, Qu’est-ce-que c’est ? est un vrai succès éditorial.
Mais au-delà ?
La paix est là, avec d’ailleurs une « grippe espagnole » qui désole les familles et les autorités sanitaires. La grippe, qui n’a rien d’espagnole en fait, sera à l’échelle mondiale plus mortifère que le conflit lui-même.
Les étudiants étrangers amenés sur les berges de la Garonne par la guerre retournent chez eux. Dans les années 1920, on ne relève que 14 à 50 présences à chaque rentrée universitaire. Ils sont presque tous Européens (dont un fort contingent de Polonais à la fin de la période), à l’exception des Égyptiens, longuement fidèles à la culture juridique française. En 1929-1930, dernière année en France d’une reconstruction apaisée, et d’une récupération bien rendue par le terme consacré d’« Années folles », les étudiants étrangers de la faculté de droit sont là, studieux et appliqués.
On en relève 79, dont 17 Chinois, première nationalité représentée, loin devant la Roumanie (11 étudiants). L’Annuaire de l’université de Toulouse 1929-1930 sorti des presses d’Édouard Privat, « imprimeur de l’Université » donne aux candidats étrangers le modus operandi pratique de la vie nouvelle choisie par eux. Le processus détaillé de demande et d’obtention d’équivalence n’est pas le moins important des sujets abordés. Une fois franchies les frontières d’État et arrivés à Toulouse, la première démarche à faire est de déclarer sa résidence au commissariat de police. Dès la remise du récépissé au secrétariat de la faculté, le processus d’inscription peut se poursuivre.
Annuaire de l’université de Toulouse 1929-1930, chez Privat, éditeur-libraire de l’université
Des organismes souples et des associations sont à l’écoute des étudiants d’ailleurs
Parmi les associations : l’Association des étudiants bulgares ; l’Association des étudiants égyptiens ; l’Association des étudiants polonais ; celle des étudiants roumains ; celle des étudiants yougoslaves. La Pologne et la Yougoslavie sont alors parmi les enfants chéris de notre politique étrangère. La première déteste l’Allemagne et l’ancienne Autriche impériale – puissances ressenties comme responsables de la servitude passée de la Pologne entre 1795 et 1918 ; la seconde déteste au moins autant le même souvenir de l’Autriche – Sarajevo en 1914.
On relève aussi une association des étudiants juifs, mais il y a bien après tout une association des étudiants – et des étudiantes – catholiques. Un club franco-germanique est au travail de son côté, à un moment où la réconciliation franco-allemande est tangible, et sans aucune hypothèque nationale-socialiste.
Les maîtres se dévouent également
Les maîtres donnent largement de leur personne : le Comité universitaire franco-étranger veut « faciliter les relations entre étudiants français et étudiants étrangers ». À sa tête, l’historien et talentueux médiéviste venu de l’École des chartes et fixé à Toulouse, Joseph Calmette (1873-1952). La faculté des lettres est aussi sur les rangs, bien sûr, afin d’accueillir ces talents nouveaux. D’elle dépend ainsi l’Institut normal d’études françaises, fondé en 1920. Ce dernier se donne pour but de dispenser des enseignements de langue et culture françaises, destinés tant à des enseignants étrangers professeurs de français dans leur pays d’origine, qu’aux étudiants étrangers désireux à Toulouse de mieux manier la langue de leurs études. Des sessions sont même organisées à la villa Formose à Pau – vaste maison cossue entourée d’un parc arboré –, pendant les périodes de congés universitaires.
Une adresse essentielle : 56, rue du Taur
Voilà bien l’adresse postale de l’Office de l’université, et son « téléphone 26-83 », à une époque où l’automatique est loin d’être généralisé. L’Office répond à toutes les demandes des « étudiants français et étrangers sur tout ce qui se rapporte à leur vie intellectuelle et matérielle », « pourvue [sic] qu’elle soit accompagnée d’un timbre français ou d’un coupon-réponse international ». L’Office répond aux étudiants désireux de venir à Toulouse, mais aussi « aux familles désireuses d’envoyer leurs enfants faire leurs études à Toulouse, et les aide à trouver la chambre ou la pension qui leur convient ».
D’autres adresses toulousaines
29, rue des Potiers, Maison des étudiants
Joli immeuble d’angle, rue des Potiers et rue des Jardins, dans un quartier loti au xixe siècle à la lisière du noyau urbain ancien. Trois niveaux, clairs et lumineux : voilà la Maison des étudiants ouverte en 1924. On peut s’y restaurer, et à ce service « sont admis les étudiants ou étudiantes, français ou étrangers ». Le professeur Joseph Calmette, de la faculté des lettres, supervise l’activité de la Maison.
20, rue Saint-Jacques, Comité de patronage des étudiants
Cette adresse postale est celle du rectorat de l’académie de Toulouse.
C’est dire que l’on trouve dans ce Comité des illustrations de la vie officielle, académique et diplomatique de la ville, « des consuls, des notabilités toulousaines et de professeurs de l’université ». Les consuls renvoient évidemment au cœur de notre propos : ils tiennent les clefs des visas et passeports, donc de la possibilité d’accès premier à la faculté. Le président du Comité est le recteur de l’université, le vice-président, Joseph Calmette, que nous avons vu à la Maison des étudiants. Pour la faculté de droit, le professeur Jean Plassard (1892-1940) passé par la faculté des lettres et converti au droit est le secrétaire général de l’organisme. Ce dernier doit « encourager toute œuvre conçue dans l’intérêt des étudiants ».
Cet œcuménisme ne dure toutefois pas. Le reflux économique qui se marque en France au cours de l’année 1930 est le reflet plus général de la crise partie des USA. L’horizon géographique s’ouvrira encore pourtant au tout début des années 1930. La Chine envoie ses fils, 37 inscrits sur les 107 étrangers de l’année 1930-1931 : apogée quantitatif, les étrangers représentent cette année 10 % de l’effectif total des inscrits de la faculté. Ce volume est ensuite en constante décroissance jusqu’en 1938, l’année des accords de Munich, où il s’établit à 1,2 %.
Un vent s’est levé, avec violence. Celui du repli.
Un vent mauvais…
Ce vent, c’est celui qui souffle à partir de 1935. Cette année-là et à l’unanimité, la faculté de droit de Paris adopte le 24 janvier 1935 un vœu dont on retient ceci, « Depuis quelques temps, de nombreux étrangers viennent en France avec l’intention de s’y fixer définitivement et de s’y faire une situation en utilisant des diplômes français ». Certes, continue le texte, les métiers de la fonction publique et du barreau sont fermés à ces nouveaux naturalisés qui doivent attendre dix ans avant de postuler. Mais le but avoué, ou en tout cas fort clair, est de bloquer tout accès aux professions intellectuelles supérieures à des individus perçus comme des concurrents déloyaux. Dans les formations scientifiques, la levée de bouclier est très forte.
La loi Armbruster du 21 avril 1933 veut ainsi élever un barrage contre l’irruption des diplômés étrangers : il faut désormais la nationalité et un diplôme français pour exercer la médecine, et l’art du dentiste. S’agissant de la venue des étrangers sur le sol national, on connait fort bien la palette des termes adoptés suivant l’effet recherché dans le propos : l’irruption, la vague, la marée, le flot, l’invasion, cela suivant les humeurs ou l’ampleur ressentie de la menace supposée.
Le vœu de la faculté de droit de Paris est adopté à l’unanimité des onze professeurs présents le 18 mars 1935 par l’assemblée de la faculté de droit de Toulouse. Pourtant, on relevait alors la présence sur les bancs de la faculté de seulement 35 étrangers, soit 2,7 % du total des inscrits de l’année. Une vague ? Un flot ? Plutôt le seul imaginaire lié au « métèque ». Il faut bien dire d’ailleurs que les nuages qui couvraient l’Europe donnaient à la république des Lettres et du Droit et à l’État de droit un teint bien blafard.
La Seconde guerre mondiale allait consacrer les atteintes massives, volontaires, préméditées, à ce que les juristes nomment « le droit des gens ». Pendant l’Occupation, une trentaine d’étudiants étrangers passent à la Faculté chaque année, dont les Belges et les Polonais (mais la Pologne n’existe plus) fournissent les groupes les plus nombreux, 6 à 7 ressortissants au mieux pour chacun des deux pays.
Des Trente Glorieuses à Erasmus
Paru en 1979 chez Fayard, le titre de l’ouvrage de Jean Fourastié (1907-1990) est devenu quasi proverbial.
Furent-t-elles, ces Trente Glorieuses, celles de la consécration de l’ouverture à l’international pour la faculté de droit (et des sciences économiques à partir du début des années 1960) ? La réponse est très mesurée. D’un côté, les maîtres enregistrent sans douleur ni réaction notable la perte de leurs lointaines implantations ultramarines. Ces espaces où ils avaient été attendus, fêtés, accueillis, comme les porteurs d’une très ancienne culture juridique, ils sont perdus, et leurs étudiants ramenés au lot commun, ils ne sont pas de chez nous. Cela est vrai de l’Indochine. Un maître comme le professeur Jean Couzinet (1900-1977), publiciste exerçant d’abord à Bordeaux ses talents avant de rejoindre l’Alma mater toulousaine, avait passé à Hanoï un long et fructueux séjour à l’école supérieure de droit (1935-1936). Créée par un décret du 11 septembre 1931, elle accueillait dans ses murs des promotions nombreuses, plusieurs centaines d’inscrits au début des années 1940. Ces étudiants ne sont pas à proprement parler des étudiants de la faculté de droit de Toulouse, mais certains y poursuivent la suite de leur cursus. La chose est très différente à Rabat.
Dans le Maroc du Protectorat, un Centre d’études juridiques a été créé, sous la main des trois facultés d’Alger, de Bordeaux et de Toulouse (1927). Les étudiants qui suivent les enseignements délivrés sont immatriculés dans l’une de ces trois facultés. Débat récurrent pendant l’époque coloniale, faut-il d’ailleurs favoriser l’horizontalité des formations, c’est-à-dire se contenter de délivrer un bagage de base en réservant les poursuites nobles à l’Alma mater ? Ou au contraire « verticaliser », en générant un cursus complet – ce à quoi aspirent en général les élites locales, mais assez souvent pour se confronter à la réticence de la faculté-mère ?
Le Centre monte en puissance, est dirigé justement par des professeurs venus de la faculté de droit de Toulouse, qui finit par exercer une mainmise sur le Centre de Rabat. Avec la fin du Protectorat, le Centre sera la matrice de la nouvelle université Mohammed V. Mais dès l’indépendance, les liens pourtant pérennes depuis une génération sont totalement délaissés, abandonnés. La faculté de l’époque, sauf exception, ne perçoit que mal l’intérêt de ces étudiants lointains, s’en désintéresse même.
Et pourquoi ?
Les années 1960 voient pour la faculté le gonflement des effectifs, constant de 1963 à 1990, avec une poussée de 10 à 15 % par an et un volume d’étudiants passé de 1 370, à 18 000 dans ce laps de temps. Parmi eux, bien sûr des étudiants étrangers. Mais ils ne sont ni une priorité, ni un volet perçu comme valorisant dans l’immédiat. Les péripéties géopolitiques ont affaibli ou supprimé les habitudes académiques pourtant bien ancrées, et les institutions greffées sur elles. Le Caire et l’Égypte ; Beyrouth et le Liban ne sont plus des destinations, ni pour y faire un bout de carrière (pour les enseignants à l’École française de droit installée dans les deux capitales), ni pour faciliter la venue à Toulouse d’étudiants de ces espaces. La décolonisation en Afrique a distendu les liens, quand bien même des accords construits à Paris et depuis Paris les organisent sur un pied nouveau. Les conventions signées avec les nouveaux États, les bourses offertes par le Gouvernement français dirigent vers la faculté de droit un public nombreux, qui veut se former avant de revenir « au pays ». Des associations, mouvantes et au relationnel parfois difficile, visent à rassembler et accueillir ces passagers toulousains d’un cycle d’études. Ainsi en 1966-1967, le livret de l’étudiant de Faculté de droit et des sciences économiques énumère les adresses toulousaines des associations d’étudiants étrangers, camerounais ; congolais ; ivoiriens ; laotiens ; libanais ; malgaches ; vietnamiens, avec parfois la volonté de les fédérer sur une base géographique : Fédération des étudiants d’Afrique noire française – l’intitulé fleure bon l’influence de la puissance tutélaire et récemment coloniale. Chez nombre d’étudiants venus des territoires jadis sous souveraineté française, le temps de la révérence est largement passé. Le discours proclamé est souvent anti-impérialiste, manié de manière brutale et dépourvue de nuances, important dans l’ancienne métropole coloniale les tensions et clivages du pays d’origine.
À la faculté de Toulouse, on se sent alors très éloigné d’un vaste programme de relations internationales comme on peut l’imaginer aujourd’hui.
Ainsi la faculté ne donne pas suite à des demandes réitérées faites en 1962 par l’université de Yaoundé (Cameroun) pour organiser un cursus commun, malgré l’insistance du ministère français de l’Éducation nationale.
Ainsi dans les années 1960 les présences, les affectations ou détachements de jeunes professeurs français fraîchement agrégés dans les nouvelles universités africaines, en particulier Dakar et Abidjan, ne se traduisent pas, ou très peu, par la volonté de construire des partenariats renouvelés.
Les étudiants venus d’Afrique du Nord – les Marocains en particulier –, ou d’Afrique noire, sont nombreux sur les bancs de la faculté. Les sciences économiques drainent de leur côté des aspirations à des formations nouvelles, et des publics nouveaux, dont ceux venus d’horizons lointains.
Erasmus change bien évidemment les cartes dans l’Union en construction. Programme voulu par les plus hauts sommets de l’État en France autant que par les instances de la Communauté européenne, ce dispositif est opérationnel depuis 1987.
En 2018, Erasmus draine dans ses programmes cent fois plus d’étudiants que lors de sa création en 1987, 300 000 contre 3 000 à l’origine. Une petite fraction d’entre eux, quelques centaines, sont bien sûr à UT-Capitole, y poursuivant leur formation en 2017-2018. Au-delà, 19 % des effectifs de l’université sont aujourd’hui de nationalité étrangère, soit 3 600 sur 21 000.
Assurément une autre époque pour les « étrangers » de l’université Toulouse-Capitole.
Philippe Delvit, professeur d’histoire du droit (université Toulouse-1-Capitole)
Indications bibliographiques
Barrera Caroline, Étudiants d’ailleurs. Histoire des étudiants étrangers, coloniaux et français de l’étranger de la Faculté de droit de Toulouse xixe siècle-1944), Presses du Centre universitaire Champollion, Albi, 2007.
—, « Les étudiants-soldats américains en France au sortir de la Première Guerre mondiale », dans Histoire de l’éducation, no 125, 2010, p. 27‑48.
Devaux Olivier, Garnier Florent, Ceux de la faculté : des juristes toulousains dans la Grande Guerre, « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », no 24, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2017.
Garnier Florent, « Des mémoires et des hommes », dans Christian Lauranson-Rosaz, David Deroussin (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Dockès, Tome 2, Paris, La Mémoire du droit, 2018, p. 447‑466.