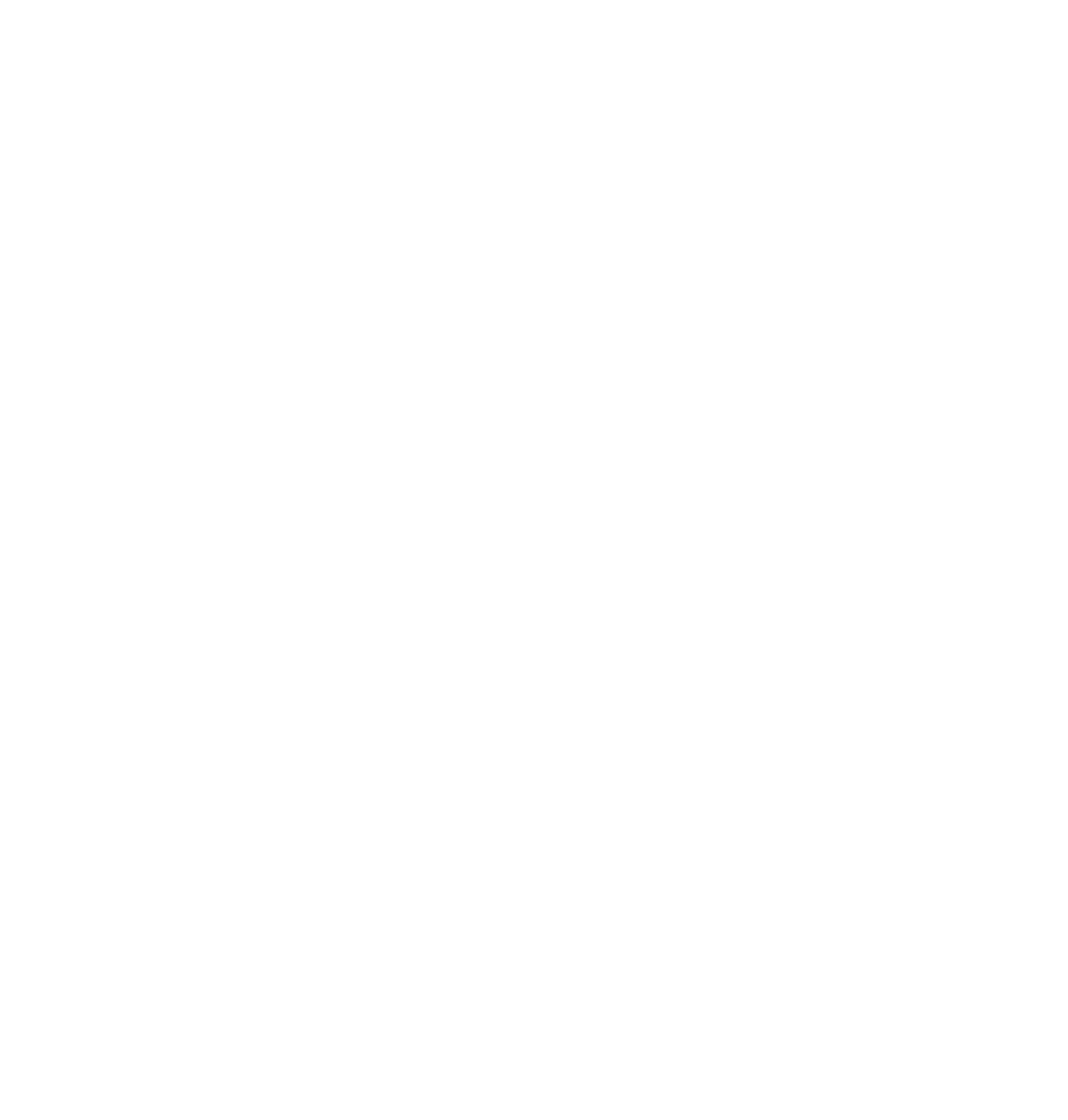À Toulouse, la rentrée universitaire de la première année de guerre a lieu le 9 novembre 1914. Elle s’effectue « de façon normale », rend compte le doyen Maurice Hauriou à ses collègues assemblés. Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes. 1 032 inscriptions en 1913, 295 en 1914. En 1916, on n’en enregistrera plus que 175 et, même si la progression reprend quelque peu ultérieurement, ce n’est pas avant 1930 que le seuil du millier d’inscriptions sera de nouveau franchi. La faculté de droit de Toulouse est touchée de plein fouet par le déclenchement des hostilités. Tandis que beaucoup ont déjà rejoint leur régiment ou partiront progressivement, on attend de ceux de l’arrière que, à leur façon, ils se mobilisent aussi.
Pour les sursitaires et les exemptés, quoique parfois très temporairement, comme pour les plus jeunes non encore mobilisables lorsqu’ils n’ont pas devancé l’appel sous les drapeaux, cette journée du 9 novembre 1914 se déroule dans une ambiance toute particulière. Il en va de même pour les quelques rares étudiantes perdues au milieu de leurs camarades masculins (elles sont 7 inscrites en 1913-1914 et leur nombre se réduira à 3 en 1914-1915 puis à 4 en 1915-1916) et pour les étudiants étrangers (34 en 1913-1914 venus d’Espagne, du Brésil d’Argentine, de Russie auxquels s’ajouteront, convulsions liés à la guerre faisant, 25 Serbes en 1917-1918). L’heure n’est plus à l’euphorie des débuts du mois d’août. Contrainte à la retraite dès le début des hostilités, durement choquée, la France, vient de côtoyer le gouffre. Elle n’a évité le pire que grâce à la bataille de la Marne qui, du 5 au 12 septembre, a permis in extremis de refouler les forces allemandes bien près de s’emparer de Paris. Les pertes en vies humaines sont déjà terribles et l’on sait désormais que la guerre sera longue, une guerre d’usure au long d’un front qui atteindra bientôt quelques 750 kilomètres de tranchées dans lesquelles s’enfouissent et meurent, face à face, les combattants des deux camps.
Le doyen Hauriou l’a d’ailleurs immédiatement rappelé aux jeunes gens, en les réunissant dans le grand amphithéâtre de la faculté (à Paris, le doyen Larnaude s’exprime devant les professeurs). Le passé est révolu. Il ne s’agira pas de se laisser aller au coupable dilettantisme auquel leurs aînés se sont parfois abandonnés et qu’eux-mêmes, peut-être, seraient tentés d’envisager sans déplaisir. Même s’ils ne sont pas, ou pas encore, sous les armes, il leur faut se mobiliser mentalement et en permanence. Il les a aussi fermement rappelés à leurs devoirs de civils de l’arrière : « L’intérêt supérieur de la patrie exige que la vie nationale, sous ses formes multiples, ne s’arrête pas. Vous allez donc obéir à une nécessité et vous allez le faire avec ardeur. »
Régulièrement d’ailleurs, et jusqu’à la fin de la Grande Guerre, Maurice Hauriou les convoquera pour évoquer avec eux le terrible quotidien de leurs camarades combattants, les faits d’armes de ceux qui sont tombés, allongeant ainsi la liste des noms déjà couchés dans le Livre d’or en cours de confection et dédié aux étudiants de la faculté morts pour la France.
La France compte en effet au moins 1,4 millions de morts, quelques 4,2 millions de blessés militaires et la faculté a presque aussitôt versé un lourd tribut. Dès le 24 août 1914, elle a ainsi enregistré ses six premières pertes lors de la catastrophique bataille des Frontières ; s’y ajoute, le même jour, un blessé grave qui mourra en captivité, sans oublier Raymond Leygue, fils d’un ancien maire de Toulouse, qui est tué bien loin de la Belgique ou de la Lorraine, lors de l’attaque d’un obscur poste du Cameroun allemand, en Afrique équatoriale. Son dernier mort, moins d’un mois avant l’Armistice, aura été le sous-lieutenant Louis Buscon, tué à 22 ans, le 18 octobre 1918. Plus jeune encore, Gaëtan Sainctavit, 18 ans, venait à peine d’achever sa première année de droit lorsqu’a éclaté la guerre. Mineur, il est parvenu à arracher une autorisation à son père, a aussitôt contracté un engagement volontaire. Incorporé le 1er octobre 1914, il est tué à 19 ans, le 7 décembre 1915 en Champagne, « foudroyé par éclats d’obus reçus à la tête » alors qu’il porte secours à son frère aîné âgé de 20 ans, lui aussi engagé volontaire au 11e régiment d’infanterie. Engagé volontaire aussi le 28 octobre 1914, Prosper Faduilhe, 18 ans, à peine inscrit en première année de licence, aspirant le 1er septembre 1915, sous-lieutenant en juin 1916, « d’une bravoure et d’un sang-froid remarquables, deux fois blessé, décoré de la médaille militaire, tué à 20 ans, le 5 juillet 1916 à Verdun, en s’élançant à la tête de sa section à l’attaque d’une tranchée allemande, chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. » Leur nom figurera, aux côtés des 222 autres victimes de la Grande Guerre dans la longue liste qu’égraine le monument dédié aux étudiants de la faculté morts pour la France ; mais elle en oublie certains tandis que d’autres avaient déjà achevé leurs études. Parmi eux figurent ceux qui ont à peine eu le temps de savourer le diplôme obtenu ; voici, par exemple, Joseph Jouard, licencié en droit le 20 juillet 1914, revêtant presque aussitôt son uniforme de lieutenant au 18e régiment d’artillerie pour aller mourir deux mois plus tard, jour pour jour, à Minaucourt, lors de la première bataille de la Marne ; ou encore Abel Muratet, docteur en droit le 20 juillet 1914, sous-lieutenant au 238e régiment d’infanterie tué dans le département de l’Aisne, le 23 octobre suivant, et dont Hauriou prononce l’éloge.
Fréquemment issus de la moyenne, voire très bonne bourgeoisie, ils sont souvent fils d’avocats, de magistrats, de notaires, d’huissiers, de journalistes, de propriétaires fonciers cossus, d’officiers supérieurs ou de hauts fonctionnaires, tel Louis Eydoux dont le père commande le 11e corps d’armée en août 1914, ou Marc Estèbe dont le père est gouverneur des colonies. Les familles aristocratiques sont également bien représentées avec, pour n’en citer que quelques-unes, les Beaumont, les Rességuier, les Solages, les Prévost de Saint-Cyr. L’aspirant André Hauriou, qui se distingue sur le front en 1918 et sera à son tour professeur de droit administratif, n’est autre que le fils du doyen de la faculté ; les cousins Louis et Joseph Deloume tués, le premier le 25 et le second le 30 septembre 1915 dans le même secteur du front de Champagne, appartiennent à une véritable dynastie représentée par Jean-Baptiste Deloume (1786-1841), professeur de droit romain et de législation criminelle à la faculté de droit de Toulouse et Antonin Deloume (1836-1911) également professeur de droit romain en 1878 et doyen de la faculté de 1900 à 1906. Car, si le phénomène de reproduction sociale conduisant, génération après génération, à « faire son droit » n’est désormais plus l’exclusif apanage de l’élite sociale traditionnelle, les représentants des catégories populaires, tels Louis Graëff dont le père est maître bottier, demeurent encore relativement rares. La grande majorité est née à Toulouse, en Haute-Garonne ou dans un département peu éloigné, ce qui permet de mesurer l’aire d’influence, en définitive assez limitée, de la faculté. Si l’on excepte les étudiants étrangers, peu nombreux sont donc ceux qui ont vu le jour hors de la métropole. La Martinique, la Tunisie et, davantage, l’Algérie sont cependant représentées, parfois d’ailleurs du fait d’une affectation paternelle ; ainsi, Pierre Loustau, né à Mostaganem et fils du président de la cour de Mascara ou Pierre Schenk, né à Tunis d’un officier de carrière. Dans leurs rangs, le guyannais Gaston Monnerville, venu suivre ses études secondaires à Toulouse, inscrit à la faculté de droit en 1915, y obtenant la licence en octobre 1918, bientôt avocat (2 décembre 1918), puis docteur en droit (1921), futur président du Conseil de la République (1947), président du Sénat (1958-1968), membre du Conseil constitutionnel (1974). Lors de la prestation du serment d’avocat du jeune Gaston, le passablement méprisant et, en tout cas, peu perspicace chroniqueur de la Gazette des tribunaux du Midi décrira, côtoyant l’un de ses jeunes camarades de promotion à « la silhouette mince et blonde […], le masque brun et énergique de Me Monnerville, un créole des Antilles françaises, qui mettait là comme une note d’exotisme ». Et, après que chacun des deux a tour à tour pris la parole : « Me Monnerville, dans un genre plus didactique, a eu aussi […] sa bonne part de succès, et il le méritait ce jeune et laborieux confrère qui peut-être un jour devant les juridictions d’Outre-Mer, montrera quelle forte empreinte et quel judicieux enseignement il reçut de la faculté et du barreau toulousain… ».
Incontestablement plus généreux auront été les professeurs de la faculté de droit, conscients de ce que le pays doit à ceux qui se sont sacrifiés. Le 18 décembre 1917, ils décerneront le doctorat en droit à Ludovic Valatx, à l’issue de la soutenance posthume de la thèse qu’il est parvenu à achever avant de mourir à Arcachon le 17 août 1916 des suites d’une maladie contractée au front.
De leur côté, les étudiants-soldats toulousains, dans la correspondance qui les relie à l’arrière, auront eu à cœur de continuer à cultiver les liens les unissant à leur faculté. Tels, entre autres, Henri Lescure annonçant, en décembre 1914 et de nouveau en juillet 1915, la mort au combat de deux condisciples ; Sébastien Bach qui, le 12 juillet 1917, met à profit quelques instants de repos pour écrire au doyen Hauriou afin d’accuser réception de la cotisation versée au titre de l’abonnement à L’Écho du boyau, « organe des poilus du 214e », saisissant l’occasion pour l’informer des effets produits sur la troupe par l’entrée en guerre des États-Unis, « avec moins d’illusions peut-être » que chez les civils, lui livrant enfin sa vision de la situation internationale ; Jules Thabaut, achevant « aux Armées, en octobre 1916 » la rédaction de Souvenirs de la Grande Guerre qu’il adressera, dès leur publication en 1917, au doyen Hauriou en les assortissant d’une dédicace ; Fernand Bastide encore, dont on peut imaginer qu’il résume à lui seul les pensées de ses camarades lorsqu’il évoque, dans une lettre expédiée en 1916 au professeur César-Bru, « les « interminables nuits […] passées, l’hiver dernier, dans les tranchées » pour les opposer, avec une douloureuse nostalgie, aux souvenirs des temps heureux, ceux des « cours de la faculté de droit de Toulouse ».
Olivier Devaux, professeur d’histoire du droit (université Toulouse-1-Capitole)
Indications bibliographiques
Barrera Caroline, Étudiants d’ailleurs. Histoire des étudiants étrangers, coloniaux et français de l’étranger de la Faculté de droit de Toulouse xixe siècle-1944), Presses du Centre universitaire Champollion, Albi, 2007.
Devaux Olivier, Garnier Florent, Ceux de la faculté : des juristes toulousains dans la Grande Guerre, « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », no 24, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2017.
—, Mémoires de la Grande Guerre. Le Livre d’or de la faculté de droit de Toulouse, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2018.
Gazzaniga Jean-Louis, « Le barreau toulousain et la Gazette des tribunaux du Midi (1881-1930) : documents », dans Revue de la Société internationale d’histoire de la profession d’avocat, no 2, 1990, p. 103‑154.
Monnerville Gaston, Témoignage. Tome 1 : De la France équinoxiale au palais de Luxembourg, [Nombreux passages sur sa vie d’étudiant à Toulouse], Paris, France, Plon, 1975.