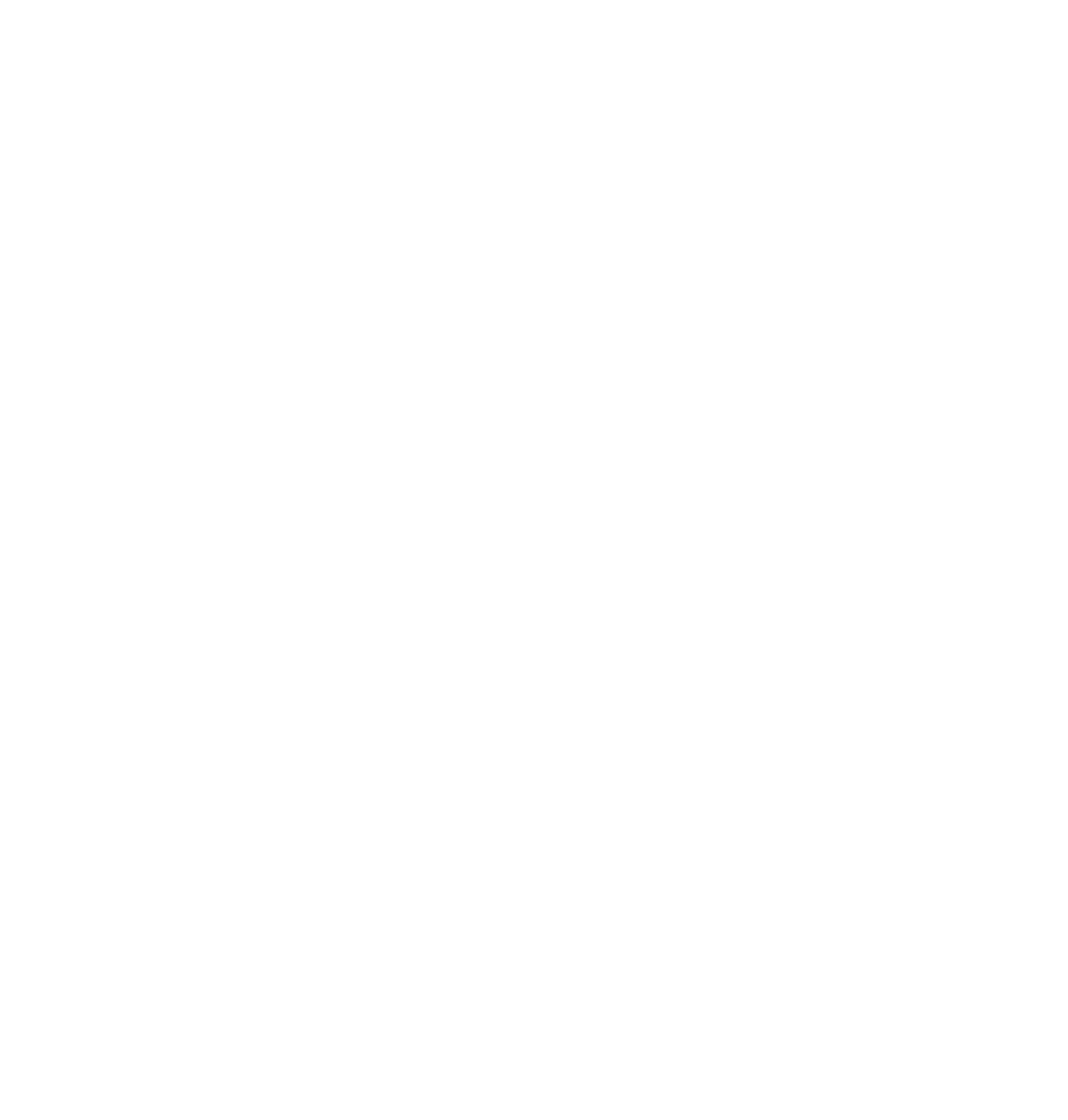Dans un conflit militaire, les universités sont susceptibles de procurer à l’État dont elles dépendent des ressources de natures diverses. La première d’entre elles est de nature humaine, au travers des personnes de leurs étudiants et, celles, moins nombreuses, de leurs professeurs mobilisés militairement. Dans un pareil contexte, les universités sont encore susceptibles d’apporter des ressources scientifiques, dont les applications militaires peuvent parfois s’avérer déterminantes. Enfin, elles peuvent procurer des ressources symboliques non négligeables. La production intellectuelle, par le simple fait qu’elle persiste dans l’adversité, atteste la vigueur du pays belligérant ainsi que sa capacité de résistance à l’inévitable désorganisation engendrée par le conflit. Mais cette production intellectuelle peut encore, à sa manière, contribuer à l’effort de guerre en travaillant à consolider la résolution belliqueuse des étudiants que l’armée n’a pas encore appelés, ainsi que celle du grand public. Pour ce faire, il faut toutefois que les universitaires acceptent de répudier la dimension scientifique, c’est-à-dire à la fois objective, critique et universaliste, de leur activité afin d’épouser aveuglément la passion patriotique du moment et, plus encore, qu’ils osent investir l’espace public. Si certains exemples spectaculaires, donnés par quelques professeurs de droit parisiens, peuvent amener à conclure à un aveuglement de l’intelligence sous l’effet d’une crise de patriotisme exacerbé, l’analyse des comportements de leurs homologues de la faculté de droit de Lyon pendant le conflit permet de nuancer ce tableau. Car à Lyon, la mobilisation intellectuelle des professeurs de droit n’a pas toujours été très intense ; elle n’a pas, non plus, été très spontanée.
Mobilisation militaire des professeurs lyonnais
La ponction humaine opérée par la mobilisation générale décrétée le 1er août 1914 a affecté inégalement le personnel enseignant dépendant de la faculté de droit de Lyon. Le corps enseignant de sa jeune filiale, l’école française de droit de Beyrouth ouverte depuis 1913, était composée de jeunes docteurs en droit pas encore trentenaires immédiatement mobilisables dans des unités combattantes. Ils ont donc été contraints d’abandonner leur poste pédagogique, condamnant l’école à refermer ses portes, alors même que la toute première session d’examen, prévue à l’automne, n’avait pu avoir lieu. L’école de droit de Beyrouth rouvrit, non sans difficultés, en 1919, mais deux de ses premiers professeurs laïques – Claude Blanc et Louis Berthoumeau – n’y reprirent pas leur place : l’un et l’autre étaient tombés dans les premières semaines de la guerre, victimes des suites de leurs blessures, le premier dès le 30 août, le second le 12 octobre.
Le rappel à l’activité militaire n’a pas eu une incidence aussi lourde sur le corps enseignant en poste à la faculté de droit de Lyon, laquelle fut sans aucun doute l’une des moins désorganisées par la mobilisation en raison, tout simplement, de l’âge de ses enseignants. Si, durant ses deux premières décennies d’existence, la faculté juridique lyonnaise avait connu une importante rotation de son personnel que déplorait régulièrement son premier doyen Exupère Caillemer, il n’en allait plus de même depuis le milieu des années 1890. Disposant désormais d’un vivier de docteurs de droit formés par ses soins et trop heureux de lui appartenir après leur succès au concours d’agrégation, elle avait simultanément réussi au début des années 1900 à fidéliser de jeunes agrégés de formation parisienne – tels Edouard Lambert, Paul Huvelin ou encore Emmanuel Lévy – qui accomplirent l’intégralité de leur carrière entre Rhône et Saône. La conséquence de cette stabilisation du personnel enseignant depuis une vingtaine d’années était bien évidemment que la majorité des professeurs approchaient en 1914 l’âge de 50 ans au-delà duquel les hommes étaient définitivement libérés de leurs obligations militaires.
Le conflit ne devait donc happer dans ses rouages que trois enseignants : les professeurs d’économie politique René Gonnard et Charles Brouilhet, ainsi que le professeur de droit administratif, Jean Appleton. Ces quadragénaires ont, toutefois, été beaucoup moins exposés au risque de mort que leurs étudiants. Leur âge, en effet, les préservait a priori de l’épreuve d’un versement dans des unités combattantes de l’armée active. Ils ont donc été affectés soit dans des régiments de l’armée dite territoriale (René Gonnard), lesquels avaient vocation à effectuer divers travaux militaires en retrait du front, soit dans les divers services auxiliaires de l’armée. Ces derniers formaient une administration militaire que la guerre prolongée allait bientôt rendre tentaculaire, et pour laquelle le haut niveau de compétences, à la fois juridiques, économiques et, parfois mêmes linguistiques, des professeurs de droit était précieux. L’exemple du parcours du professeur Charles Brouilhet en atteste. Affecté dès l’été 1914 dans les services de l’intendance, il demandait, après l’armistice, son maintien sous les drapeaux jusqu’à la cessation complète des hostilités. Il est vrai que juriste autant qu’économiste, Charles Brouilhet, qui avait eu l’occasion d’effectuer plusieurs voyages scientifiques en Allemagne avant-guerre et parlait la langue de l’ennemi, était encore en mesure de rendre de nouveaux services. Nommé à compter du 18 novembre 1918 au Grand Quartier général en qualité de conseiller technique à l’état-major du Commandement en chef des armées alliées chargées de l’administration des pays rhénans, il avait sans doute su se rendre indispensable, puisque le 11 novembre 1919, moins de trois semaines après sa démobilisation, il était cette fois-ci nommé professeur d’économie politique à la faculté de droit de Strasbourg désormais restituée à la France. Cette nouvelle affectation universitaire lui permettait de continuer à remplir la fonction de chef du service législatif pour les provinces du Rhin auprès de la commission interalliée des territoires rhénans. Elle lui offrait aussi l’opportunité d’œuvrer à la création de l’école de droit de Mayence.
Des trois enseignants titulaires mobilisés, Jean Appleton, professeur de droit administratif et avocat au barreau de Lyon, se distingue toutefois par un parcours de guerre hors du commun. Celui-ci s’explique tant par l’indéniable appétit d’engagement personnel d’un homme profondément animé du besoin de servir que par ses origines anglo-américaines dont l’armée sut tirer avantageusement profit, une fois les États-Unis entrés en guerre en 1917. Né en 1868 à Charolles, fils du romaniste Charles Appleton, Jean Appleton était aussi le petit-fils de John James Appleton, ancien consul des États-Unis en France, où celui-ci avait fait souche dans les années 1840. Dreyfusard militant et fondateur de la section lyonnaise de la Ligue des droits de l’homme, Jean Appleton aurait pu être amené à nourrir à l’endroit de l’institution militaire quelque méfiance. Il n’en était manifestement rien. En 1912, une fois venue l’heure de la libération définitive de ses obligations militaires, il avait expressément demandé à être maintenu dans les cadres de l’armée de réserve, et, ce, alors même qu’il continuait à conseiller Alfred Dreyfus, à l’occasion de ses démêlés judiciaires avec une fraction de la presse qui refusait toujours le jugement de révision de 1906… Nommé, au moment de la mobilisation d’août 1914, substitut au conseil de guerre de Grenoble, puis transféré en la même qualité à Lyon à partir du mois d’octobre de la même année, Appleton ne se satisfaisait pas de cette affectation, probablement trop tranquille à ses yeux. À un tempérament naturellement combatif et avide d’action s’ajoutait peut-être la mauvaise conscience d’être un « embusqué », comme disaient alors les combattants, désignant sous ce terme tout homme portant l’uniforme qui n’encourait pas véritablement les risques de la guerre. Aussi, lorsqu’en 1915 un nouveau théâtre d’opérations militaires s’est ouvert dans les Balkans, Jean Appleton a-t-il demandé et obtenu d’être intégré dans le corps expéditionnaire d’Orient. Affecté à l’état-major de ce dernier, il devait y acquérir rapidement des compétences remarquées d’organisateur, capable de faire régner l’ordre et la méthode dans le chargement et le déchargement des très nombreux navires qui acheminaient sur ces terres lointaines, hommes, armement et matériel en tout genre. À partir de 1916, alors que la France entreprenait d’aider son alliée serbe dans l’entreprise de réorganisation de son armée laminée, la connaissance de la région et les aptitudes d’administrateur de Jean Appleton lui valaient d’être détaché en qualité de chef d’état-major à la mission française auprès du Gouvernement serbe. L’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique à partir du printemps 1917 et la perspective d’une prochaine et massive arrivée des troupes américaines le ramenaient en France. Il est vrai que le professeur, doté d’origines américaines et désormais très expérimenté dans l’art du débarquement des troupes, était à bien des égards « the right man at the right place ». Ce fut avec beaucoup d’émotion que, le 26 juin 1917, il accueillit le général Pershing et les premiers soldats venus du Nouveau Monde dans le port de Saint-Nazaire, alors principale base américaine en France. Pendant plusieurs mois, le commandant Appleton a joué le rôle délicat d’interface, non seulement entre l’armée française et l’armée américaine, mais encore entre cette dernière et les divers pouvoirs publics civils locaux auxquels l’arrivée de « Sammies », à la culture si différente, n’allait pas manquer de poser de multiples difficultés. Promu chef de bataillon, Jean Appleton terminait la guerre à l’état-major de l’armée, au bureau spécial franco-américain, qu’il a quitté, presque à regret, pour reprendre sa place à la faculté de droit de Lyon en novembre 1918. Il avait fallu les injonctions pressantes de son doyen et ami, Louis Josserand, et le rappel à d’autres devoirs, pédagogiques cette fois-ci, pour qu’Appleton renonçât enfin aux charmes de la vie militaire et reprît le chemin des amphithéâtres. Il allait profiter de son retour à Lyon pour reprendre, sur le thème d’une nécessaire amitié franco-américaine à approfondir, le flambeau des conférences publiques que ces collègues avaient, sans enthousiasme excessif, porté pendant la durée du conflit.
Une mobilisation intellectuelle contrainte
On le sait bien : l’élément déclenchant de la mobilisation intellectuelle des milieux universitaires et savants français a été la publication dans la presse nationale, en octobre 1914, d’un texte intitulé « L’appel des Allemands aux peuples civilisés », signé par 93 intellectuels, artistes et professeurs d’université d’outre-Rhin. Mieux connu en France sous le nom de Manifeste des 93, ce texte réfutait catégoriquement, en recourant à des dénégations pures et simples (il n’est pas vrai que…), les accusations de barbarie et de manquements au droit international dont ses adversaires accablaient l’Allemagne depuis les premières heures du conflit et, en particulier, depuis la violation de la neutralité belge. Les signataires allemands de ce texte avaient beau n’être qu’au nombre somme toute restreint de 93, ce texte a été immédiatement perçu en France comme une émanation de la totalité communauté scientifique allemande. Et l’on estima que la preuve était désormais faite de la plus complète solidarité des forces intellectuelles allemandes avec leur gouvernement et leur armée. Les forces intellectuelles françaises se devaient donc de dénoncer, auprès des neutres, cette attitude rapidement qualifiée d’asservissement de l’intelligence au militarisme prussien.
La première riposte collective des universités françaises prit donc la forme d’un manifeste élaboré par les professeurs parisiens, auquel leurs collègues de province se rallièrent à l’unanimité. À la longue litanie des dénégations allemandes, l’on a répliqué par une autre litanie, de questions cette fois-ci, qui appelaient d’évidentes réponses permettant de rappeler la culpabilité de l’ennemi et la justesse du combat de la France et de ses alliés. Qu’en agissant ainsi, l’on reproduisît exactement ce que l’on reprochait aux intellectuels allemands ne sembla pas effleurer grand monde, sauf peut-être ceux, qui, par la suite, ont préféré s’enfermer dans le silence.
L’université de Lyon, toutes composantes confondues, avait, bien évidemment, été signataire de ce texte. Toutefois, contrairement à l’université parisienne dont certains membres prestigieux allaient en suite de ce premier épisode se livrer à une intense action de propagande (l’historien Ernest Lavisse, le sociologue Emile Durkheim ou bien encore le doyen de la faculté de droit de Paris, Ferdinand Larnaude), et, en revanche, à l’image de beaucoup d’universités provinciales, celle de Lyon n’a pas jugé bon de renchérir après cette première prise de position publique.
Inertie, réserves ou désapprobation du corps enseignant en général et de celui de la faculté de droit en particulier, alors même que dans cette « guerre du droit » elle était, par nature, appelée à s’exprimer et à prendre publiquement position ? En l’absence de conservation des procès-verbaux du conseil de la faculté de droit de Lyon, il est bien délicat d’essayer d’apporter une réponse certaine. Sans doute le rapport établi par le doyen Josserand pour l’année 1913-1914 véhicule-t-il déjà des accents tragiques et des images appelées à devenir éculées : celle notamment de l’éclipse du droit subjugué par la force, mais dont les armées alliées rétabliront le règne ; celle des étudiants en droit qui, après l’avoir appris, sont partis mourir pour lui. De même, le rapport sur les concours de l’année 1913-1914, rédigé par Maurice Picard, assimile-t-il déjà le conflit à une opposition entre « la civilisation et la Germanie », la barbarie de cette dernière étant sous-entendue par le choix même de cette dénomination. Toutefois, rien n’indique avec certitude que ces prises de position ont été réitérées à l’occasion de la reprise des enseignements et le dépouillement de la presse locale en atteste par son absence même de résultats : au contraire de l’attitude observée par les doyens des facultés de droit de Paris ou de Toulouse, aucune publicisation de propos de cette nature n’a été opérée par le doyen Josserand, ni d’ailleurs par l’un ou l’autre de ses homologues représentant les autres facultés lyonnaises.
Ce défaut d’entrain à partir en croisade contre la science allemande explique dès lors le pressant appel du pied auquel le président de l’université, qui n’était autre que le recteur de l’académie de Lyon, a dû recourir pour que les universitaires lyonnais, toutes spécialités confondues, sortent enfin de leur silence et abandonnent la posture de relatif retrait qu’ils avaient adoptée depuis le début du conflit. À l’occasion de la séance du conseil de l’université du 5 décembre 1914, le recteur Paul Joubin demandait en effet aux représentants des quatre facultés d’investir résolument l’espace public pour soutenir intellectuellement la cause de la France face à l’Allemagne. S’il fut finalement sacrifié à cette demande, c’est peut-être parce que tous les espoirs d’une guerre courte étant anéantis, il est apparu nécessaire de se lancer dans l’arène afin d’entretenir, pour une durée désormais indéterminée, la ferveur patriotique de l’opinion publique. Il est vrai, aussi, que la demande du recteur ressemblait à s’y méprendre à un ordre, même s’il était diplomatiquement enrobé sous une prétendue demande expresse de l’opinion lyonnaise dont le recteur affirmait se faire le porte-parole.
Il faut donc attendre le début de l’année 1915 pour que les prolongements de cette séance se fassent sentir et que diverses initiatives, soit propres à chaque faculté, soit transcendant le clivage facultaire, soient enfin prises. La faculté de droit a, par exemple, décidé de transformer en cours public deux enseignements : celui de finances publiques, alors assuré par Emile Bouvier et consacré aux finances françaises en guerre et, beaucoup plus emblématique encore, celui de droit international public, alors professé par le titulaire de la chaire éponyme, Paul Pic. La presse locale, qui annonce les leçons de ce dernier, permet de reconstituer la liste des thèmes abordés au fil des dix séances. « Le pangermanisme », « Les lois de la guerre : opposition des doctrines françaises et allemandes », « La Belgique neutre, le droit de la Guerre d’après les conventions de Genève et de La Haye », « Qui a voulu la guerre ? Ses origines d’après les documents diplomatiques », « La violation systématique du droit de la guerre par les Austro-allemands, sanctions nécessaires » : autant d’intitulés qui ne laissent guère de doute sur l’orientation des propos du professeur.
La plus notable des initiatives universitaires lyonnaises demeure, cependant, à partir du printemps 1915, l’organisation, toujours à destination du grand public lyonnais, de séries de conférences animées par les professeurs des quatre facultés. Elles ont eu lieu régulièrement pendant deux ans et ont fait l’objet d’une publication dans une collection intitulée « Questions de guerre », laquelle comprendra à la fin du conflit quatre gros volumes. Préfacier du premier volume, le recteur Joubin rappelait, avec une insistance qui conforte l’hypothèse de vives réticences initiales du corps professoral à intervenir dans l’espace public, qu’il y avait de multiples manières de faire la guerre. Pour ceux que leur âge mettait à l’abri du combat physique, éclairer et réconforter l’esprit public était bel et bien l’une d’entre elles.
Si l’on excepte le volume consacré aux divers moyens de lutter contre la dénatalité française, lequel, fort explicite sur l’angoisse collective du dépérissement de la nation, ne concernait que marginalement l’Allemagne, ces conférences étaient dépourvues d’originalité. Quelle que soit la discipline de spécialité du conférencier, elles obéissaient aux impératifs patriotiques du moment et suivaient une méthode déjà bien établie par tous ceux qui s’étaient déjà abondamment répandus en écrits et en paroles pour dénigrer l’apport scientifique allemand dans ses diverses facettes. Il fallait s’attaquer à la pensée scientifique allemande, la discréditer définitivement en montrant, pêle-mêle, sa lourdeur, son pédantisme, son autoritarisme, sa violence et par-dessus tout son extrême dangerosité, en la rendant responsable tant du conflit lui-même que de la manière atroce dont il était conduit. Bien évidemment, il convenait, a contrario, d’exalter l’esprit français, sa richesse, sa noblesse, son élégance, son libéralisme, son individualisme et sa générosité à l’égard des plus faibles et des petits. Certains professeurs de droit lyonnais sont parvenus à se soustraire à cet exercice de contrepoint rudimentaire qui réunissait un public nombreux dans le grand amphithéâtre du 15 quai Claude Bernard. Charles Appleton, Edouard Lambert, Armand Bouvier-Bangillon, Emile Cohendy et Irénée Lameire brillent, en effet, par leur absence. Leurs collègues se sont, pour leur part, inégalement investis. Paul Huvelin, Emile Bouvier et Emmanuel Lévy assurèrent deux conférences ; Jean-René Garraud, Maurice Picard, Paul Pic ou le doyen Louis Josserand, n’en commirent qu’une seule. Les thèmes retenus ne brillaient pas non plus par leur originalité : la conception allemande de l’État (Emile Bouvier), la force et le droit (Louis Josserand), la conception allemande de l’état de nécessité et ses applications en droit international (Jean-René Garraud) étaient devenus depuis l’été 1914 autant d’exercices de style obligatoires. Les conférenciers s’engagèrent encore sur des sujets qui, tout en leur étant chers, pouvaient aussi tenir à cœur aux Lyonnais, compte tenu des particularismes de leur population et de leurs intérêts économiques et commerciaux spécifiques. Dans une ville qui comptait, depuis la défaite de 1870, une importante communauté d’Alsaciens et de Lorrains, Emmanuel Lévy, dont la famille était originaire du Haut-Rhin, a choisi le thème du traité de Francfort et de la condition réservée aux populations des provinces perdues. Paul Huvelin, inlassable cheville ouvrière de l’école française de droit de Beyrouth, entretint, pour sa part, le public local de la question de l’Allemagne en Orient, cet Orient où le commerce lyonnais – et la faculté de droit – avaient tant d’intérêts à préserver. Si tant est que Paul Huvelin ait eu initialement quelques scrupules à s’aventurer dans cet exercice outrancier de la conférence patriotique, il semble qu’il ait pris goût à l’exercice. Excellent pianiste amateur, mélomane averti, ami personnel de Debussy et de Ravel, l’historien du droit s’emparait dans le courant de l’année 1915 de son hobby pour faire une nouvelle fois œuvre patriotique. Il s’agissait cette fois-ci d’exalter l’excellence de la musique française « dont le culte s’impose à l’heure où l’Allemagne prétend exploiter contre nous sa grandeur musicale passée ». Pour ce faire, Huvelin mettait sur pied une autre série de douze conférences-concerts dont les textes furent regroupés et publiés en 1917 aux éditions Crès sous le titre Pour la musique française. Il ne dissimulait pas l’impact qu’avait eu sur sa détermination la lecture au bas du Manifeste des 93 des noms de Humperdinck, Weingärtner et Siegfried Wagner : « Et je crie : Haro sur ceux-là, représentants de la Kultur contemporaine ! À eux et à leur musique “d’empire” je prétends demander des comptes ! ». Lors de la conférence inaugurale, avec le très opportun renfort du jugement porté par Nietzche sur l’auteur de Tannhäuser, il exécutait – au sens plus militaire que musical du terme –, l’œuvre jusque-là adulée en France de Richard Wagner. Dans la conférence de clôture, tout compte désormais fait, Paul Huvelin rassurait son public. Depuis quarante ans, la production musicale allemande était bien décevante et il prophétisait, en se trompant évidemment lourdement, qu’à l’exception de leur propre pays où ils pouvaient faire illusion, Gustav Malher, Anton Bruckner, Arnold Schönberg ou Richard Strauss seraient méprisés par la postérité internationale. En revanche, avec Claude Debussy, Maurice Ravel, Gabriel Fauré ou encore Paul Dukas, la France incarnait une musique nouvelle qui possédait « le don d’éveiller à l’Infini » et lui conférait une indiscutable suprématie universelle.
Passée l’année 1916, il faut bien admettre que l’on ne trouve plus trace de propos publics de cette eau. La presse locale ne mentionne plus guère le nom des professeurs de la faculté de droit, si ce n’est pour indiquer le montant de leurs dons aux œuvres charitables de guerre ou pour signaler qu’ils ont présidé aux inévitables cérémonies organisées lors de l’arrivée de trains sanitaires de soldats en gare des Brotteaux. Contrairement à d’autres facultés de droit provinciales, notamment celle de Bordeaux, celle de Lyon ne s’est pas beaucoup investie non plus dans la promotion des emprunts de guerre et dans les activités du comité départemental local pour l’or.
L’occupation de l’espace public a donc été de courte durée et, surtout, elle semble résulter d’un réflexe d’obéissance aux directives énoncées par le représentant du gouvernement dans la sphère académique. Certes, une fois venue l’heure de la victoire et, dans son sillage, celle du retour des étudiants soldats survivants, le doyen Josserand n’a pas manqué de renouer avec la rhétorique convenue lorsqu’il déclara à l’occasion de la rentrée solennelle de 1919 aux étudiants récemment démobilisés : « […] nous ne subirons plus, jusque dans nos propres travaux, l’empreinte du lourd esprit germanique ; il nous sera permis de nous exprimer clairement ; nous pourrons écrire des livres qui ne soient pas des répertoires, des dictionnaires ou des compilations bibliographiques ; obscurité ne sera plus synonyme de profondeur ; nous penserons et nous écrirons en Français ; en un mot nous pourrons être nous-mêmes. Le charme est rompu ; nous sommes désenchantés, libérés à jamais, et c’est par vous que nous le sommes, jeunes élèves, par vous et par les morts glorieux dont j’ai produit les noms. Grâce à eux, grâce à vous, de nouveaux destins s’offrent à la science juridique française. En brisant l’hégémonie germanique, vous nous avez restitué au centuple les services que nous avions pu vous rendre. Vous n’avez pas seulement libéré des territoires ; vous avez libéré la pensée française elle-même. Vous avez fait du Droit, vous l’avez fait à la Française, clairement, simplement, héroïquement : soyez-en à jamais remerciés par vos maîtres reconnaissants ! »
Une question, toutefois, demeure, que l’on peut se poser au sujet du doyen lyonnais comme à propos de beaucoup d’autres de ses collègues : en leur for intérieur, quel degré de véracité et de sincérité accordaient-ils eux-mêmes à leurs patriotiques déclarations ?
Catherine Fillon, professeure d’histoire du droit (université Lyon III)
Indications bibliographiques
« Fonds privé Jean Appleton », Archives départementales de l’Ain, 207 J.
Fillon Catherine, « L’itinéraire d’un avocat engagé : l’exemple de Jean Appleton », Revue de la Société Internationale d’Histoire de la Profession d’Avocat, no 6, 1994, p.195-218.
Frobert Ludovic, Potier Jean-Pierre, Tiran André, Économistes en Lyonnais, en Dauphiné et en Forez, Lyon, Éditions de l’Institut des Sciences de l’Homme, 2000.
Milet Marc, Les professeurs de droit citoyens : entre ordre juridique et espace public, contribution à l’étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français (1914-1995), [Chapitre 1 : 1914-1918], Thèse de doctorat, soutenue à l’Université Panthéon-Assas, 2000, 791 p. (dactyl.).
Prochasson Christophe, Rasmussen Anne, Au nom de la patrie : les intellectuels et la Première Guerre mondiale, 1910-1919, Paris, France, La Découverte, 1996.
Rasmussen Anne, « La “science française” dans la guerre des manifestes, 1914-1918 », Mots. Guerres et paix. Débats, combats, polémiques, no 76, novembre 2004, p. 9-23.